06/12/2015
Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, Le livre de poche, 1974 [1907], 281p.
L'époque de Noël est particulièrement propice aux lectures doudous ; on s'enroule dans un plaid, on sirote un thé (Mariage Frères, of course) et puis on enfile avidement quelques pages d'un classique bien poussiéreux, bien usé jusqu'à la corne, qui fait du bien. A défaut de faire un sapin (parce qu'avec plusieurs chats frétillants, ça s'apparente à un suicide domestique), je me paye une régression littéraire les week-ends de décembre. C'est mon petit cadeau à moi.
Cela dit, je dis "classique usé jusqu'à la corne", mais je n'avais encore jamais lu celui-là. Il a fallu que je le donne à lire à mes 5e pour considérer qu'il était de bon ton, tout de même, que je m'y colle aussi. Rouletabille y fait une entrée en fanfare - Rouletabille, à peine sorti du berceau, d'ailleurs : c'est quand on lit qu'à dix-huit ans, il est déjà brillant reporter d'un journal national qu'on se dit que le bouquin a bien vieilli - pour démêler la tentative de meurtre spectaculaire de Miss Stangerson dans une chambre totalement close. On peut tourner et virer : l'assassin n'a pas pu sortir. Où est donc le bougre ?! Non content de ce premier exploit, ce dernier le renouvelle quelques jours plus tard. C'est à croire qu'il est un fantôme. Ou qu'il n'existe pas. Ou que l'on se joue de nous.
Heureusement, à l'instar de Poirot qui fait fonctionner habilement ses petites cellules grises quand tout le monde hallucine, Rouletabille sait prendre la raison par le bon bout. L'assassin n'a qu'à bien se tenir !
Ah ! Du pouvoir des retardements en pagaille dans les vieux romans policiers ! Voilà un procédé interminable comme on en fait plus ! Dès le début du roman, on comprend que Rouletabille a compris - pas tout certes, mais l'essentiel. Il - ou plutôt le narrateur - se plait bien sûr à esquiver, à tourner autour du pot, à expliquer de mille manières qu'il faut attendre pour l'efficacité de l'enquête. Ici, ce ne sont pas tant les rebondissements qui font tourner les pages sans s'arrêter jusqu'à la fin, que ces interminables retardements. D'une manière ou d'une autre, quoiqu'il en soit, on est pendu à l'identité de l'assassin. Deux avis possibles à la fin : soit on est époustouflé par un twist savoureux, soit on est quand même tenté de se dire que c'est un peu tiré par les cheveux. Je me rangerais plutôt dans la seconde catégorie objectivement, surtout que Rouletabille, tandis qu'il se targue d'user de sa raison, use surtout d'un flair plus que discutable. Il a du bol que ces élucubrations s'avèrent justes, un point c'est tout. Mais puisque j'ai gardé une âme de gosse en lisant ce roman, j'ai gobé quand même l'invraisemblance. Après tout, je ne réclamais pas grand chose : M'évader, m'amuser, me trouver plonger dans une ambiance, une société et des us et coutumes parfaitement désuets qui fleurent bon le vingtième siècle qui vient de naître. J'ai été servie de ce côté-là. En outre, Rouletabille, comme tous les grands détectives littéraires, est un mélange savamment dosé de figure attachante et de prétention surfaite. C'est un parfait Poirot adolescent, sans moustache et avec l'énergie en plus. je n'en demandais pas plus ! Voilà donc un fort bon week-end passé en la compagnie de Rouletabille, Larsan, Darzac et Stangerson. Il ne manque plus que quelques cookies maison pour parfaire le tableau, que je vais m'employer derechef à pâtisser en regardant l'adaptation ciné de Bruno Podalydès ! Noël is comiiiiiing !
14:28 Publié dans Classiques, Littérature française et francophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (10)
20/11/2015
Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier

Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier, XYZ, 2011, 184p. (publié en poche chez Folio)
L'idée de mourir est terrifiante mais qu'est-ce qu'être vieux, au fond ? Finir en maison de retraite, être fliqué pour tout et rien par du personnel fonctionnaire de tout poil ? Merci bien ! Dans Il pleuvait des oiseaux, les ptits vieux décident de faire sécession dans les bois, histoire de vivre la vieillesse à leur façon : non comme une fin ennuyeuse mais comme une nouvelle chance. Au début du récit, lorsque la photographe débarque, elle tombe sur Charlie. Celui-là, avec sa cabane bien rangée, ses tonnes de fourrures et son chien Chummy, a fui les traitements pénibles d'une insuffisance rénale. Le lendemain, le duo improbable, souvent muet, est rejoint par Tom qui se refait une santé sur le tard après une vie dissolue. La photographe est à la recherche d'un troisième homme : Boychuck - dont le prénom est incertain. Elle travaille sur le portrait de toutes les victimes encore en vie des Grands Feux du début du siècle. Boychuck est l'un d'eux, très célèbre pour son errance dans les décombres calcinés, l'air hébété et irrésolu. Manque de pot, Boychuck est déjà/enfin parti : mort de sa belle mort. Pourtant, la photographe a goûté là un environnement qui la séduit, qui semble l'appeler. Elle sait qu'elle reviendra à nouveau à l'ermitage des vieux. Puis une deuxième femme arrive aussi inopinément : c'est Marie-Desneige, escortée par son neveu bienveillant. Elle, elle a décidé de fuir l'hôpital psychiatrique qui la retenait prisonnière depuis tellement de dizaines d'années qu'on ne peut qu'être révolté. Dans ses yeux pétille la connaissance de tout ce qui ne se dit pas. Est-ce vraiment là être fou ?!
Vous faites le calcul : voilà deux donzelles qui percutent la routine bien rangée des hommes solitaires. Un peu de douceur, des silences délicieux, de la motivation, du désir saupoudré sont au menu bien sûr. Et puis, le passé toujours en filigrane.
Au regard de mes autres lectures québécoises ce mois-ci, Il pleuvait des oiseaux est le seul récit dont je connaissais le propos et dont j'avais lu des tonnes de chroniques éparses toujours élogieuses. Un livre qui fait l'unanimité, forcément, ça interpelle. J'étais donc dans une joie frétillante à l'idée de l'entamer. Grave erreur, je pense : cette histoire mignonne n'a pas fait le poids face à mes attentes. L'histoire est mignonne, c'est indéniable. Le propos est plein de bons sentiments et développe une pointe d'originalité au départ et d'optimisme à la fin qui fait forcément du bien par où ça passe. Je me suis tout à fait représenté l'ermitage des ptits vieux et, franchement, j'ai adoré l'idée.
Il m'a néanmoins manqué de la profondeur, une espèce d'épaisseur essentielle pour que ça me touche vraiment au lieu de me faire seulement passer le temps. Avec un tel propos de base, on aurait pu écrire autre chose, m'a-t-il souvent semblé. Je n'ai pas tellement apprécié la forme du récit sous forme de chapitres tout à fait artificiels ni la caricature intersidérale campée par Marie-Desneige. Là où le lien entre les Grands Feux, Boychuck et la peinture aurait pu être passionnant, elle vire à la fabulette amoureuse et à la lecture totalement foireuse de tableaux. Bref, de bonnes idées mais trop de superficialité, trop de mignonnerie et pas assez de couilles, nom d'un petit lapin en mousse !
Disons-le : peut-être aurais-je plus apprécié ce récit à un autre moment, dans une autre humeur ? En l'occurrence, je venais de lire Sorray, le retour au monde peu de temps avant, qui se profilait dans la même veine - de la littérature mignonne qui fait du bien mais qui ne casse pas trois pattes à mémé non plus. Il faut croire que là où j'ai presque tout toléré dans Sorray (parce que précisément, ça m'a fait du bien), j'ai été beaucoup plus critique avec Il pleuvait des oiseaux (parce que j'étais déjà requinquée, merci). On en revient toujours à cette nécessité de bien choisir sa lecture et son moment. Les mauvais timings peuvent être tout à fait fatals...
 Québec en novembre 2015 chez Karine et Yueyin
Québec en novembre 2015 chez Karine et Yueyin
4ème participation
14:48 Publié dans Classiques, Littérature française et francophone, Swap | Lien permanent | Commentaires (14)
26/10/2015
La boîte en os d'Antoinette Peské
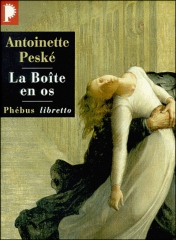
La boîte en os d'Antoinette Peské, Phébus, Libretto, 2001[1984], 204p.
C'est une histoire d'amour et de folie, de songes, de mort, d'aspirations et d'absolu qui se balade de narrateur en narrateur au gré des époques, s'effeuille et se caresse - et si vous avez un feu de cheminée et quelques bougies, c'est encore mieux. Le premier narrateur est un jeune enseignant français de passage à Londres en 1893. Une paire de chaussures excentriques lui rappellent un ami ; et soudain, cet ami apparaît ; jadis étrange, puis fou, puis à nouveau sain d'esprit, l'ami s'emploie alors à narrer sa lente descente dans les abîmes de la passion démente. Au moment où se clôt la boucle de ce triste récit embrassé avec les ombres vacillantes du fantastique, nous ne sommes qu'à la moitié du livre. C'est que l'amour et la folie, les songes, la mort et l'absolu ne connaissent pas les bornes du temps et des boucles ; et lorsqu'on croît que point la fin, c'est en fait l'éternel recommencement qui s'amorce.
La boîte en os est indéniablement de ces récits dans lesquels on chemine sans trop savoir où l'on va et dont on se demande s'ils ont une fin ou non. Il est aussi de ces récits qui se frottent au fantastique sans jamais être aussi complètement dedans qu'on pourrait s'y attendre. Tout est fait de mystères et d'étrangeté irrésolue, et l'on ne sait pas, au fond, quoi en penser. Ce n'est pas un mal ; je crois même que c'est fait exprès. C'est ce qui a fasciné Cocteau qui eut l'heur de redécouvrir La Boîte en os en 1941 après une première parution passée inaperçue en 1931 : ce livre "ne ressemble à aucun autre" et il semble ne tenir qu'au souffle vertigineux d'une plume intranquille et pleine d'inspiration alambiquée. Le fait est, mine de rien, qu'il habite son lecteur un bon moment, par bribes et effluves subtiles. On y repense au détour d'une journée - particulièrement lorsque la nuit tombe. On brûle d'en discuter avec d'autres lecteurs pour connaître telle ou telle impression.
Si je doute que l'on puisse avoir un coup de cœur pour un livre aussi étrange - parce que rien n’agrippe suffisamment pour agripper comme sait le faire un coup de cœur -, c'est surtout un livre rare, au pouvoir de fascination certain. Et je me demande si ce n'est pas encore mieux, finalement.
Ces monts, dont les sommets presque toujours perdus dans la brume font croire qu'ils touchent le ciel, ces lacs de plomb fondu dont les eaux sont si profondes qu'elles semblent être les ouvertures de l'enfer, font subir tour à tour aux passions humaines des envolées et des descentes incroyables. L'Écosse du Nord est je crois, par excellence, le lieu de rêve, de la contemplation intérieure et de l'amour. Est-ce pour cette raison qu'elle est aussi le lieu du diable ? P. 21
19:40 Publié dans Classiques, Fantastique/Horreur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12)




