06/03/2015
Les Vagues de Virginia Woolf
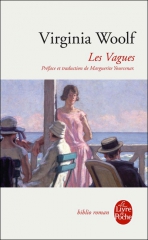
Les Vagues de Virginia Woolf, traduction de Marguerite Yourcenar, Le Livre de Poche, 2004 [1931], 286p.
 A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
Tandis que Mrs Dalloway dilatait le temps au point de faire d'un seul jour l'histoire de tout un roman, Les Vagues resserre les mouvements de l'horloge humaine - et la course du soleil - jusqu'à raconter l'histoire universelle de six consciences éclatées, bercées par le quotidien et pris dans la houle de l'univers entier. Ils sont Bernard, Louis, Neville, Suzanne, Rhoda et Jinny. Nous ne saurons jamais rien d'eux que ce qu'ils veulent bien penser et ressentir à différents âges de la vie. Entre chaque, les vagues éclaboussent le rivage ; le soleil monte et descend au gré d'une jeunesse qui s'épanouit et d'une vieillesse qui se creuse tout doucement.
Souvent, j'aime des romans. Parfois, j'ai même un coup de cœur pour l'un d'eux. Toujours, j'ai conscience d'avoir affaire au produit, bien que talentueux, d'un être aussi humain que moi. Pourtant, tout cela s'efface lorsque je lis Virginia Woolf et, plus particulièrement, lorsque je lis ses romans de la maturité. Je me rappelais avoir été subjuguée il y a quelques sept ans par Les Vagues mais, pour une raison inconnue, Mrs Dalloway restait pour moi son titre phare, son titre le plus abouti en terme l'alchimie entre un projet littéraire périlleux et la nécessité d'embarquer le lecteur. Je crois à présent pouvoir dire que Les Vagues lui est encore bien supérieur à tous points de vue. Pour cela, il m'aura fallu attendre un paquet d'années, il m'aura fallu lire et relire d'autres Woolf, et il m'aura fallu dénicher le moment propice pour revenir à ce titre-ci.
Rien ne se perd, un éclat se crée et tout se transforme. Tel pourrait être l'adage des Vagues. A l'image de chaque jour, la fin n'existe que pour être un nouveau départ : la mort est une transition ; une partie du mouvement perpétuel. Tout ce qui émerge dans l'éclat d'un rayon, le battement d'un cil ou l'éclair d'une conscience est source de création. L'être y apporte sa touche particulière et forme le grand ballet de la vie au sein duquel chaque parcelle d'herbe et de joie a l'importance particulière de révéler l'instant présent.
Je vois très distinctement chaque brin d'herbe. Mais mon pouls retentit contre mes tempes, contre les yeux, avec le bruit d'un tambour. C'est pourquoi tout danse, le filet, l'herbe. Vos visages voltigent comme des papillons ; les arbres ont l'air de bondir. Il n'y a rien d'assuré, rien de définitif dans cet univers. Tout est mouvement, tout est danse ; tout est triomphe et rapidité. p. 53
La vie vient ; la vie s'en va. Nous créons la vie. p. 174
Et Bernard d'ajouter à la toute fin du roman, comme l'ultime saut de ce qui ne connait jamais de point final :
Oui, c'est bien l'éternel renouveau, l'incessante montée qui suit une retombée sans fin.
Et en moi aussi, la marée monte. La vague se gonfle, elle se recourbe. Une fois de plus, je sens renaître en moi un nouveau désir ; sous moi quelque chose de redresse comme le cheval fier que son cavalier éperonne et retient tour à tour. p. 286

La vague de Pierre-Auguste Renoir, 1879
Ce mouvement éternel et perpétuel, c'est aussi celui de l'écriture romanesque. Car nous évoquions le dépouillement progressif de la narration woolfienne ; à tel point qu'on pourrait même se demander pourquoi elle n'en vient pas tout naturellement à la poésie. Pourquoi continuer de recourir à ce qu'on effiloche ? Mais regardons de plus près ces Vagues étonnantes : C'est vrai, nous n'avons plus d'histoire, nous n'avons plus de décor, nous n'avons même plus de personnages. Les consciences narratives ne sont plus que silhouettes incertaines. Woolf a éliminé tout ce qui fait du roman une vaste fumisterie. La construction minutieuse d'une supercherie consentie entre l'auteur et le lecteur. Woolf lève le voile. Vois-tu, semble-t-elle nous dire, il n'y a rien de tout cela. Tout cela est faux et ne sert à rien ; ne dis rien de l'essentiel. Woolf ne garde que le temps précieux du roman : sa capacité à tenir une note sur laquelle tresser les mots merveilleux. Et puis, sur cette note, elle va ajouter quelques autres perles piquées ici ou là - car dépouiller ne veut pas forcément dire laisser nu ensuite : cette succession de monologues intérieurs comme autant de monologues théâtraux et ces réflexions tantôt aériennes tantôt pesantes comme autant de poèmes en prose. Les romans de Woolf ont ce quelque chose de magique qui fait de chaque page le lieu d'une potion où se rencontrent tous les genres.
Partout où il est question de la vie et du temps dans Les Vagues, il est question de l'écriture. Deux consciences ont des velléités littéraires : Neville, le poète byronien qui savoure l'ordre et se languit de l'amour et Bernard, le raconteur d'histoires. Bernard qui compile dans un carnet chaque phrase qui lui vient un beau matin pour s'en resservir plus tard. Bernard qui est le seul des six consciences à devenir narrateur à l'occasion. Bernard, enfin, à qui reviendra la lourde tâche de boucler la boucle du jour/de la vie/du roman, de "faire l'addition" et d'en rouvrir une nouvelle. Mais Bernard qui n'écrit jamais rien en définitive, ne finit jamais aucune histoire :
J'ai inventé des milliers d'histoires ; j'ai rempli d'innombrables carnets de phrases dont je me servirai lorsque j'aurai rencontré l'histoire qu'il faudrait écrire, celle où s'inséreraient toutes les phrases. Mais je n'ai pas encore trouvé cette histoire. Et je commence à me demander si ça existe, l'histoire de quelqu'un. p. 185
Mais les histoires n'existent pas, pas plus que Perceval n'existe. Perceval qui attire et subjugue, qui fait le lien entre tous par une aura que nous ne parvenons pas à saisir, mais qui ne pense pas, ne parle pas. Qui apparait aussi fantomatique qu'un rêve. Perceval, le bien-nommé, est ce héros des romans de jadis, pleins d'héroïsme, d'aventures et de consistance factice. On se raconte des péripéties fabuleuses qui aident à s'endormir et à continuer à vivre. Ainsi Perceval est-il le meneur d'une amitié branlante entre six esprits aux quatre vents. Et puis Perceval meurt brutalement : c'est la mort du grand roman médiéval. A la suite de Bernard, nous sommes invités à remettre en cause l'épopée mystérieuse des histoires romanesques.
Perceval est mort. (Il est mort en Égypte, il est mort en Grèce : toutes les morts ne sont qu'une seule mort.) p. 169

Nymphéas de Claude Monet, 1914-1926
Les Vagues est un roman impossible. Le pari totalement fou de dire ce qui ne peut être dit ou plutôt le pari de le dire d'une manière totalement inédite et si épurée que tout autre écrivain en aurait fait une peau de chagrin à mi-chemin entre l'insipide et l'informe. Mais Virginia Woolf a réussi à en faire LE roman, tenu étroitement et en équilibre, centré très précisément autour de peu de consciences et qui, pourtant, touche à une universalité géniale et absolue. Dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman me semble presque ridicule. Le coup de cœur concerne les bons romans qui m'ont tenue en haleine ou m'ont séduite. Les Vagues m'a fait entrevoir quelque chose de l'ordre du transcendant et du divin. C'est ce qu'on appelle un coup de grâce !
18:06 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (14)
03/03/2015
Le chat qui parlait aux fantômes de Lilian Jackson Braun
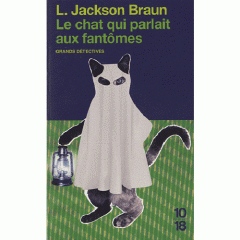
Le chat qui parlait aux fantômes de Lilian Jackson Braun, 10/18, 2011 [1990], 285p.
Dans ce dixième volume de la célèbre série avec chats de Lilian Jackson Braun, Jim Qwilleran - dit Qwill - habite à présent le comté de Moose, à six cents kilomètres au nord de partout (oui, oui) et a hérité de la fortune colossale Klingenschoen qui fait de lui l'homme le plus riche du pays (héritage dont j'ignore tout puisque je suis passée directement du premier tome de la série au dixième par la magie de "je pique ce qu'il y a dans ma PAL hein"). Il habite néanmoins toujours dans un logement modeste, chronique toujours dans le journal local et vit toujours en compagnie de ses chats siamois : le fidèle Koko et la femelle Yom-Yom (spéciale dédicace aux noms improbables et, accessoirement, tout pourris dont on peut affubler, à l'occasion, nos félins compagnons).
Dans ce dixième volume, Qwill était tranquille, était pénard, un dimanche soir vers minuit, à écouter un enregistrement d'Otello de Verdi. Manque de bol, son ancienne gouvernante, Iris Cobb l'appelle paniquée car elle croit entendre des signes d'une présence fantomatique dans le musée qu'elle habite. Ni une ni deux, Qwill déboule à demeure pour la rassurer et l'embarquer en lieu sûr quand il la découvre morte sur le sol de la cuisine. Une crise cardiaque à n'en pas douter. Mais il se pourrait bien que cette crise cardiaque ne soit pas passée par hasard... (Ahaaaaa suspeeeeens)
Vous ne rêvez pas : je suis bien en train de chroniquer la lecture d'une série dont j'avais dit du premier tome qu'il ne cassait pas trois pattes à un canard. La question logique est donc évidemment de se demander ce que je suis allée refaire dans cette galère. Le pire étant que je n'ai aucune réponse valable. Je n'espérais même pas trouver mieux qu'avec Le chat qui lisait à l'envers si tel pourrait pourtant être l'évidence. Non, j'ai simplement empoigné ce titre avec l'assurance - confirmée en l'occurrence - de trouver une lecture dite "détente maximale du neurone fatigué". Ah ça oui, ça détend comme il se doit.
Concrètement, le principal défaut cette fois-ci (car, tout comme la première fois, il y a encore d'indéniables défauts) est la mauvaise gestion du souffle policier. Je m'explique : il faut attendre très précisément la page 98 pour lire Qwill déclarer : "J'ai pour théorie que la mort d'Iris Cobb est une affaire de meurtre." Ah ben enfin, mon canaillou ! Je me demandais quand t'allais cracher le morceau parce qu'autant être clairs : c'est un peu pour ça qu'on est venu !
Les 97 pages précédentes sont donc logiquement à mi-chemin entre l'ennui et le bavardage insipide. Heureusement que Qwill et ses chats sont suffisamment attachants et que j'étais suffisamment fatiguée pour supporter ça.
A partir de la page 97, le rythme monte façon diesel encrassé et ce n'est que dans les 30 dernières pages qu'on se sent ENFIN dans un roman policier sauf que c'est un peu tard et comme il faut boucler l'affaire (il ne saurait être question de pondre un pavé : mieux vaut s'atteler rapidement à un onzième tome de cette série gargantuesque), et bien on la bâcle en bonne et due forme. Résultat : différentes pistes restent inexplorées et en suspens ; la résolution tombe quasiment comme un cheveu sur la soupe avec une précipitation mal venue. Zut ! On s'est tapé la vie du comté de Moose et le menu quotidien des chats en détails depuis le départ et on a même pas eu droit en contrepartie à une intrigue consistante.
Bref, encore une chronique qui donnera très très envie à ceux qui ne connaissent pas la série de la tester, j'en suis certaine ! Ne me remerciez pas : c'est avec plaisir :D
3ème lecture
18:15 Publié dans Challenge, Littérature anglophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (12)





