29/07/2020
L'Education sentimentale de Gustave Flaubert
 Depuis quelques années, je redécouvre Flaubert et plus je le lis/plus je vieillis, plus je l'apprécie. Aussi, je me suis dit qu'il était temps de réessayer L'Education sentimentale qui m'avait rasée il y a quelques quinze ans au point d'en abdiquer la lecture aux alentours de la page 140 (mon nombre de pages fatidique à l'époque). Pour me motiver à réitérer l'expérience dans l'année en cours, j'avais inclus ce titre dans ma pile des 20 pour 2020 (challenge initié sur Instagram par Fanny). Honnêtement, dans les faits, je me voyais moyennement atteindre mon objectif mais deux éléments m'ont finalement décidée à en faire le premier livre des grandes vacances :
Depuis quelques années, je redécouvre Flaubert et plus je le lis/plus je vieillis, plus je l'apprécie. Aussi, je me suis dit qu'il était temps de réessayer L'Education sentimentale qui m'avait rasée il y a quelques quinze ans au point d'en abdiquer la lecture aux alentours de la page 140 (mon nombre de pages fatidique à l'époque). Pour me motiver à réitérer l'expérience dans l'année en cours, j'avais inclus ce titre dans ma pile des 20 pour 2020 (challenge initié sur Instagram par Fanny). Honnêtement, dans les faits, je me voyais moyennement atteindre mon objectif mais deux éléments m'ont finalement décidée à en faire le premier livre des grandes vacances :
1/ J'ai passé l'épreuve folle de relire Le lys dans la vallée de Balzac il y a quelques mois et ça s'est finalement plutôt bien passé. A partir de là, toutes les lectures étaient possibles ;
2/ Electra avait prévu de le lire cet été. J'ai profité de l'occasion pour lui proposer une lecture commune histoire de me motiver. Nous y voilà !
L'Education sentimentale couvre grosso modo 12 ans de la vie de Frédéric Moreau, protagoniste velléitaire, avec une ellipse temporelle finale qui nous projette directement en 1867 dans les tous derniers chapitres conclusifs. En parallèle, et peut-être bien principalement, c'est autant d'années d'existence d'une époque que dépeint Flaubert : celle du déclin de la dernière monarchie française, de l'avènement de la 2ème République puis du Second Empire. Bref, le virage du milieu du XIXème siècle.
Mais revenons-en brièvement à Frédéric pour planter le nœud du récit - extrêmement ténu, soyons clairs, attendu que Flaubert ici ne fait pas dans le roman palpitant à tiroirs. En septembre 1840, Frédéric Moreau, jeune homme de 18 ans rentre à Nogent chez sa mère après une visite chez un oncle dont il brigue l'héritage. Il n'a aucune envie de retourner s'enterrer deux mois dans ce trou avant d'attaquer son droit à Paris, aussi rentre-t-il par la voie la plus longue : le bateau. Durant le trajet, il fait la connaissance d'Arnoux, un marchand d'art à la faconde séduisante mais vulgaire, et de sa femme, la belle madame Arnoux dont il tombe instantanément amoureux. Durant toutes les années qui vont suivre, il n'aura de cesse de se rapprocher du cercle des Arnoux pour fréquenter cette femme simple et belle qui lui inspire tant de respect et un amour aussi constant que sincère sans qu'il ne se passe finalement jamais rien. En parallèle de quoi, il nourrit bien des projets sans jamais aller au bout de rien. Contrairement à son ami d'enfance Deslauriers, Frédéric vit dans une aisance financière suffisante, bien que fluctuante au cours de sa vie, pour ne pas nourrir d'ambition forcenée. Il n'a pas besoin de parvenir, il est déjà un bourgeois installé depuis sa naissance. Aussi, même politiquement, contrairement à Sénécal, très extrémiste dans son engagement par exemple, il ne se mouille pas vraiment. Il suit le mouvement en ne voyant que ce qu'il veut voir. Frédéric, en somme, est l'incarnation de la médiocrité bourgeoise, ce juste milieu qui ne crée ni ne construit rien sans être méchant pour autant (en même temps, il ne manquerait plus qu'il morde). Il est exactement le contraire du Rastignac balzacien auquel l'auteur fait référence avec son ironie subtile et délicieuse au tout début du roman, dans la bouche de Deslauriers :
- Rappelle-toi Rastignac dans la Comédie humaine ! Tu réussiras, j'en suis sûr !
Évidemment, ce sera un échec cuisant à tous points de vue.
Cette existence plutôt insipide est finalement l'occasion de brosser une époque, cette charnière décisive du XIXème siècle. L'esprit romantique incarné par Frédéric atteint ses limites : beaucoup de projets et de rêves, de grandes aspirations (j'allais dire de Grandes espérances) mais aucune inscription véritable dans la société. Beaucoup de bruit pour rien dirait Shakespeare. Voilà. A un moment donné, c'est beau de rêver et de s'exalter mais ça n'aboutit à rien si ce n'est pas nourri d'effets concrets. Rapidement, d'ailleurs, Frédéric laissera tomber ses velléités (parmi d'autres) d'écriture poétique et de création picturale. Littérairement, le virage entre le romantisme et le réalisme est ainsi fait.
Il s’était arrêté au milieu du Pont-Neuf, et, tête nue, poitrine ouverte, il aspirait l’air. Cependant, il sentait monter du fond de lui-même quelque chose d’intarissable, un afflux de tendresse qui l’énervait, comme le mouvement des ondes sous ses yeux. À l’horloge d’une église, une heure sonna, lentement, pareille à une voix qui l’eût appelé.
Alors, il fut saisi par un de ces frissons de l’âme où il vous semble qu’on est transporté dans un monde supérieur. Une faculté extraordinaire, dont il ne savait pas l’objet, lui était venue. Il se demanda, sérieusement, s’il serait un grand peintre ou un grand poète ; — et il se décida pour la peinture, car les exigences de ce métier le rapprocheraient de Mme Arnoux. Il avait donc trouvé sa vocation ! Le but de son existence était clair maintenant, et l’avenir infaillible.
Quand il eut refermé sa porte, il entendit quelqu’un qui ronflait, dans le cabinet noir, près de la chambre. C’était l’autre. Il n’y pensait plus.
Flaubert se concentre aussi sur le portrait politique et social de cet entre-deux du siècle. Ainsi, de longs passages (très intéressants intellectuellement mais je dois vous dire avec honnêteté qu'ils ne sont pas toujours très enthousiasmants pour le lecteur néanmoins...) sont consacrés aux discussions politiques lors desquelles Frédéric, fidèle à lui-même, reste très en retrait et l'on observe de façon distanciée et toujours ironique les motivations révolutionnaires (l'ambition, la domination, l'égalité) des insurrections successives (1848, le coup d’État de Napoléon III).
— Est-ce que les journaux sont libres ? est-ce que nous le sommes ? dit Deslauriers avec emportement. Quand on pense qu’il peut y avoir jusqu’à vingt-huit formalités pour établir un batelet sur une rivière, ça me donne envie d’aller vivre chez les anthropophages ! Le Gouvernement nous dévore ! Tout est à lui, la philosophie, le droit, les arts, l’air du ciel ; et la France râle, énervée, sous la botte du gendarme et la soutane du calotin !
L'auteur nous invite également à déambuler dans nombre de soirées mondaines où d'autres ambitions se découvrent, notamment celles des femmes qui n'ont finalement pas cinquante possibilités à leurs dispositions à l'époque : épouser ou se prostituer. Une mention spéciale pour le personnage de Rosanette, la courtisane qui passe entre tous les bras comme moyen de s'extirper de son effroyable condition d'origine. Celle qui apparaît au départ comme une Marie couche-toi-là écervelée - par opposition à Marie Arnoux, sainte entre toutes, sorte de Mme de Tourvel qui ne flanche pas (il faut dire à sa décharge que Frédéric n'a rien de Valmont) - est en fait d'une complexité intéressante. J'ai particulièrement apprécié que les personnages féminins soient d'une heureuse profondeur, à la fois factuelle et symbolique.
L’affranchissement du prolétaire, selon la Vatnaz, n’était possible que par l’affranchissement de la femme. Elle voulait son admissibilité à tous les emplois, la recherche de la paternité, un autre code, l’abolition, ou tout au moins « une réglementation du mariage plus intelligente ». Alors, chaque Française serait tenue d’épouser un Français ou d’adopter un vieillard. Il fallait que les nourrices et les accoucheuses fussent des fonctionnaires salariés par l’État ; qu’il y eût un jury pour examiner les œuvres de femmes, des éditeurs spéciaux pour les femmes, une école polytechnique pour les femmes, une garde nationale pour les femmes, tout pour les femmes ! Et, puisque le Gouvernement méconnaissait leurs droits, elles devaient vaincre la force par la force. Dix mille citoyennes, avec de bons fusils, pouvaient faire trembler l’hôtel de ville !
(Et hop, un joli discours indirect libre flaubertien comme on les aime ♥)
Le bilan de ma lecture est donc plutôt positif dans la mesure où, intellectuellement parlant, Flaubert coche toutes les cases de ce qui me ravit les neurones : une finesse stylistique sans pareille, une musicalité syntaxique impeccable, une ironie aussi subtile que mordante et un propos ô combien maîtrisé qui s'exprime à travers une construction narrative parfaite. Pour autant, comme je l'ai brièvement mentionné précédemment, ce n'est pas une lecture exaltante. Flaubert a voulu signifier les limites du romantisme, en marquer son essoufflement, et sanctionner le passage d'une ère à une autre ; dont acte. Mon professeur de XIXème à l'université avait résumé L'Education sentimentale en disant qu'il s'agissait d'un roman sur l'ennui - ce qui m'avait marquée, évidemment, parce que ce n'est pas la mise en bouche la plus engageante, n'est-ce pas ! Et en effet, c'est tout à fait ça. C'est tellement bien fait, d'ailleurs, qu'on est pas loin de s'ennuyer régulièrement en le lisant, du coup... Autant vous dire que ce qui m'a sauvée, comme avec Le Lys dans la vallée, c'est d'avoir su lire un certain nombre de passages en lecture rapide. Il n'est pas dit, sinon, que j'aurais tenu jusqu'au bout - ce que je suis ravie d'avoir fait au demeurant, car la conclusion de l'histoire d'amour durable bien que platonique entre Frédéric et Mme Arnoux est vraiment touchante et belle. Vous voilà donc prévenus si vous ambitionnez de vous attaquer à ce monument.
Bien qu’il connût Mme Arnoux davantage (à cause de cela, peut-être), il était encore plus lâche qu’autrefois. Chaque matin, il se jurait d’être hardi. Une invincible pudeur l’en empêchait ; et il ne pouvait se guider d’après aucun exemple puisque celle-là différait des autres. Par la force de ses rêves, il l’avait posée en dehors des conditions humaines. Il se sentait, à côté d’elle, moins important sur la terre que les brindilles de soie s’échappant de ses ciseaux.
A présent, allons lire le billet d'Electra !
Textes de Flaubert précédemment lus et chroniqués : Un coeur simple, Madame Bovary et Salammbô, coup de coeur absolu que je vous encourage à lire absolument ♥
07:30 Publié dans Classiques, Histoire, Lecture commune | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : l'éducation sentimentale, gustave flaubert, xixème siècle, amour, ennui, vélleité, politique, monarchie de juillet, restauration, révolution, art, amour platonique, frédéric moreau, madame arnoux, lecture commune, ironie, louis-philippe
27/06/2020
Bienvenue au club de Jonathan Coe
 Fidèle à son habitude de passer au crible la société anglaise par le petit bout de la lorgnette, Jonathan Coe explore dans ce roman les années 70 pré-Thatcher à travers un groupe d'adolescents, élèves d'un collège très select de Birmingham.
Fidèle à son habitude de passer au crible la société anglaise par le petit bout de la lorgnette, Jonathan Coe explore dans ce roman les années 70 pré-Thatcher à travers un groupe d'adolescents, élèves d'un collège très select de Birmingham.
Benjamin Trotter, indéniablement le protagoniste, est un jeune homme réservé et esthète - d'aucuns diraient timoré, notamment son ami Doug - qui se rêve compositeur ou écrivain. Son père Colin est un des principaux responsables du personnel de LA grande usine de Birmingham, celle-là même qui fait plus ou moins vivre l'essentiel de la population de la ville, et sa sœur Loïs est à la recherche de l'amour au départ, tout simplement.
Le fameux Doug, lui, révèle au fil des années une personnalité beaucoup plus cash et n'hésite pas à prendre des positions politiques très affirmées, trait de caractère qu'il a sans doute hérité de son père Bill, principal délégué syndical de l'usine sus-mentionnée. Autant dire que si Benjamin et Doug sont amis, ce n'est pas exactement le cas de Colin et Bill.
Enfin, Philip développe un goût prononcé pour les arts plastiques tandis qu'il assiste impuissant au fil des années à des manœuvres parfois douteuses de son professeur d'art auprès de sa famille.
Autour de ces trois amis gravitent un nombre incalculable d'autres personnages de tous âges et de tous sexes, surtout à mesure qu'ils vieillissent puisque le lecteur à l'heur de les suivre grosso modo de la 4e à la terminale. J'aime autant vous dire qu'avec les années, l'enjeu féminin augmente significativement, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, dit comme ça, on pourrait craindre le roman fleuve anecdotique avec 8000 noms qu'on ne parviendra pas à retenir et au moins la moitié des personnages dont on n'aura que faire et l'on aurait évidemment tort.
Grâce à une construction narrative extrêmement enlevée et une écriture qui mêle à la perfection concision et ironie, Jonathan Coe réalise le tour de force proprement étonnant de transformer le récit de vies banales en véritable page turner. On se sent avec les personnages, ils semblent être nos amis, notre famille, nos meilleurs ennemis ; ils sont vivants et on les suit avec un mélange d'impatience et d'émotion.
A travers eux, c'est toute la décennie 70 qui passe sur le billard. Ainsi, on voit évoluer les modes vestimentaires et les styles musicaux - des Beatles au rock progressif puis au punk - ; on touche du doigt le racisme et la pudibonderie ; on assiste à la naissance des consciences politiques, d'un bord comme de l'autre, en miroir desquelles se jouent l'émergence capitaliste et conséquemment les grandes grèves qui ont soulevées l'Angleterre avant l'élection de Thatcher, sans parler des problématiques nationalistes exacerbées en Irlande et au Pays de Galles. Tout cet arrière-plan hyper léché par Jonathan Coe est aussi riche que passionnant et rajoute le sel primordial à une liste d'ingrédients déjà savoureux.
Je vais tout de même en rajouter un petit dernier - et ce coup-ci, ce sera la cerise sur le gâteau. Rien n'est laissé au hasard dans un roman de Jonathan Coe. Aussi, le fait qu'il ait été lui-même élève d'un collège royal de Birmingham (King's Edward school dans la vraie vie, King's William dans Bienvenue au club) exactement durant les années 70 et qu'il ait voulu, comme Benjamin, être compositeur et écrivain ne sont pas seulement des coïncidences - pas plus qu'il ne faudrait tomber dans l'écueil autobiographique. L'auteur me semble beaucoup s'amuser des entremêlements complexes entre réalité et fiction, tout comme c'était déjà brillamment le cas dans Testament à l'anglaise. Qu'il y ait dans ces deux romans un personnages d'écrivain, l'un sur le retour, l'autre sur le départ, révèle le jeu même qui s'opère dans le récit avec les arcanes de la littérature. Il faut être attentif aux échos, à la typographie - elle a son importance dans les différents messages qui sont envoyés au fil de Bienvenue au club -, aux voix narratives - on passe du je au il l'air de rien - et puisqu'on change de narrateur, il faut prendre garde aussi aux changements de points de vue, de postures narratives et de styles - je pense particulièrement à la dernière partie du présent roman. Bref, les romans de Jonathan Coe ont autant de couches qu'un oignon et c'est absolument passionnant de les effeuiller. En plus, par chance, Bienvenue au club est le premier titre d'une trilogie ! Je me réjouis donc de retrouver prochainement nos adolescents avec quelques dizaines d'années de plus pour apprécier leurs évolutions.
Romans précédemment chroniqués de Jonathan Coe : La pluie, avant qu'elle tombe et Testament à l'anglaise.
07:16 Publié dans Challenge, Lecture commune, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : bienvenue au club, the rotter's club, jonathan coe, le mois anglais, lecture commune, satire, roman social, années 70, birmingham, adolescence, roman d'apprentissage, musique, écriture, amour, politique, grève
11/06/2020
Jude l'obscur de Thomas Hardy
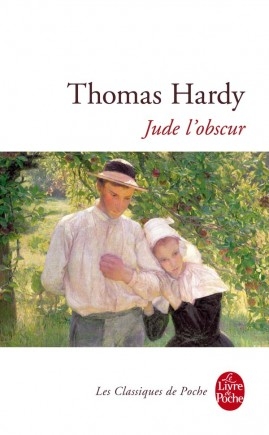 Depuis l'enfance, Jude Fawley rêve de faire des études à l'université. Il n'y est pas destiné, clairement. Il est orphelin et vit de pas grand chose au fin fond de la campagne anglaise, dans un comté inventé par Thomas Hardy, chez une vieille tante boulangère. Néanmoins, Jude est animé d'une véritable soif de connaissance qui lui permet les espoirs les plus fous lorsqu'il observe au loin le cloché de l'une des universités de Christminster. A ce stade du roman, comment ne pas penser au personnage dickensien de Pip dans De grandes espérances ? Les deux héros partagent tous deux une enfance malheureuse dans un milieu social qui ne leur permet pas d'autres horizons que la reproduction d'un déterminisme pathétique et pourtant, ils ont tous deux une soif incommensurable de grandeur, Pip par l'argent, Jude par le savoir.
Depuis l'enfance, Jude Fawley rêve de faire des études à l'université. Il n'y est pas destiné, clairement. Il est orphelin et vit de pas grand chose au fin fond de la campagne anglaise, dans un comté inventé par Thomas Hardy, chez une vieille tante boulangère. Néanmoins, Jude est animé d'une véritable soif de connaissance qui lui permet les espoirs les plus fous lorsqu'il observe au loin le cloché de l'une des universités de Christminster. A ce stade du roman, comment ne pas penser au personnage dickensien de Pip dans De grandes espérances ? Les deux héros partagent tous deux une enfance malheureuse dans un milieu social qui ne leur permet pas d'autres horizons que la reproduction d'un déterminisme pathétique et pourtant, ils ont tous deux une soif incommensurable de grandeur, Pip par l'argent, Jude par le savoir.
Afin de servir ses espérances, Jude apprend seul le grec et le latin durant l'adolescence et lit les grands textes en conduisant une charrette pour le compte de sa tante. Plus tard, il se lance dans l'apprentissage du métier de tailleur de pierres, très prisé à la ville. Jude sait qu'il lui faut de l'argent pour envisager des études et il sait qu'il n'en a pas. Aussi, il en passe par la case travail, vaillamment, plein d'abnégation pour atteindre son but sans entrevoir que cette impossible tentative de concilier son rêve et la réalité est finalement une manière de ne jamais vraiment se lancer. A cet égard, Jude est un peu le négatif de Martin Eden.
D'ailleurs, Jude a un caractère tendre et sentimental. Il n'a pas la froide détermination et l'absolutisme du héros de Jack London pour qui l'amour a été, à un moment, le moteur de ses ambitions. Jude, lui, se laisse séduire malgré lui, au détriment de son temps et de sa volonté. Par Arabella d'abord, une jeune fille vulgaire de son village qui tient absolument à lui mettre la corde au cou, on ne sait pas trop pourquoi. Puis par sa cousine Sue, une jeune femme sans attache comme lui, qui respire la fraîcheur et la désinvolture. Au contact des femmes, Jude oublie son rêve et avec Sue, il se lance à corps perdu dans une histoire touchante, passionnée, rocambolesque et dévastatrice pour tous deux.
Malgré tout ce que j'ai pu lire sur ce roman, je dois reconnaître que ce n'est pas un coup de cœur pour moi. J'en ressors avec du bon et du moins bon. Je vais commencer par le moins bon, histoire de finir ensuite sur une note positive. J'ai trouvé trop de longueurs au début et à la fin de la relation entre Jude et Sue, beaucoup trop de tergiversations stériles et, in fine pour moi, ennuyeuses. N'étant pas grosse lectrice d'histoires d'amour, j'aime quand elles sont franches, puissantes, viscérales. Ici, c'est le cas au cœur de la relation entre nos deux personnages, bien heureusement d'ailleurs (je n'aurais pas fini le livre sinon, honnêtement) mais les atermoiements de début et de fin m'ont semblé interminables. C'est dans ces moments-là que je suis ravie de savoir lire en diagonale. L'écriture de Thomas Hardy, quant à elle, reflète à merveille le caractère de Jude : elle est intelligente, claire, délicate et tendre. Même au cœur de l'horreur, et on traverse quelques moments pas piqués des hannetons dans ce roman, il a le don de laisser filer le style comme l'eau claire d'un ruisseau sur les roches les plus dures. C'est ressourçant la plupart du temps et puis parfois, c'est un peu trop mou...
Néanmoins, j'ai été absolument subjuguée (oui, tant que ça) par la modernité incroyable du propos de Thomas Hardy à l'égard de l'amour, du couple et a fortiori du mariage. Évidemment, il n'est pas le premier écrivain en avance sur son temps. Mais c'est véritablement le premier qui me fait l'effet d'avoir réfléchi avec autant d'avance sur ses contemporains. Ce qu'il écrit à la toute fin du dix-neuvième siècle, en pleine ère victorienne corsetée, n'a pas dix, vingt ni même trente ans d'avance mais bien cent ! C'est absolument époustouflant et courageux. Je n'ose imaginer la volée de bois vert que le roman a dû recevoir à sa parution. Rien que pour ça, franchement, il mérite grandement d'être lu. Ses réflexions sont fines et pertinentes. Nos héros qui ne payaient pas tellement de mine pendant un moment se révèlent des personnages arrivés trop tôt dans un monde trop vieux et c'est précisément cela qui fait toute la tragédie de leur histoire.
D'ailleurs au passage, puisque c'est intrinsèquement lié, la religion en prend aussi pour son grade comme une institution obsolète au service de l'asservissement des masses. Elle aussi à son rôle à jouer dans l'empêchement de Jude et Sue à être heureux. Comment être libre, même d'aimer purement et véritablement, lorsque l'être et conséquemment la société, sont enchaînés à des superstitions scrupuleuses ? Je vous laisse méditer !

Le mois anglais chez Lou et Titine
Journée consacrée à la littérature victorienne
07:39 Publié dans Challenge, Classiques, Lecture commune, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : jude l'obscur, thomas hardy, le mois anglais, littérature victorienne, destin, tragédie, amour, mariage, savoir, études, classe sociale





