13/04/2015
Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs

Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, Bayard Jeunesse, 2011, 444p.
 Depuis toujours, Jacob Portman a entendu les histoires fabuleuses de son grand-père Abe. Ce dernier, juif polonais, s'est réfugié durant la seconde guerre mondiale dans un orphelinat perdu sur une île du Pays de Galles. Il y a vécu une enfance loin des atrocités de la guerre, certes, mais près de compagnons aux pouvoirs étranges et de monstres effrayants. Tout d'abord fasciné par les aventures d'Abe, Jacob prend de plus en plus de distance à mesure qu'il grandit : au fond, ces monstres ne sont-ils pas la version revue et corrigée des nazis par un jeune garçon traumatisé par la guerre ?
Depuis toujours, Jacob Portman a entendu les histoires fabuleuses de son grand-père Abe. Ce dernier, juif polonais, s'est réfugié durant la seconde guerre mondiale dans un orphelinat perdu sur une île du Pays de Galles. Il y a vécu une enfance loin des atrocités de la guerre, certes, mais près de compagnons aux pouvoirs étranges et de monstres effrayants. Tout d'abord fasciné par les aventures d'Abe, Jacob prend de plus en plus de distance à mesure qu'il grandit : au fond, ces monstres ne sont-ils pas la version revue et corrigée des nazis par un jeune garçon traumatisé par la guerre ?
Jusqu'au jour où Jacob se précipite chez son grand-père après que celui-ci l'a appelé paniqué. Il le découvre moribond dans le bois en face de chez lui et, au moment où Jacob lève les yeux, il tombe nez à nez avec une horrible créature... Les monstres existeraient-ils vraiment ?
Si je parviens à maintenir un semblant d'activité de lecture cette année, je me rends bien compte que mon niveau d'exigence littéraire s'amenuise un poil. Clairement, la période actuelle ne se prête que peu aux envolées alambiquées d'un grand classique quand je me couche le soir. Je profite donc de cette nécessité qu'éprouvent mes neurones bouillis de se reposer pour fureter du côté de genres littéraires que je délaisse habituellement, et la littérature ado fait partie de ceux-là.
Et ce n'est pas un mal, ma bonne dame ! Car j'ai découvert à cette occasion ce roman des plu s plaisants et des plus agréables. Il nous fait replonger dans notre adolescence plus si récente puisque le récit se déroule du point de vue de Jacob. Toute la première partie du roman se joue du côté du fantastique : il appartient au lecteur de démêler le vrai du faux et l'ambiguïté est maintenue longtemps sur la question des monstres. Existent-ils vraiment ou sont-ils le fruit de traumatismes divers ? Et puis, progressivement, on glisse du côté de la fantasy et s'ouvre tout un monde parallèle, en marge des lois humaines et des lois temporelles, sur fond de roman initiatique. La fréquentation de Miss Peregrine et de ses enfants particuliers permettra non seulement à Jacob de percer le mystère de son grand-père mais aussi de mieux se comprendre pou partir à l'aventure de soi et du monde.
s plaisants et des plus agréables. Il nous fait replonger dans notre adolescence plus si récente puisque le récit se déroule du point de vue de Jacob. Toute la première partie du roman se joue du côté du fantastique : il appartient au lecteur de démêler le vrai du faux et l'ambiguïté est maintenue longtemps sur la question des monstres. Existent-ils vraiment ou sont-ils le fruit de traumatismes divers ? Et puis, progressivement, on glisse du côté de la fantasy et s'ouvre tout un monde parallèle, en marge des lois humaines et des lois temporelles, sur fond de roman initiatique. La fréquentation de Miss Peregrine et de ses enfants particuliers permettra non seulement à Jacob de percer le mystère de son grand-père mais aussi de mieux se comprendre pou partir à l'aventure de soi et du monde.
Le roman se finit un brin en queue de poisson mais pour une bonne raison : il s'agit du premier tome d'une trilogie ! Si vous aborder maintenant ce roman, vous n'aurez pas à vous inquiéter du délai à attendre pour découvrir la suite en plus puisque le deuxième volume est sorti l'an dernier. Inutile de vous dire que je me suis empressée d'aller le louer dans le foulée et qu'il est déjà entamé (mais ceci sera l'objet d'un autre billet).
Deux autres raisons de ne pas hésiter, en outre : Comme cela a beaucoup été souligné dans d'autres billets, l'objet livre est particulièrement soigné et attractif. L'édition est joliment agrémentée de motifs et de photographies anciennes qui toutes ont un lien avec le récit. Il ne s'agit pas tant d'illustrations que d'une plongée véritable dans l'ambiance du roman. Une vrai réussite qu'il faut saluer ! Enfin, ce roman fera l'objet d'une adaptation cinématographique par Tim Burton en 2016 (avec Eva Green dans le rôle de Miss Peregrine, miam!). Je suis tout à fait impatiente d'en voir le résultat !

 Challenge Un pavé par mois chez Bianca
Challenge Un pavé par mois chez Bianca
Participation d'avril 2015
 Challenge USA chez Noctembule
Challenge USA chez Noctembule
4ème lecture
16:39 Publié dans Challenge, Fantastique/Horreur, Littérature ado, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (8)
27/03/2015
Une saison à Longbourn de Jo Baker
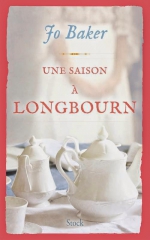
Une saison à Longbourn de Jo Baker, Stock, 2014, 394p.
Après un dépucelage tardif mais hautement apprécié de Jane Austen dernièrement, j'ai décidé de goûter dans la foulée à ma première austenerie. C'est Alice du site Jane Austen is my wonderland (et aussi du blog Books are my wonderland car, quand on aime, on ne compte pas!) qui m'a offert cette opportunité grâce au concours pour fêter les cinq ans de sa plateforme austenienne. Merci Alice !
Une saison à Longbourn de Jo Baker se saisit de la résidence des Bennet d'Orgueil et préjugés (comme le titre l'indique, n'est-ce pas) et invite le lecteur à descendre d'un étage. Ce ne sont plus Lizzy, Jane ou Lydia dont il est abondamment question dans ce roman mais de ces autres personnages de l'ombre à peine ébauchés dans l’œuvre source : les domestiques. On se rappelle bien avoir lu régulièrement chez Austen Mrs Bennett crier "Hiiiiills" à tous bouts de champ (ou plutôt l'entendons-nous dans la série de la BBC ? Je m'y perds) mais jamais on ne la voit longuement, jamais elle ne parle ni n'est décrite. Qu'à cela ne tienne ! C'est là que Jo Baker entre en action. Aux côtés de la respectable et travailleuse intendante évoluent Sarah, une jeune femme pleine de passion et de révolte d'avoir connu un bonheur dont elle est aujourd'hui privée ; la petite Polly encore enfant et déjà corvéable dès l'aube ; et enfin James Smith, le nouvel arrivant au titre de valet dont la caractéristique principale est d'attiser les interrogations de Sarah et de raviver quelques souvenirs de Mrs Hills. Ainsi, en parallèle des idylles et autres péripéties des maîtres, vont se nouer - non à l'identique mais toujours avec une forte inspiration en forme de gentil hommage - les idylles et péripéties des serviteurs

A travers le quotidien de ces personnages, Jo Baker découvre en outre les coulisses de la plus célèbre histoire de la littérature anglaise du XIXème siècle. Tout cela n'est plus si poli, si lisse et si délicat dans Une saison à Longbourn ! Exemple au hasard : les balades dans la boue de Lizzy, expression si éclatante de son indépendance dans O&P deviennent celle d'une forme de mépris des maîtres à l'égard du travail des domestiques : cette fameuse boue est la hantise de Sarah qui se voit obligée de frotter les jupes pendant des heures avant d'en rendre le moindre éclat. Si Lizzy est parfaite et parfaitement moderne, elle est surtout une jeune fille de son rang qui ne s'intéresse qu'occasionnellement et quand elle le veut bien au sort de ceux qui gravitent dans son ombre. Et que dire de de tous les à-côtés d'une vie sans confort ni hygiène à cette époque ? Entre les jours de lessives, la corvée des pots de chambre le matin ou celle des couches des petits Gardiner, on a droit à un vrai florilège de délices entre la cour et la cuisine des Bennet !
Globalement, j'ai plutôt apprécié tout cet envers du décor : on en apprend souvent autant qu'en admirant la surface ! Le roman de Jo Baker se lit très facilement et avec plaisir. Je n'ai pas été gênée par d'éventuelles longueurs sur les différentes tâches - parfois répétitives - de Sarah ou de James car, précisément, c'est ce quotidien que je trouve le plus intéressant dans l'exercice de cette austenerie. Les histoires personnelles plus ou moins cousues de fil blanc (soyons francs) qui se nouent entre eux m'ont beaucoup moins touchée. A cet égard, c'est là qu'on voit l'exercice périlleux de l'austenerie : se confronter, de près ou de loin, à un monstre de la littérature, c'est tout de même prendre le risque que la comparaison ne soit pas en sa faveur. Et de loin. (Oui, j'enfonce des portes ouvertes mais rappelons que c'est ma première lecture du genre) En l'occurrence, là où Jane Austen contournait voire enfonçait les poncifs de la romance à l'eau de rose grâce à une ironie à tous niveaux extraordinaire, Jo Baker en manque cruellement. Du coup, les personnages comme leurs histoires manquent de relief et de véritable intérêt. D'un côté, nous avons donc un chef d'oeuvre, de l'autre, un roman de plage. Ce n'est pas un mal cela dit, il en faut pour tous les moments de lecture et, cette semaine, j'ai grandement apprécié ma lecture de plage (qui s'est transformée en lecture de plaid). Il faut simplement savoir ce qu'on lit, voilà tout !
Mille mercis à Alice et aux éditions Stock pour cette découverte !
17:11 Publié dans Classiques, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (12)
06/03/2015
Les Vagues de Virginia Woolf
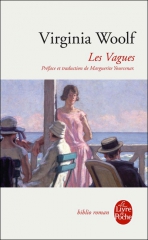
Les Vagues de Virginia Woolf, traduction de Marguerite Yourcenar, Le Livre de Poche, 2004 [1931], 286p.
 A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
Tandis que Mrs Dalloway dilatait le temps au point de faire d'un seul jour l'histoire de tout un roman, Les Vagues resserre les mouvements de l'horloge humaine - et la course du soleil - jusqu'à raconter l'histoire universelle de six consciences éclatées, bercées par le quotidien et pris dans la houle de l'univers entier. Ils sont Bernard, Louis, Neville, Suzanne, Rhoda et Jinny. Nous ne saurons jamais rien d'eux que ce qu'ils veulent bien penser et ressentir à différents âges de la vie. Entre chaque, les vagues éclaboussent le rivage ; le soleil monte et descend au gré d'une jeunesse qui s'épanouit et d'une vieillesse qui se creuse tout doucement.
Souvent, j'aime des romans. Parfois, j'ai même un coup de cœur pour l'un d'eux. Toujours, j'ai conscience d'avoir affaire au produit, bien que talentueux, d'un être aussi humain que moi. Pourtant, tout cela s'efface lorsque je lis Virginia Woolf et, plus particulièrement, lorsque je lis ses romans de la maturité. Je me rappelais avoir été subjuguée il y a quelques sept ans par Les Vagues mais, pour une raison inconnue, Mrs Dalloway restait pour moi son titre phare, son titre le plus abouti en terme l'alchimie entre un projet littéraire périlleux et la nécessité d'embarquer le lecteur. Je crois à présent pouvoir dire que Les Vagues lui est encore bien supérieur à tous points de vue. Pour cela, il m'aura fallu attendre un paquet d'années, il m'aura fallu lire et relire d'autres Woolf, et il m'aura fallu dénicher le moment propice pour revenir à ce titre-ci.
Rien ne se perd, un éclat se crée et tout se transforme. Tel pourrait être l'adage des Vagues. A l'image de chaque jour, la fin n'existe que pour être un nouveau départ : la mort est une transition ; une partie du mouvement perpétuel. Tout ce qui émerge dans l'éclat d'un rayon, le battement d'un cil ou l'éclair d'une conscience est source de création. L'être y apporte sa touche particulière et forme le grand ballet de la vie au sein duquel chaque parcelle d'herbe et de joie a l'importance particulière de révéler l'instant présent.
Je vois très distinctement chaque brin d'herbe. Mais mon pouls retentit contre mes tempes, contre les yeux, avec le bruit d'un tambour. C'est pourquoi tout danse, le filet, l'herbe. Vos visages voltigent comme des papillons ; les arbres ont l'air de bondir. Il n'y a rien d'assuré, rien de définitif dans cet univers. Tout est mouvement, tout est danse ; tout est triomphe et rapidité. p. 53
La vie vient ; la vie s'en va. Nous créons la vie. p. 174
Et Bernard d'ajouter à la toute fin du roman, comme l'ultime saut de ce qui ne connait jamais de point final :
Oui, c'est bien l'éternel renouveau, l'incessante montée qui suit une retombée sans fin.
Et en moi aussi, la marée monte. La vague se gonfle, elle se recourbe. Une fois de plus, je sens renaître en moi un nouveau désir ; sous moi quelque chose de redresse comme le cheval fier que son cavalier éperonne et retient tour à tour. p. 286

La vague de Pierre-Auguste Renoir, 1879
Ce mouvement éternel et perpétuel, c'est aussi celui de l'écriture romanesque. Car nous évoquions le dépouillement progressif de la narration woolfienne ; à tel point qu'on pourrait même se demander pourquoi elle n'en vient pas tout naturellement à la poésie. Pourquoi continuer de recourir à ce qu'on effiloche ? Mais regardons de plus près ces Vagues étonnantes : C'est vrai, nous n'avons plus d'histoire, nous n'avons plus de décor, nous n'avons même plus de personnages. Les consciences narratives ne sont plus que silhouettes incertaines. Woolf a éliminé tout ce qui fait du roman une vaste fumisterie. La construction minutieuse d'une supercherie consentie entre l'auteur et le lecteur. Woolf lève le voile. Vois-tu, semble-t-elle nous dire, il n'y a rien de tout cela. Tout cela est faux et ne sert à rien ; ne dis rien de l'essentiel. Woolf ne garde que le temps précieux du roman : sa capacité à tenir une note sur laquelle tresser les mots merveilleux. Et puis, sur cette note, elle va ajouter quelques autres perles piquées ici ou là - car dépouiller ne veut pas forcément dire laisser nu ensuite : cette succession de monologues intérieurs comme autant de monologues théâtraux et ces réflexions tantôt aériennes tantôt pesantes comme autant de poèmes en prose. Les romans de Woolf ont ce quelque chose de magique qui fait de chaque page le lieu d'une potion où se rencontrent tous les genres.
Partout où il est question de la vie et du temps dans Les Vagues, il est question de l'écriture. Deux consciences ont des velléités littéraires : Neville, le poète byronien qui savoure l'ordre et se languit de l'amour et Bernard, le raconteur d'histoires. Bernard qui compile dans un carnet chaque phrase qui lui vient un beau matin pour s'en resservir plus tard. Bernard qui est le seul des six consciences à devenir narrateur à l'occasion. Bernard, enfin, à qui reviendra la lourde tâche de boucler la boucle du jour/de la vie/du roman, de "faire l'addition" et d'en rouvrir une nouvelle. Mais Bernard qui n'écrit jamais rien en définitive, ne finit jamais aucune histoire :
J'ai inventé des milliers d'histoires ; j'ai rempli d'innombrables carnets de phrases dont je me servirai lorsque j'aurai rencontré l'histoire qu'il faudrait écrire, celle où s'inséreraient toutes les phrases. Mais je n'ai pas encore trouvé cette histoire. Et je commence à me demander si ça existe, l'histoire de quelqu'un. p. 185
Mais les histoires n'existent pas, pas plus que Perceval n'existe. Perceval qui attire et subjugue, qui fait le lien entre tous par une aura que nous ne parvenons pas à saisir, mais qui ne pense pas, ne parle pas. Qui apparait aussi fantomatique qu'un rêve. Perceval, le bien-nommé, est ce héros des romans de jadis, pleins d'héroïsme, d'aventures et de consistance factice. On se raconte des péripéties fabuleuses qui aident à s'endormir et à continuer à vivre. Ainsi Perceval est-il le meneur d'une amitié branlante entre six esprits aux quatre vents. Et puis Perceval meurt brutalement : c'est la mort du grand roman médiéval. A la suite de Bernard, nous sommes invités à remettre en cause l'épopée mystérieuse des histoires romanesques.
Perceval est mort. (Il est mort en Égypte, il est mort en Grèce : toutes les morts ne sont qu'une seule mort.) p. 169

Nymphéas de Claude Monet, 1914-1926
Les Vagues est un roman impossible. Le pari totalement fou de dire ce qui ne peut être dit ou plutôt le pari de le dire d'une manière totalement inédite et si épurée que tout autre écrivain en aurait fait une peau de chagrin à mi-chemin entre l'insipide et l'informe. Mais Virginia Woolf a réussi à en faire LE roman, tenu étroitement et en équilibre, centré très précisément autour de peu de consciences et qui, pourtant, touche à une universalité géniale et absolue. Dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman me semble presque ridicule. Le coup de cœur concerne les bons romans qui m'ont tenue en haleine ou m'ont séduite. Les Vagues m'a fait entrevoir quelque chose de l'ordre du transcendant et du divin. C'est ce qu'on appelle un coup de grâce !
18:06 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (14)




