03/03/2015
Le chat qui parlait aux fantômes de Lilian Jackson Braun
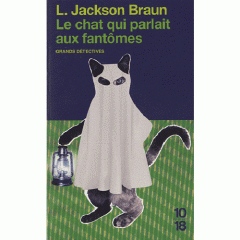
Le chat qui parlait aux fantômes de Lilian Jackson Braun, 10/18, 2011 [1990], 285p.
Dans ce dixième volume de la célèbre série avec chats de Lilian Jackson Braun, Jim Qwilleran - dit Qwill - habite à présent le comté de Moose, à six cents kilomètres au nord de partout (oui, oui) et a hérité de la fortune colossale Klingenschoen qui fait de lui l'homme le plus riche du pays (héritage dont j'ignore tout puisque je suis passée directement du premier tome de la série au dixième par la magie de "je pique ce qu'il y a dans ma PAL hein"). Il habite néanmoins toujours dans un logement modeste, chronique toujours dans le journal local et vit toujours en compagnie de ses chats siamois : le fidèle Koko et la femelle Yom-Yom (spéciale dédicace aux noms improbables et, accessoirement, tout pourris dont on peut affubler, à l'occasion, nos félins compagnons).
Dans ce dixième volume, Qwill était tranquille, était pénard, un dimanche soir vers minuit, à écouter un enregistrement d'Otello de Verdi. Manque de bol, son ancienne gouvernante, Iris Cobb l'appelle paniquée car elle croit entendre des signes d'une présence fantomatique dans le musée qu'elle habite. Ni une ni deux, Qwill déboule à demeure pour la rassurer et l'embarquer en lieu sûr quand il la découvre morte sur le sol de la cuisine. Une crise cardiaque à n'en pas douter. Mais il se pourrait bien que cette crise cardiaque ne soit pas passée par hasard... (Ahaaaaa suspeeeeens)
Vous ne rêvez pas : je suis bien en train de chroniquer la lecture d'une série dont j'avais dit du premier tome qu'il ne cassait pas trois pattes à un canard. La question logique est donc évidemment de se demander ce que je suis allée refaire dans cette galère. Le pire étant que je n'ai aucune réponse valable. Je n'espérais même pas trouver mieux qu'avec Le chat qui lisait à l'envers si tel pourrait pourtant être l'évidence. Non, j'ai simplement empoigné ce titre avec l'assurance - confirmée en l'occurrence - de trouver une lecture dite "détente maximale du neurone fatigué". Ah ça oui, ça détend comme il se doit.
Concrètement, le principal défaut cette fois-ci (car, tout comme la première fois, il y a encore d'indéniables défauts) est la mauvaise gestion du souffle policier. Je m'explique : il faut attendre très précisément la page 98 pour lire Qwill déclarer : "J'ai pour théorie que la mort d'Iris Cobb est une affaire de meurtre." Ah ben enfin, mon canaillou ! Je me demandais quand t'allais cracher le morceau parce qu'autant être clairs : c'est un peu pour ça qu'on est venu !
Les 97 pages précédentes sont donc logiquement à mi-chemin entre l'ennui et le bavardage insipide. Heureusement que Qwill et ses chats sont suffisamment attachants et que j'étais suffisamment fatiguée pour supporter ça.
A partir de la page 97, le rythme monte façon diesel encrassé et ce n'est que dans les 30 dernières pages qu'on se sent ENFIN dans un roman policier sauf que c'est un peu tard et comme il faut boucler l'affaire (il ne saurait être question de pondre un pavé : mieux vaut s'atteler rapidement à un onzième tome de cette série gargantuesque), et bien on la bâcle en bonne et due forme. Résultat : différentes pistes restent inexplorées et en suspens ; la résolution tombe quasiment comme un cheveu sur la soupe avec une précipitation mal venue. Zut ! On s'est tapé la vie du comté de Moose et le menu quotidien des chats en détails depuis le départ et on a même pas eu droit en contrepartie à une intrigue consistante.
Bref, encore une chronique qui donnera très très envie à ceux qui ne connaissent pas la série de la tester, j'en suis certaine ! Ne me remerciez pas : c'est avec plaisir :D
3ème lecture
18:15 Publié dans Challenge, Littérature anglophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (12)
14/02/2015
Orgueil et préjugés de Jane Austen

Orgueil et préjugés de Jane Austen, Le livre de poche, 2011 [1813], 512p.
Ça y est : je l'ai fait ! J'ai enfin lu l'incontournable, le piquant, que dis-je, le roman le plus célèbre de Jane Austen : j'ai nommé, Pride and prejudice (et quelle délicieuse allitération, n'est-il pas ?). J'ai enfin décidé de ne pas douter qu'un célibataire nanti doit être nécessairement à la recherche d'une femme ; j'ai enfin considéré que les breakfast à l'anglaise étaient savoureux ; et, comme tout un chacun (il serait plus juste de dire chacune), j'ai très sérieusement envisagé de me pâmer devant Darcy. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Mais parce que, très simplement, les pirates m'attirent plus de prime abord que les ambiances anglaises à base de thé et de petits gâteaux. De ce fait, j'ai toujours regardé le P&P dans ma PAL (à moitié déchiqueté d'ailleurs, déniché par hasard à 50cts dans une brocante parce qu'"on sait jamais, c'est quand même un classique") avec un regard suspicieux et hautain. Inutile de dire que je souffrais donc moi-même d'orgueil et de préjugés.

Et puis, paf, dès la première page, l'ironie d'Austen me saute au yeux et me fait sourire instantanément. (A propos, je considère que je peux vous faire grâce d'un résumé en bonne et dure forme de l'histoire, hein.) S'il est bien question de mariage à tout bout de champ, c'est sous couvert d'un filtre que le lecteur averti peut aisément déceler pour mieux se délecter de la subtilité des divers niveaux de lecture. Quelle acuité et quelle modernité de Jane Austen dans l'appréciation de mœurs de son époque ! D'autant que cette fameuse ironie se dessine selon toutes les gammes possibles : On frise la caricature à travers les personnages de Mrs Bennett ou de M. Collins, la comédie sociale dans les scènes collectives ou l'analyse psychologique et caustique - souvent déléguée au merveilleux personnage d'Elizabeth.
Parlons, d'ailleurs d'Elizabeth. Je comprends à présent mieux pourquoi ce personnage a tant marqué des générations de lectrices. A travers elle aussi, Austen affiche une décoiffante modernité. Qu'il soit envisageable qu'une jeune femme célibataire puisse à ce point affirmer sa pensée et faire preuve de liberté et de franchise - dans le respect des mœurs évidemment, Elizabeth est un personnage féminin moderne, pas une rebelle écervelée - et que ce personnage ait été créé par une femme également célibataire, tout cela apparaît particulièrement subversif et d'un féminisme avant l'heure éclairé et rafraîchissant. Je n'aurais typiquement pas eu cette lecture d'Elizabeth très jeune , je pense, n'ayant pas alors le recul nécessaire quant à l'histoire littéraire et à l'Histoire tout court. Il est donc heureux que P&P m'ait attendue si longtemps (et hop, on se dédouane comme on peut de découvrir un classique sur le tard).

Quant à Darcy. Ah, Darcy. Sacré Darcy, devenu le parangon du parfait British prince charmant (j'hallucine d'ailleurs passablement du nombre de romance à trois balles qui utilisent sans vergogne la veine Darcy. Jane Austen doit s'en étrangler depuis un paquet d'années). Voyons, voyons. Bien sûr, comment ne pas tomber amoureuse de Darcy ? Mais très franchement, j'ai quand même gardé suffisamment de lucidité pour constater qu'on commence franchement à tomber amoureuse de lui quand il devient peut-être moins passionnant et mystérieux. Globalement, d'un point de vue littéraire, du point de vue de cette ironie austenienne si mordante, c'est sans doute la première partie qui se lit avec le plus de délice. A partir de la deuxième, on en revient doucement à une lecture premier degré - ou il serait plus juste de dire que, chez le lecteur, c'est clairement la lecture premier degré qui prend le dessus sur l'autre - et l'on guette avidement le moindre signe de rapprochement entre Darcy et Elizabeth, non sans s'identifier à Elizabeth (ahahaha). Dans mon cas, la littéraire a adoré la première partie et la gonzesse a dévoré la seconde. Au fond, Darcy est assez typique : Le bel homme fier, plein de mystère et de non-dit, d'une beauté à faire fleurir un artichaut, qui subjugue tout le monde - positivement ou pas - sans décrocher un seul mot. Et paf ! Dans le mille. Même le renversement progressif du type est lui aussi un type : sous le mystère, se cache la perfection (C'est moi où on est presque chez Disney ?). Là où le personnage tire son épingle du jeu, c'est lorsqu'il tombe amoureux d'un audacieux esprit libre comme Elizabeth Bennett. Celle-là, on ne l'attendait et celle-là est vraiment bien bonne. Le fait que les deux personnages masculins les plus éclairés du roman - M. Bennett et Darcy - accordent leur préférence à Elizabeth est une fameuse caution (pour l'époque) que l'audace, l'intelligence et la franchise s'élèvent bien au-dessus de la beauté, de la vanité et de la docilité.

Néanmoins, si Darcy est le parfait prince charmant, il est aussi la parfaite tarte à la crème lorsqu'il s'agit de l'incarner à l'écran. J'espérais être plus indulgente à l'égard de Matthew MacFadyen, en revoyant l'adaptation de Joe Wright après lecture du roman, mais il n'en est malheureusement rien. Je lui trouve le charisme d'un beignet ; or, un Darcy qui ne respire pas l'orgueil n'est pas un bon Darcy. Colin Firth est évidemment la référence en la matière et il faudra se lever tôt pour l'égaler. Mais même si je le trouve supérieur en tout point, je ne le trouve pas impeccable de bout en bout. Ces scènes de silence où Darcy ne parle que par son regard sont décidément bien casse-gueule. Allez, cela dit, j'avoue tout : Colin Firth a quand même fini en fond d'écran de mon ordinateur. C'est officiel : je suis passée du côté fleuri de la force.
Lu en lecture commune avec ma copine blogueuse du royaume de fort fort lointain, Topinambulle. Allons voir sa chronique !

 Doublé gagnant chez Bianca (ça faisait longtemps) pour le pavé du mois de février et le 20eme titre à avoir lu
Doublé gagnant chez Bianca (ça faisait longtemps) pour le pavé du mois de février et le 20eme titre à avoir lu
13eme lecture
 Challenge mélange des genres chez Miss Léo
Challenge mélange des genres chez Miss Léo
Catégorie Classique étranger
09:49 Publié dans Challenge, Classiques, Lecture commune, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (20)
12/01/2015
Le Problème Spinoza d'Irvin Yalom

Le Problème Spinoza d'Irvin Yalom, Le Livre de Poche, 2014, 541p.
Irvin Yalom est psychiatre de formation, certes, et ses romans le chante à toutes les pages avec jubilation. Mais il est aussi connu pour un violon d'Ingres particulier : la philosophie. Son approche des mystères de l'âme humaine se dessine bien souvent par le truchement de quelques figures philosophiques majeures, sorte de flambeaux sur le chemin sombre de l'existence (et Dumarsais d'acquiescer depuis les nuages). Aussi, après Nietzsche, Schopenhauer (dont le titre est dans ma PAL ; j'aurai sans doute le plaisir de vous en parler prochainement), c'est auprès de Spinoza qu'il nous convie pour réfléchir sur un concept qui n'a jamais été autant d'actualité : la liberté.
 N'ayons pas peur des mots : Spinoza avait une sacrée paire de couilles. Ou une Raison de fort beau gabarit. Ou les deux.
N'ayons pas peur des mots : Spinoza avait une sacrée paire de couilles. Ou une Raison de fort beau gabarit. Ou les deux.
Car si les Pays-Bas étaient réputés, dès le XVIIe siècle, pour être le pays le plus tolérant d'Europe, il ne fallait pas trop pousser mémé dans les orties - d'autant que la tolérance du gouvernement n'était pas forcément la tolérance des communautés qui composaient le pays. Ainsi donc, il ne faisait pas bon oser réfléchir sur les tenants et les aboutissants de Dieu ; il ne faisait pas bon remettre en cause une humanité divine ou les miracles prétendus des textes fondateurs. Un tel usage impie de ses petites cellules grises vaudra à Spinoza une excommunication à vie de la communauté juive d'Amsterdam ; excommunication qu'il accepte, qu'il a désirée même, afin de consacrer ses années futures à la réflexion philosophique et à la contemplation de la nature. C'est ce cheminement vers le dépouillement, vers la solitude, qui est avant tout un cheminement vers la liberté profonde de penser et de s'exprimer, que conte Yalom dans son présent roman.
 Comme une ambition n'arrive par ailleurs jamais seule, l'auteur ne s'arrête pas là. Force est de constater, comme il le précise dans sa postface, que la vie éminemment contemplative de Spinoza posait la question d'une dynamique narrative à trouver. Yalom la saisit en la personne d'Alfred Rosenberg dont il tresse l'existence à celle du philosophe. Tandis que Spinoza chemine vers l'affirmation, toute pacifiste, de son individualité, Rosenberg s'engouffre dès son plus jeune âge dans la recherche belliqueuse d'un ralliement extrémiste. Il sera un antisémite convaincu à partir d'une lecture de Chamberlain et ne cessera jamais de prôner la suprématie allemande et le nécessaire retour à une pureté de la race. C'est tout à fait logiquement qu'il sera l'un des premiers aux côtés d'Hitler, fidèle à l'homme comme à la doctrine, jusqu'à ce que le tribunal de Nuremberg le condamne à la pendaison. Il était par ailleurs un très grand amateur de philosophie et c'est de cet attrait que Yalom tisse le lien avec Spinoza : Rosenberg aurait été obsédé par cet intellectuel extraordinaire, et pourtant juif. Voilà bien un cruel dilemme qu'il se devait tôt ou tard de démêler en dérobant la bibliothèque du philosophe durant la guerre. Au fur et à mesure de cette quête, où toujours Spinoza se dessine en filigrane, c'est aussi la psychanalyse de l'extrémiste qui se joue. Au fond, l'auteur livre deux trajectoires radicalement opposées puisque Rosenberg n'aura de cesse de vouloir appartenir, de vouloir sentir enfin la plénitude d'être enraciné dans une communauté (d'élites, cela va de soi).
Comme une ambition n'arrive par ailleurs jamais seule, l'auteur ne s'arrête pas là. Force est de constater, comme il le précise dans sa postface, que la vie éminemment contemplative de Spinoza posait la question d'une dynamique narrative à trouver. Yalom la saisit en la personne d'Alfred Rosenberg dont il tresse l'existence à celle du philosophe. Tandis que Spinoza chemine vers l'affirmation, toute pacifiste, de son individualité, Rosenberg s'engouffre dès son plus jeune âge dans la recherche belliqueuse d'un ralliement extrémiste. Il sera un antisémite convaincu à partir d'une lecture de Chamberlain et ne cessera jamais de prôner la suprématie allemande et le nécessaire retour à une pureté de la race. C'est tout à fait logiquement qu'il sera l'un des premiers aux côtés d'Hitler, fidèle à l'homme comme à la doctrine, jusqu'à ce que le tribunal de Nuremberg le condamne à la pendaison. Il était par ailleurs un très grand amateur de philosophie et c'est de cet attrait que Yalom tisse le lien avec Spinoza : Rosenberg aurait été obsédé par cet intellectuel extraordinaire, et pourtant juif. Voilà bien un cruel dilemme qu'il se devait tôt ou tard de démêler en dérobant la bibliothèque du philosophe durant la guerre. Au fur et à mesure de cette quête, où toujours Spinoza se dessine en filigrane, c'est aussi la psychanalyse de l'extrémiste qui se joue. Au fond, l'auteur livre deux trajectoires radicalement opposées puisque Rosenberg n'aura de cesse de vouloir appartenir, de vouloir sentir enfin la plénitude d'être enraciné dans une communauté (d'élites, cela va de soi).
Jusque là, vous le voyez bien, tout semble délicieux. C'est ce qu'on peut appeler un projet aux petits oignons. Malheureusement, je ne suis pas aussi enthousiaste que j'ai pu l'être avec Et Nietzsche a pleuré. L'ambition, pour le coup, était peut-être un peu trop forte, ou bien les contours du lien entre Spinoza et Rosenberg mal établis en amont. Toujours est-il que, si le roman se lit toujours avec un certain plaisir, il manquait ici une légèreté, un entrain pour que la lecture devienne passionnante - voire pertinente. Le problème Spinoza pèche à mon sens par excès de zèle didactique et se révèle beaucoup trop souvent calibré comme un mauvais dialogue socratique. Je ne vais pas mentir : oui, il m'a permis d'aborder un Spinoza bien vulgarisé, moi qui n'ai jamais réussi à passer les vingt premières pages de L’Éthique. Mais puisqu'il s'agit sur ce blog de traiter de littérature, concentrons-nous sur ce point et convenons en toute sincérité que ces pseudos échanges philosophico-psychanalysants à répétition, tous construits sur le même modèle et avec les mêmes protagonistes, finissent pas être d'un ennui patenté. Qu'il faille saluer la noblesse et l'ampleur du projet, c'est une évidence, mais que celui-ci ne nous empêche pas de convenir que le résultat n'est pas exactement à la hauteur. Sans doute, précédemment, la personnalité explosive et solaire de Nietzsche avait-elle facilité une dynamique narrative plus dyonisiaque, montrant ainsi la philosophie et l'exploration de l'âme humaine comme des aventures passionnantes. Dyonisos, avec Le problème Spinoza a baillé, s'est barré et sirote une bière bien loin d'ici. Ce n'est pas ma faute.
 Challenge 1 pavé par mois chez Bianca
Challenge 1 pavé par mois chez Bianca
2eme participation pour janvier
2eme lecture
19:16 Publié dans Challenge, Histoire, Littérature anglophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (10)







