Rechercher : woolf
Orlando de Virginia Woolf
Préambule lyrique à la romancière impeccable, à la parfaite magicienne ès Lettres anglaises.
Ô brillante, piquante et perspicace Virginia ! Je crois prétentieusement te connaître et voilà que tu me surprend encore. Comment ?! Tu n'as pas écrit que de sublimes livres où le temps file avec un brin d'angoisse ? Tu sais aussi t'amuser de quelques facéties d'apparence légères ? Mais alors, tu n'as laissé aucun talent à personne, petite coquine surdouée ! Je ne peux que me pâmer devant ce génie total qui jamais ne déçoit. Malgré ta tête de poisson chafouin, il n'y a pas à dire : personne ne t'arrive à la cheville !
*
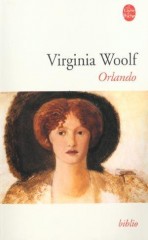
Orlando de Virginia Woolf, ed. Le livre de poche, 319p.
Orlando naît au XVIe siècle sous les traits d'un maladroit jeune homme plein de fougue et de promesses. Lorsqu'il ne profite pas de sa côte d'enfer auprès de la reine Elizabeth, il vaque avec mélancolie sur ses terres anglaises, et il pense, et il écrit. Déjà, le démon (ou le dieu, qui sait?) de la poésie l'étreint fermement. Mais la poésie, mes aïeux, n'est pas une carrière digne d'un homme de son rang et certaines moqueries se chargeront de le lui rappeler. Il écrit donc en secret et c'est sur son sein qu'il cache son précieux manuscrit. Au gré de cette plume frénétique, les siècles filent comme l'éclair ! Orlando, lui, est toujours là, bientôt en Turquie où il devient ambassadeur de la couronne et fait bombance à plaisir.
Puis ce qui devait arriver arriva : Orlando ne se réveille plus pendant une semaine après une fête assommante. Tout le monde s'alarme mais pas de panique : il n'est pas mort, seulement en train de changer de sexe (normal quoi). En cette fin de XVIIe, Orlando devient femme avec le plus grand naturel, rejoint une troupe de bohémiens jusqu'à se faire rattraper par l'appel du Verbe et rentre enfin en Angleterre. Elle (puisqu'à présent, c'est ainsi qu'il faut désigner Orlando) a pour projet d'y trouver la vie et un amant dans un XVIIIe siècle en pleine effervescence intellectuelle, expression ravissante d'une liberté éclairée pleine d'élan. Tout ceci en attendant l'époque victorienne, plombante à mourir certes, mais qui lui offrira d'être enfin reconnue pour sa plume séculaire.
Autant vous le dire tout de suite (mais vous l'aurez déjà compris à la lecture de mon préambule lyrique à trois balles) : ce livre est EXTRAORDINAIRE. Il n'est pas juste bon ou excellent, il est au-dessus de tout le reste du gratin. Il est un peu comme cet imbattable macaron framboise/violette à 15€ pièce pour lequel vous vendriez père et mère sans hésitation. Bon, je vous rassure, ici vous n'aurez besoin de vendre personne vu le prix très abordable du Livre de Poche et vous passerez un moment de pure jouissance littéraire, j'en mets ma main au feu.
Commençons par le commencement : Ce livre est drôle. Oui, mesdames, messieurs, Virginia Woolf n'a pas écrit que des livres très sérieux (certains diront chiants comme la pluie, mais il ne faut pas les écouter bien sûr), elle a aussi écrit l'Orlando que voilà. Remontons un peu le temps et comprenons en quelques mots le projet de l'auteur : Virginia Woolf venait de finir La promenade au phare en 1927, roman pour lequel elle a le plus puisé dans son histoire familiale, en tout cas, de la manière la moins déguisée. Et comme toujours après un roman, Virginia était plombée physiquement et moralement. A cette même époque, elle entretient une vive amitié (que beaucoup de commentateurs pensent plus qu'ambigüe) avec Vita Sackville West, également écrivain et notoirement bisexuelle. Dans l'optique d'une parenthèse légère dans l'écriture (parce que Mrs Dalloway et La promenade au phare, fallait quand même se les écrire, chers amis), elle imagine une facétie littéraire comme un hommage à la sensualité, la liberté, l'esprit opulent et original de son amie sous la forme de ce personnage androgyne et poétique. Le projet était donc clairement un intermède dans son travail d'écrivain, un aparté drôlatique.
Aussi, n'y cherchez pas, je vous prie, une quelconque cohérence, une once de véracité (comme j'ai pu le lire dans une chronique lue au hasard sur la toile). Ce livre n'est pas un ouvrage de SF où la construction d'un monde se présente comme plausible au lecteur. Ici, de bout en bout, tout n'est que prétexte au jeu littéraire et au déguisement de propos plus sérieux. Certains personnages traversent les siècles comme Orlando, d'autres pas, des évènements surviennent sortis de nulle part... Tout ceci n'a aucune importance. Tout ceci est un décor de théâtre en carton pâte.
Et donc, disais-je, on rit, on sourit fréquemment - mais certainement pas de gags gratuits : Chaque trait d'esprit est un clin d'oeil à l'endroit de la littérature, de l'Histoire, des sexes, de l'amour, de la société, de la nature. Tout y passe dans un florilège de perspicacité et de subtilité.
Même si ça reste du Woolf avec de longues phrases poétiques à points virgule, pléthore de références intertextuelles diverses, et du snobisme saupoudré un peu partout, il n'en reste pas moins que c'est un tel bonheur de lecture ! Elle offre un regard tellement frais et décalé sur le travail d'écrivain, sur les problématiques de la création, sur la vie en général, la contemplation, la nature et la mélancolie qu'on boit son verbe avec le sourire de la jouissance pure et parfaite.
Je clos ici mon exposé dithyrambique (veuillez m'excusez, je suis à 300% concernant Virginia Woolf), en espérant qu'il vous donnera l'envie folle d'aller tester Orlando !
 Challenge Un classique par mois
Challenge Un classique par mois
Mai 2012
Ce billet fonctionne aussi de manière rétroactive pour les challenges 2013 :
 "Lire avec Geneviève Brisac" chez Anis (Litterama)
"Lire avec Geneviève Brisac" chez Anis (Litterama)
 et le Challenge Virginia Woolf chez Lou
et le Challenge Virginia Woolf chez Lou
*
Extrait :
"Pour nous résumer, et contrairement au romanciers qui peut prendre le temps de défroisser la soie chiffonnée et tout ce qui en découle, nous dirons qu'Orlando était un gentilhomme atteint par l'amour de la littérature. [...]
En ces jours de solitude, la maladie gagna rapidement en force. Il lisait souvent six heures d'affilée dans la nuit et, quand on venait chercher ses ordres pour l'abattage du bétail ou la récolte de l'orge, il respoussait le folio qui l'absorbait et n'avait pas l'air de comprendre ce qu'on lui disait. Les choses allaient donc assez mal et cela fendait le coeur de Hall, le fauconnier, de Giles, le palefrenier, de Mrs Grimsditch, l'intendante et de Mr Dupper, le chapelain. Un beau gentilhomme comme lui, disaient-ils, n'avait que faire des livres. Qu'il laisse les livres, disaient-ils, aux paralytiques et aux moribonds.
Mais le pire était encore à venir. Une fois que la maladie de la lecture exerce son emprise sur l'organisme, elle l'affaiblit tant que l'individu devient une proie facile pour cet autre fléau qui gîte dans l'encrier et couve sous la plume. Le malheureux se met à écrire. C'est déjà grave chez un pauve homme qui n'a pour tout bien qu'une chaise et une table sous un toit qui prend l'eau (après tout, il n'a pas grand chose à perdre), mais cette condition devient extrêmement pitoyable quand elle touche un homme riche qui possède des maisons et du bétail, des servantes, des ânes et du linge, et se met à écrire malgré tout.
La saveur de toutes ces choses le déserte ; il est criblé de pointes de feu, rongé par la vermine. Il donnerait jusqu'à son dernier sou (telle est la malignité du germe) pour écrire un seul petit livre et se retrouver célèbre ; mais tout l'or du Pérou ne peut lui acheter le trésor d'un vers bien tourné. Si bien qu'il finit poitrinaire et malade, il se fait sauter la cervelle, il tourne son visage contre le mur. Peu importe l'attitude dans laquelle on le retrouve. Il a franchi le seuil de la Mort, il a connu les flammes de l'Enfer."
03/05/2012 | Lien permanent | Commentaires (6)
Avec vue sur l'Arno de E. M. Forster
Bonheur : s'éveiller à Florence, ouvrir les yeux sur une pièce éclatante et nue, sur le carrelage rouge, si propre d'aspect bien que les carreaux ne le soient pas, sur le plafond peint où des griffons roses et de bleus amours jouent dans une forêt de violons et de bassons jaunes. Plus grand bonheur encore : ouvrir longuement ses fenêtres, se pincer les doigts dans des trucs inaccoutumés, s'accouder enfin au soleil, face à la beauté des collines, des jardins, des églises de marbre, avec, juste au-dessous, l'Arno gargouillant contre le quai qui borde la route.
Oui mais voilà : au départ, Lucy Honeychurch et Miss Bartlett n'ont pas les chambres avec vue promises par la Signora Bertolini. Dans cette pension-là, on se croirait à Londres. Tout le monde est anglais, les souverains sont accrochés au mur et l'étiquette habituelle est de rigueur. Autant dire que lorsque Mr Emerson et son fils proposent d'échanger leurs chambres avec celles des deux jeunes femmes pour les arranger, c'est l'indignation générale ! Quel culot ! - mais l'idée est trop tentante et elles finissent par accepter après moult tractations. Elles tâchent tout de même par la suite de se tenir aussi éloignées que possible de ces deux originaux, avec plus ou moins de succès, et frayent à l'occasion avec d'autres personnages hauts en couleurs. Un événement, pourtant, les amènera à un départ précipité pour Rome où elles terminent assez rapidement leur tour d'Italie. De retour en Angleterre, tout ce petit microcosme se retrouve pour boire le thé et préparer le mariage de Lucy avec Cecil Vyse, rencontré à Rome - jusqu'à ce que George Emerson repointe le bout de son museau.
J'ai lu des avis assez tranchés sur ce classique anglais - soit ça passe, soit ça casse - et franchement, il s'en est fallu de peu que je rentre dans la seconde catégorie. Les premiers chapitres ont été excessivement laborieux : j'ai trouvé les situations décrites d'un inintérêt déconcertant, les réflexions anecdotiques et la syntaxe parfois franchement aléatoire (d'aucuns diront que c'est carrément mal écrit - ou mal traduit). J'ai traîné ce pénible sentiment de lecture suffisamment longtemps pour envisager d'arrêter les frais. Un dernier chapitre et je m'arrêterai là, me suis-je dit, si ça ne prend pas meilleure tournure, et c'est à ce moment que la lumière m'est apparue - ou devrais-je dire l'ironie mordante et la modernité stylistique impressionnante d'E.M.Forster. Entendons-nous bien : je me suis tout de même ennuyée par moment, mais comme il m'arrive honnêtement de m'ennuyer avec Austen. J'aurais toujours, je crois, cette pointe d'ennui latent à la lecture des romans anglais qui décortiquent le petit monde bien comme il faut d'une certaine société policée, quel que soit le talent à l'exercice pour cela. Mais cet ennui tout personnel mis à part, E.M.Forster est objectivement un génie.
Ce soir-là, et toute la nuit, les eaux s'écoulèrent. Au matin, l'étang avait repris ses dimensions et perdu sa splendeur. Mais il avait été l'appel lancé au libre abandon corporel - passagère bénédiction, dont l'influence pourtant ne passe pas, envoûtement, sainteté, calice, un instant, de jeunesse.
Ce que j'avais interprété à tort comme une syntaxe aléatoire est en fait un exercice de style poétique - une déconstruction savante et expérimentale, parfois bancale du coup, j'en conviens, mais tout de même extrêmement stimulante et fascinante, de la langue vers une recréation des images et des formes. Cela donne lieu à des fulgurances poétiques pour peindre tel ou tel paysage. Et que dire des sentiments, et que dire des discours qui évoluent en liberté comme des bulles de champagne ? Forster, ne se prive pas, à l'occasion, d'interpeller son lecteur ou de le perdre.
Ce que j'avais interprété à tort comme des situations inintéressantes et des réflexions anecdotiques sont en fait des boîtes à double fond. Il y a la surface et il y a les coulisses de l'ironie et elles-mêmes sont à plusieurs niveaux. Comme Austen, Forster fait tantôt preuve d'une ironie discrète, fine, qui vibre doucement comme une petite musique et tantôt, il se permet du cinglant sans concession. Pourquoi faire dans la dentelle quand on peut décaper tout le monde ? Certains passages, franchement, sont à mourir de rire - les titres de chapitres rentrent également dans cette catégorie. Dans ces moments-là, l'enfantin prend le dessus. A bas les filtres ! Soyons désinvoltes !
Dans cette lignée de toutes les libertés, Forster fait preuve d'une modernité d'idées en plus de sa modernité de ton et de style - notamment à l'égard du rôle de la femme, de l'amour et du mariage. Un vent de fraîcheur et d'émancipation gagne les espaces jusqu'ici corsetés par le long règne de Victoria. Edward est à présent sur le trône ; il est temps de profiter de la vie. Le chemin est long pour que Lucy se permette tout à fait de s'ouvrir à ces enchantements et à cet enthousiasme. Avec vue sur l'Arno est son cheminement - et en cela, publié en 1908, il est le parfait roman d'apprentissage de la femme moderne, en plus d'être un manifeste d'écriture nouvelle qui brise les codes également corsetés du roman traditionnel (je vous ai dit que Forster était un grand ami de Woolf ?). Alors, ok, parfois c'est un peu ennuyeux, mais c'est aussi décoiffant de génie et ça rachète tout !
La vie se raconte aisément - vivre déconcerte davantage.
Merci Delphine ! Sans toi, il aurait traîné encore longtemps dans mes envies de lecture et ç'aurait été dommage !
08/12/2018 | Lien permanent | Commentaires (12)
Les Vagues de Virginia Woolf
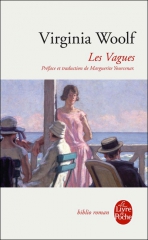
Les Vagues de Virginia Woolf, traduction de Marguerite Yourcenar, Le Livre de Poche, 2004 [1931], 286p.
 A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
Tandis que Mrs Dalloway dilatait le temps au point de faire d'un seul jour l'histoire de tout un roman, Les Vagues resserre les mouvements de l'horloge humaine - et la course du soleil - jusqu'à raconter l'histoire universelle de six consciences éclatées, bercées par le quotidien et pris dans la houle de l'univers entier. Ils sont Bernard, Louis, Neville, Suzanne, Rhoda et Jinny. Nous ne saurons jamais rien d'eux que ce qu'ils veulent bien penser et ressentir à différents âges de la vie. Entre chaque, les vagues éclaboussent le rivage ; le soleil monte et descend au gré d'une jeunesse qui s'épanouit et d'une vieillesse qui se creuse tout doucement.
Souvent, j'aime des romans. Parfois, j'ai même un coup de cœur pour l'un d'eux. Toujours, j'ai conscience d'avoir affaire au produit, bien que talentueux, d'un être aussi humain que moi. Pourtant, tout cela s'efface lorsque je lis Virginia Woolf et, plus particulièrement, lorsque je lis ses romans de la maturité. Je me rappelais avoir été subjuguée il y a quelques sept ans par Les Vagues mais, pour une raison inconnue, Mrs Dalloway restait pour moi son titre phare, son titre le plus abouti en terme l'alchimie entre un projet littéraire périlleux et la nécessité d'embarquer le lecteur. Je crois à présent pouvoir dire que Les Vagues lui est encore bien supérieur à tous points de vue. Pour cela, il m'aura fallu attendre un paquet d'années, il m'aura fallu lire et relire d'autres Woolf, et il m'aura fallu dénicher le moment propice pour revenir à ce titre-ci.
Rien ne se perd, un éclat se crée et tout se transforme. Tel pourrait être l'adage des Vagues. A l'image de chaque jour, la fin n'existe que pour être un nouveau départ : la mort est une transition ; une partie du mouvement perpétuel. Tout ce qui émerge dans l'éclat d'un rayon, le battement d'un cil ou l'éclair d'une conscience est source de création. L'être y apporte sa touche particulière et forme le grand ballet de la vie au sein duquel chaque parcelle d'herbe et de joie a l'importance particulière de révéler l'instant présent.
Je vois très distinctement chaque brin d'herbe. Mais mon pouls retentit contre mes tempes, contre les yeux, avec le bruit d'un tambour. C'est pourquoi tout danse, le filet, l'herbe. Vos visages voltigent comme des papillons ; les arbres ont l'air de bondir. Il n'y a rien d'assuré, rien de définitif dans cet univers. Tout est mouvement, tout est danse ; tout est triomphe et rapidité. p. 53
La vie vient ; la vie s'en va. Nous créons la vie. p. 174
Et Bernard d'ajouter à la toute fin du roman, comme l'ultime saut de ce qui ne connait jamais de point final :
Oui, c'est bien l'éternel renouveau, l'incessante montée qui suit une retombée sans fin.
Et en moi aussi, la marée monte. La vague se gonfle, elle se recourbe. Une fois de plus, je sens renaître en moi un nouveau désir ; sous moi quelque chose de redresse comme le cheval fier que son cavalier éperonne et retient tour à tour. p. 286

La vague de Pierre-Auguste Renoir, 1879
Ce mouvement éternel et perpétuel, c'est aussi celui de l'écriture romanesque. Car nous évoquions le dépouillement progressif de la narration woolfienne ; à tel point qu'on pourrait même se demander pourquoi elle n'en vient pas tout naturellement à la poésie. Pourquoi continuer de recourir à ce qu'on effiloche ? Mais regardons de plus près ces Vagues étonnantes : C'est vrai, nous n'avons plus d'histoire, nous n'avons plus de décor, nous n'avons même plus de personnages. Les consciences narratives ne sont plus que silhouettes incertaines. Woolf a éliminé tout ce qui fait du roman une vaste fumisterie. La construction minutieuse d'une supercherie consentie entre l'auteur et le lecteur. Woolf lève le voile. Vois-tu, semble-t-elle nous dire, il n'y a rien de tout cela. Tout cela est faux et ne sert à rien ; ne dis rien de l'essentiel. Woolf ne garde que le temps précieux du roman : sa capacité à tenir une note sur laquelle tresser les mots merveilleux. Et puis, sur cette note, elle va ajouter quelques autres perles piquées ici ou là - car dépouiller ne veut pas forcément dire laisser nu ensuite : cette succession de monologues intérieurs comme autant de monologues théâtraux et ces réflexions tantôt aériennes tantôt pesantes comme autant de poèmes en prose. Les romans de Woolf ont ce quelque chose de magique qui fait de chaque page le lieu d'une potion où se rencontrent tous les genres.
Partout où il est question de la vie et du temps dans Les Vagues, il est question de l'écriture. Deux consciences ont des velléités littéraires : Neville, le poète byronien qui savoure l'ordre et se languit de l'amour et Bernard, le raconteur d'histoires. Bernard qui compile dans un carnet chaque phrase qui lui vient un beau matin pour s'en resservir plus tard. Bernard qui est le seul des six consciences à devenir narrateur à l'occasion. Bernard, enfin, à qui reviendra la lourde tâche de boucler la boucle du jour/de la vie/du roman, de "faire l'addition" et d'en rouvrir une nouvelle. Mais Bernard qui n'écrit jamais rien en définitive, ne finit jamais aucune histoire :
J'ai inventé des milliers d'histoires ; j'ai rempli d'innombrables carnets de phrases dont je me servirai lorsque j'aurai rencontré l'histoire qu'il faudrait écrire, celle où s'inséreraient toutes les phrases. Mais je n'ai pas encore trouvé cette histoire. Et je commence à me demander si ça existe, l'histoire de quelqu'un. p. 185
Mais les histoires n'existent pas, pas plus que Perceval n'existe. Perceval qui attire et subjugue, qui fait le lien entre tous par une aura que nous ne parvenons pas à saisir, mais qui ne pense pas, ne parle pas. Qui apparait aussi fantomatique qu'un rêve. Perceval, le bien-nommé, est ce héros des romans de jadis, pleins d'héroïsme, d'aventures et de consistance factice. On se raconte des péripéties fabuleuses qui aident à s'endormir et à continuer à vivre. Ainsi Perceval est-il le meneur d'une amitié branlante entre six esprits aux quatre vents. Et puis Perceval meurt brutalement : c'est la mort du grand roman médiéval. A la suite de Bernard, nous sommes invités à remettre en cause l'épopée mystérieuse des histoires romanesques.
Perceval est mort. (Il est mort en Égypte, il est mort en Grèce : toutes les morts ne sont qu'une seule mort.) p. 169

Nymphéas de Claude Monet, 1914-1926
Les Vagues est un roman impossible. Le pari totalement fou de dire ce qui ne peut être dit ou plutôt le pari de le dire d'une manière totalement inédite et si épurée que tout autre écrivain en aurait fait une peau de chagrin à mi-chemin entre l'insipide et l'informe. Mais Virginia Woolf a réussi à en faire LE roman, tenu étroitement et en équilibre, centré très précisément autour de peu de consciences et qui, pourtant, touche à une universalité géniale et absolue. Dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman me semble presque ridicule. Le coup de cœur concerne les bons romans qui m'ont tenue en haleine ou m'ont séduite. Les Vagues m'a fait entrevoir quelque chose de l'ordre du transcendant et du divin. C'est ce qu'on appelle un coup de grâce !
06/03/2015 | Lien permanent | Commentaires (14)
Nuit et jour de Virginia Woolf
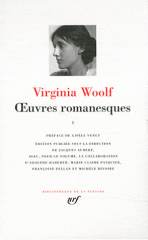
Nuit et jour de Virginia Woolf, traduction de Françoise Pellan, ed. Pléiade, 2012 [1919], 442p.
"C'était un dimanche d'octobre, en fin d'après-midi, et, comme bien d'autres jeunes filles de son milieu, Katharine Hilbery servait le thé".
Ainsi s'ouvre le deuxième roman de Virginia Woolf sur une touche anecdoctique savoureuse et plongeant in medias res le lecteur dans une scène de la bourgeoisie londonienne - procédés qui préfigurent le fameux incipit de Mrs Dalloway sur le même ton, "Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself". Nous y voilà donc encore, ou devrais-je dire "déjà" pour respecter la chronologie d'écriture, dans cet univers typiquement woolfien : Un Londres huppé mais crépusculaire où une galerie de personnages reflète les mille éclats de l'humanité et incarne le fil tendu d'une société entre une ère victorienne rigide et un XXeme siècle bouleversant.
Ici, se croisent quatre jeunes gens, deux hommes et deux femmes dans toute une série de salons, de parcs, de rues et de dîners. On peut même noter quelques réunions intellectuelles où l'on discute de poésie ou de Droit, non sans rappeler les réunions de Bloomsbury qu'organisait la fratrie Stephen. Katharine Hilbery ouvre et ferme le roman et, de fait, sa figure irradie de pages en pages qu'elle soit effectivement présente ou pas. Trentenaire et fille unique d'une illustre famille, elle est l'incarnation de celle qui saisit les autres mais qui ne se saisit pas elle-même. Son erreur est d'être née dans un temps et une famille où la tradition, les conventions sont une prison. Une voie lui semble toute tracée mais à laquelle elle ne souscrit pas. Tandis qu'on l'attend dans le rôle de secrétaire d'une biographie de son grand-père ou dans celui d'épouse chaleureuse et dévouée, Katharine veut la liberté avant tout et rêve de mathématiques. Il ne lui sied guère de s'engager pour une cause, ni de s'engager du tout. Elle est sans nulle doute égoïste, et elle n'écoute que rarement les personnes qui lui parlent. Elle ne connaît pas l'amour. Katharine évolue sur un fil, dans la peur perpétuelle de chuter et de se perdre tout à fait à force d'être pressée de tous côtés.
Pressée notamment par deux hommes : William Rodney, un littérateur engoncé de convenances, souvent prétentieux et risible, au physique peu attrayant mais non dépourvu d'élégance. A force d'effusions poétiques enflammées - qui ont la vertu d'ennuyer Katharine plus que de l'émouvoir -, cette dernière finit par accepter sa demande en mariage. Une acceptation raisonnable.
Quant à Ralph Dehnam, il est un clerc de notaire sans le sou mais érudit, ambitieux et passionné. Il va, lui aussi, tomber sous le charme de Katharine dès la première entrevue sans toutefois se l'avouer (évidemment). Sa relation avec sa muse rêvée se fera sur le mode de la distance et de nombreuses contrariétés.
Enfin, notre quatrième personnage et seconde femme est Mary Datchet. C'est en son honneur que Points a mis une suffragette en couverture de son édition du roman. Femme libre et volontaire, elle habite seule et gagne sa vie comme secrétaire d'une association de lutte pour le vote des femmes. Et bien sûr, afin de boucler la boucle des Feux de l'amour de cet ouvrage, elle éprouve rapidement des sentiments pour son ami Ralph Dehnam.
Vous l'aurez compris, ce roman se joue sur le terrain des sentiments - quels qu'ils soient -, de l'amour et du mariage. Bien que tout cela peut sembler d'une futilité déconcertante, le registre sur lequel joue Virginia Woolf évite de nombreux écueils. Je ne vous mentirai pas : il y a bien sûr des scènes, parfois un peu longuettes, entre A et B qui aime C mais qui pense à D qui lui-même meurt d'amour pour A. Néanmoins, elles sont un prétexte, ou plutôt le point de départ de ce style d'écriture - ici sous une facture encore classique et très ordonnée -, que l'auteur développera dans La Chambre de Jacob jusqu'à l'aiguiser tout à fait à partir de Mrs Dalloway : le monologue intérieur. Plus qu'ils ne dialoguent, les personnages s'interrogent, ressentent, traversent les heures, les lieux et les émotions. Et Virginia Woolf s'intéressent surtout à saisir ces instants fugaces et silencieux qui se renouvellent perpétuellement en l'être. Même si, dans ce deuxième roman, elle éprouve encore une certaine frilosité à envoyer tout à fait valser l'ordonnance de la narration (ce qui donne d'ailleurs un ton assez suranné au récit, étonnant pour qui a d'abord lu des romans de la maturité de l'auteur), on saisit très clairement où se situe son véritable intérêt. Et elle le fait déjà merveilleusement bien. Le lecteur est plongé au coeur de cette chimie intérieure qu'est la formation de l'amour ou comment un être peut passer par mille pensées, mille colorations d'esprit, mille questionnements profonds ou futiles avant de s'amuser d'une évidence aussi flagrante que le sentiment amoureux. Comment il n'est pas possible de parler de certitude dès lors qu'on parle d'humain. Comment tout est toujours fragile, incertain, multiple, en mouvement.
"Il avait la sensation étrange d'être à la fois le phare et l'oiseau ; il était solide et brillant ; et en même temps, il était pris comme le reste dans une tourmente qui l'envoyait s'assommer contre la vitre."
Et puis, dualité que j'aime particulièrement chez Woolf, c'est le caractère éminemment social de son oeuvre. Car certes, il y a une focalisation délicieuse sur les intériorités mais également un aperçu saisissant de l'Angleterre à une période charnière de son Histoire. Dans ce roman, il est surtout question de l'éclatement progressif des conventions victoriennes à travers une jeunesse féminine qui aspire - au droit de vote des femmes, à une chambre à soi, à une possibilité de se réaliser en dehors du mariage - en un mot : à la liberté. Ce n'est pas tant strictement le vote des femmes qu'interroge Woolf mais plus largement la place de la femme dans la société et son propos, comme le reste de son oeuvre le montrera, se prononce sans conteste en faveur d'une évolution nécessaire.
"C'est la vie qui compte, rien d'autre que la vie - le processus de la découverte -, ce processus éternel et incessant, et non la découverte elle-même".
Je pense que ce roman est surtout intéressant pour des connaisseurs de l'oeuvre de Woolf, en ce qu'il éclaire rétrospectivement un certain nombre de préoccupations, tant formelles que fondamentales, qui jalonneront tous ses autres ouvrages. Pour ceux qui découvrent l'auteur avec ce roman (ou son précédent et donc premier paru, La traversée des apparences), il faut bien avoir en tête que sa facture n'est pas représentative de ce que l'écriture de Woolf deviendra à partir du roman suivant. Celui-ci est encore très calibré, la progression diégétique et chronologique est apparente et d'une grande clarté. La prise de parole et les flux de conscience des personnages également (ce qui explique sans doute d'ailleurs les centaines de pages que voilà qui tendront par la suite à se resserrer au maximum pour ne plus garder que la substantifique moelle des êtres.) Dans Mrs Dalloway et, a fortiori, dans Les Vagues, tout cela aura disparu au profit d'une écriture encore plus poétique et éthérée.
Bref (parce que je ne vais pas écrire un roman non plus), un ouvrage intéressant et non dénué de charme, de style et de pertinence mais sans doute un poil trop long et un poil trop conventionnel pour moi qui aime la Woolf libérée du carcan narratif. Je vous conseille néanmoins de le découvrir car il reste un roman de Woolf, c'est-à-dire un roman nécessairement au-dessus de tout ce qui a pu être écrit d'autre (la fille pas fan de Woolf déjà, hein).
Bonne lecture !

Londres, Le Parlement. Trouée de soleil dans le brouillard de Claude Monet, 1904
 Lu dans le cadre d'une lecture commune d'une oeuvre de Woolf pour le mois anglais de Lou et Titine
Lu dans le cadre d'une lecture commune d'une oeuvre de Woolf pour le mois anglais de Lou et Titine
3eme participation du coup !
 Challenge Virginia Woolf chez Lou
Challenge Virginia Woolf chez Lou
3eme participation
 Challenge Lire avec Geneviève Brisac chez Anis
Challenge Lire avec Geneviève Brisac chez Anis
4eme participation
15/06/2013 | Lien permanent | Commentaires (26)
Mrs Dalloway de Virginia Woolf
On le dit souvent durant les années universitaires : "Tu verras, les oeuvres sur lesquelles tu bosses pour ton mémoire, tu n'y retoucheras plus avant un moment, quel que soit l'amour et l'admiration que tu leur portes. Une sorte de deuxième effet kiss cool de les avoir trop lues et décortiquées pendant un ou deux ans." Et je dois dire, malgré la circonspection que cela m'inspirait à l'époque, que je n'ai pas échappé à la règle : je n'avais donc pas retouché depuis plusieurs années à Mrs Dalloway, un des trois romans sur lequel portait mon mémoire de littérature comparée. Dieu sait pourtant que je voue un culte sans borne à l'auteur et à ce livre en particulier mais il faut croire que l'effet mémoire n'épargne rien ni personne. Il finit heureusement par s'estomper avec le temps et c'est donc comme deux vieux amants se retrouvent après une longue absence que j'ai refait connaissance avec Mrs Dalloway.

Mrs Dalloway de Virginia Woolf, ed. Folio Classique, traduction de Marie-Claire Pasquier, 1925, 327p. (dont 58 d'introduction)
L'étape du résumé sera extrêmement courte pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien à résumer. Non pas qu'il ne se passe rien, bien au contraire - il se passe l'essence même de la vie - mais à l'image du refus de Woolf pour le roman réaliste empesé qui recréait une réalité purement factive, elle ne s'intéresse point tant aux actes et aux évènements qu'aux consciences. Ainsi donc, le roman retrace certes une fameuse journée de juin de Mrs Dalloway mais au fond, vous n'en apprendrez pas grand chose. Car ce n'est pas cette réception qu'elle organise qui est intéressante, pas plus que les petits faits qui auraient pu s'y greffer mais le personnage de cette femme mûre aux allures de geai, cette Mrs Dalloway entre deux âges et entre deux périodes de sa vie qui "se sentait très jeune ; et en même temps, incroyablement âgée. Elle tranchait dans le vif, avec une lame acérée ; en même temps elle restait à l'extérieur, en observatrice. Elle avait le sentiment, en regardant passer les taxis, le sentiment d'être loin, loin, quelque part en mer, toute seule ; elle avait perpétuellement le sentiment qu'il était très, très dangereux de vivre, ne fût-ce qu'un seul jour." Et autour de cette femme, de nombreux personnages au gré de son mouvement, que le lecteur suit en un flux ininterrompu de pensées, de réflexions tantôt purement anecdotiques tantôt d'une fulgurante poésie. Parmi eux, le jeune Septimus Warren Smith au nez en bec d'aigle (tous deux des oiseaux, voyez-vous) - héros de guerre aujourd'hui plongé dans une folie mystique. Pour lui aussi, vivre est devenu la plus difficile des épreuves, incompris même par sa propre femme qui aurait préféré qu'il soit mort au front plutôt que de devenir ça.
La première évidence qui me saute au yeux tandis que je relis Mrs Dalloway est qu'il fait partie de ces romans qu'il faut absolument lire dans un état d'esprit favorable, une disposition d'esprit particulière. Rien ne sert de se motiver à sa lecture en se disant qu'il s'agit d'un "classique qu'il faut avoir lu". Je crois vraiment qu'il vaut mieux ne jamais le lire du tout plutôt que de s'y forcer sous peine de s'y ennuyer encore plus que devant un Derrick (et c'est une amoureuse de Woolf qui vous le dit). De la même manière qu'il s'agit d'un roman de sensations, d'émotions, d'impressions fugaces, il faut soi-même être ouvert à tous ces petits éléments silencieux et d'une infime délicatesse et bien comprendre qu'on ne trouvera rien ici qui tient d'une histoire.(Et c'est encore pire si vous lisez Les vagues, d'ailleurs)
Au fond, le phrasé de Virginia Woolf se lit comme on lirait un recueil de poésie, avec cette même attention aux détails sensibles et cette même suprématie de l'intériorité.
Qui est cette Clarissa Dalloway ? Une femme aux mille facettes comme l'est chacun d'entre nous. Est-elle cette femme un peu précieuse, un peu snob, qui organise avec habileté une réception dans la plus pure tradition anglaise - corsetée de petits riens ? Après tout, Peter Walsh ne dit-il pas avec ironie qu'elle a toujours été "la parfaite hôtesse"? Est-elle cette jeune fille de Bourton, qui se protégeait d'un drap d'insensibilité malgré sa fraîcheur adolescente ? Est-elle cette mère incertaine, cette femme mariée à Richard Dalloway, cette amoureuse de Londres, cette femme sereine ou cette femme qui pourrait mourir d'un instant à l'autre ? Mrs Dalloway est tout cela à la fois car elle caractérise la fragilité émouvante du vivre de chaque être humain ; de la vie même de Virginia Woolf aussi, surtout.
Pourtant, au gré des heures frappées par Big Ben et de "ces cercles de plomb qui se dissolvent dans l'air", l'auteur appose en parallèle de cette balade à la fois "initiatique et nostalgique", l'empreinte de spectres plus noirs : ceux de la folie et de la mort. Ce n'est pas Mrs Dalloway qui plonge dans ce gouffre - elle reste toujours en équilibre sur le fil ténu de la vie. Ce qui la retient précisément sur ce fil est exploré douloureusement par son double cathartique, le vétéran Septimus Warren Smith. Et là où Virginia Woolf se révèle d'un génie fulgurant, c'est qu'elle ne se contente pas de creuser avec Septimus les affres de ces noirs continents qu'elle connaissait elle aussi par périodes. Elle en profite pour faire le procès d'une Angleterre pétrifiée par sa gloire et son Histoire qui ne sait pas évoluer au sortir de la première guerre mondiale. On sent bien présente à de nombreuses reprises cette grande guerre dont chacun porte encore le douloureux fardeau : "Entre le début et la fin de la phrase, il s'était passé quelque chose. Quelque chose de si ténu, dans certains cas, qu'aucun instrument de mesure, fût-il capable d'enregistrer un séisme en Chine, n'aurait pu en recueillir les vibrations ; d'une plénitude impressionnante, pourtant, et suscitant une émotion collective ; car chez tous les chapeliers et chez tous les tailleurs, de parfaits inconnus échangèrent un regard et se mirent à penser aux morts ; au drapeau ; à l'Empire. [...] Car, en disparaissant, l'agitation de surface déclenchée par le passage de l'automobile avait effleuré quelque chose de très profond." Malheureusement, loin d'en tirer des leçons d'évolution, l'Empire se drape dans son rôle de vainqueur, se solidifiant ainsi qu'une statue :"Des garçons en uniforme, armés, avançaient au pas en regardant droit devant eux, au pas, les bras raides, avec sur le visage une expression qui rappelait les légendes gravées sur le socle des statues, ces légendes qui vantent le devoir, la gratitude, la fidélité, l'amour de l'Angleterre". Et sous cet apparent hommage, on ne peut que constater que la jeunesse porte en elle les morts de la guerre et la mort même d'une certaine Angleterre au lieu de porter un avenir florissant.
Et puis, Woolf fustige aussi ce pays qui rend hommage à ses héros uniquement s'ils sont morts et qui oublie savamment les autres, allant jusqu'à traiter comme des parias ceux qui ont l'indécence de souffrir de shell shock. Elle en profite évidemment pour faire aussi le procès de la médecine psychiatrique de l'époque qui n'avait rien de salvateur. Ainsi le suicide de Septimus face à ses "médecins" qui n'écoutent pas, clament qu'il n'a rien, qu'il faut simplement "lui changer les idées" sonne comme une condamnation de l'auteur à leur égard.
"Il ne restait que la fenêtre, la fenêtre de la grande pension de Bloomsbury ; et la corvée assommante, pénible et plutôt mélodramatique d'ouvrir la fenêtre et de se jeter dehors. C'est l'idée qu'ils se faisaient de la tragédie, pas lui ou Rezia (car elle était de son côté). Holmes et Bradshaw aimaient ce genre de choses. (Il s'assit sur le rebord). Mais il attendrait jusqu'au dernier instant. Il ne voulait pas mourir. La vie était belle. Le soleil chaud. Mais les êtres humains... Descendant l'escalier d'en face, un vieil homme s'arrêta pour le regarder. Holmes était à la porte. "Vous l'aurez voulu!" s'écria Septimus, et il se jeta avec vigueur et violence, en bas sur les grilles de Mrs Filmer."
Je m'étais promis de ne pas écrire une chronique trop longue faite de réminiscences universitaires mais aussi concise que j'ai tentée d'être, ce roman fourmille de tellement de significations, tellement de mots sous les mots que je me suis laissée emporter. J'espère néanmoins que c'était plus intéressant qu'assommant et que ces quelques phrases vous donneront envie, un jour, de plonger dans un des livres les plus fascinants de la littérature anglaise du XXe siècle. Mais surtout, surtout, ne vous y forcez pas (j'ai lu trop de chroniques ahurissantes et blasphématoires - oui, oui - de lectrices qui ne savaient visiblement pas à quoi elles s'attaquaient et on fait un honteux amalgame entre leur ennui de lecture et l'absence d'intérêt du roman. Sans commentaire hein.)
Et si enfin, l'appel du livre vous prend, entre un rayon de soleil et la brise entre les feuilles d'un coquelicot, je vous souhaite de sentir comme j'ai senti l'éclatante permanence des êtres sous la mouvance des apparences.
 2eme participation au Challenge Virginia Woolf chez Lou
2eme participation au Challenge Virginia Woolf chez Lou
 3eme participation au Challenge "Lire avec Geneviève Brisac" chez Anis (Litterama)
3eme participation au Challenge "Lire avec Geneviève Brisac" chez Anis (Litterama)
 Challenge "Les 100 livres à avoir lus" chez Bianca
Challenge "Les 100 livres à avoir lus" chez Bianca
Billet rétroactif 3
11/03/2013 | Lien permanent | Commentaires (8)
Entre les actes de Virginia Woolf
S'envoler, s'enfuir dans l'incandescence pleine du silence de l'été...
Depuis des années, il ne me restait plus qu'un roman de Virginia Woolf à découvrir. Le tout dernier, celui qui mettrait un point final à mes premières fois romanesques avec cette auteure. Alors évidemment, j'attendais le bon moment, l'instant pas du tout prémédité où je le sortirais de ma bibliothèque comme une évidence ; ce serait l'affaire d'une image, d'une lumière, d'un regard par dessus la fenêtre : et hop, le déclic.
On pouvait se promener à loisir de long en large, à l'ombre des arbres. Ils poussaient en groupes de deux ou trois ; puis de manière plus espacée. Leurs racines crevaient la pelouse, et parmi ces ossements coulaient des cascades de verdure, s'étalaient des coussins de gazon où poussaient les violettes au printemps et l'orchidée pourpre sauvage en été.
Entre les actes, c'est un espace-temps : un manoir de campagne entre Londres et la mer joliment nommé Pointz Hall (et c'est ainsi que le roman a longtemps eu vocation de s'intituler ; Woolf fidèle à elle-même modifiait bien souvent ses titres dans la dernière ligne droite) et l'affaire d'une journée durant laquelle une pièce de théâtre doit avoir lieu en plein air "s'il ne pleut pas" à l'occasion d'une fête commémorative. Dans cet unique lieu et cette unique journée vont se succéder les consciences d'une galerie de personnages sur le seuil du bonheur, de la vieillesse, de la foi, de l'épanouissement, de la création. Les consciences, comme toujours chez Woolf, semblent saisies dans un perpétuel balancement, dans une oscillation inconfortable mais fertile car c'est de cet équilibre précaire, sans cesse renouvelé, qu'émanent les dialogues entre les êtres, les pensées butinées, et le pouvoir créatif.
Nous-mêmes, nous-mêmes !
Les enfants sautaient, caracolaient, bondissaient. Renvoyant des éclats brefs, aveuglants, ils dansaient, ils sautaient. Voici un nez.... Voilà une jupe... juste un pantalon... Voici peut-être un visage... Nous-mêmes ? Mais c'est cruel, de nous prendre en instantané tels que nous sommes, avant que nous n'ayons eu le temps de nous... Et aussi, de nous saisir seulement en morceaux.
La narration n'est pas une voix, mais une circulation, le flux de plusieurs voix qui, abordées respectueusement dans leur individualité, se trouvent unifiées par la langue, par l'art. Nous sommes - et le "nous" émerge d'ailleurs dans ce texte comme une nouveauté chez Woolf, bien plus habituée au "je" - au cœur d'une réunion : Ensemble, imprimant à la cohérence du groupe, ce "nous", les reliefs intimes et particuliers de chaque "je". Le groupe est éphémère, réuni à l'occasion d'une pièce, il devra, on le sait dès le départ, se disséminer prochainement. Cette annonce de la dissémination est d'ailleurs martelée par l'usage poétique de la répétition que Woolf explore particulièrement dans ce texte et qui confère à l'ensemble le rythme de la circularité : de même que tout être est à la fois un tout et la partie d'un tout, l'instant présent est saisi dans sa pleine suffisance et comme le maillon d'un cycle éternellement recomposé.
Le gramophone gargouilla Unité - Dispersion. Il gargouilla Un... Dis... et s'arrêta.
L'entre-deux des consciences, cette circulation au-delà des barrières narratives est aussi un entre-deux des genres : Woolf l'explorait déjà dans Les vagues où la distinction entre roman et poésie se révélait obsolète ; elle la réitère ici en mêlant le roman au théâtre (et la poésie, évidemment, est loin d'être évacuée pour autant). Miss La Trobe rédige et donne à voir un drame/pastiche en trois actes censé retranscrire les temps forts de la société anglaise. On ne peut manquer d'y lire l'ironie vibrante qui caractérise si bien Virginia Woolf : les stéréotypes y sont déconstruits par le rire de la caricature et l'idée d'une permanence du passé se trouve confrontée de manière cinglante au présent incertain.
Ils glissaient, se faufilaient entre les tiges, argentés ; roses ; dorés ; tachetés ; mouchetés ; éclaboussés.
"Nous-mêmes", murmura-t-elle. et, retrouvant dans l'eau grise une lueur de foi, avec bon espoir mais sans grand secours de la raison, elle suivit des yeux les poissons, tachetés, rayés, marbrés ; elle vit dans cette vision la beauté, la puissance et la gloire qui sont en nous.
Tout est poreux. Le théâtre, par essence l'art qui donne à voir et à entendre simultanément à la pluralité du public, s'insinue au cœur du roman, qui se donne à lire dans la quiétude du silence et de la solitude. L'art, en ce qu'il recèle toutes les richesses de l'éternel renouvellement, est à la fois ce qui unit - ce "nous" respectueux de chacun - et qui agglomère : il faut rappeler ici que le texte de Woolf se déroule en juin 1939 et a été écrit entre 1938 et 1941. Ainsi les scansions injonctives de La Trobe au micro à l'adresse de ses comédiens est l'occasion pour Woolf de faire se répondre les voix humaines et les voix du bétail tout proche (campagne oblige) comme la métaphore du pouvoir dictatorial en marche en Europe à cette époque. Enfin, le temps, figé dans un premier temps comme linéaire par la pièce de théâtre, se retourne finalement en boucle face public sous la forme de quelques miroirs brisés - non sans interroger, du même coup, notre rôle dans l'histoire et dans l'Histoire. Comme souvent chez Woolf, le terme de "fin" pour évoquer les dernières lignes est inopérant puisque au moment où s'éteignent les lumières sur Giles et Isa, le rideau bouge encore, le dialogue reprend et une nouvelle vie est évoquée.
Elle porta son verre à ses lèvres. Elle but. Elle écouta. Elle entendait les mots d'une syllabe couler et rejoindre la boue. Elle s'assoupit, dodelinant de la tête. La boue devenait fertile. Les mots s'élevaient au-dessus de l'attelage silencieux des bœufs intolérablement chargés, avançant lentement dans la boue. C'étaient des mots dénués de sens. Des mots merveilleux.
Aussi, cette dernière découverte d'un roman de Woolf n'est que le début d'une éternelle découverte. Car je sais que je n'ai pas saisi le tiers du quart de ce qu'il y a encore à entendre de chacun des romans de l'auteure. L'émerveillement est décidément, lui aussi, un éternel recommencement.
Les livres : ils sont la sève vitale et sacrée des esprits immortels. Les poètes : ce sont les législateurs de l'humanité.
Entre les actes de Virginia Woolf, traduit par Josiane Paccaud-Huguet, La pléiade, 134p.
 Le mois anglais chez Lou et Cryssilda
Le mois anglais chez Lou et Cryssilda
6ème lecture carrément à la bourre (c'est qu'un livre de Woolf se savoure lentement à la lecture et se digère de même avant d'écrire un billet !)

08/07/2017 | Lien permanent | Commentaires (6)
L'écrivain et la vie de Virginia Woolf
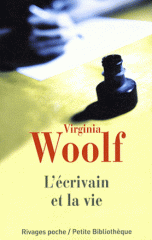
L'écrivain et la vie de Virginia Woolf, Rivages Poche, 2008, 165p.
 Il n'est plus nécessaire que j'avoue mon amour pour Virginia Woolf. Depuis la création de ce blog, je n'ai cessé de le clamer dès que je rédige un billet sur l'un de ses romans - ou même lorsque je n'en rédige pas (toute occasion est bonne pour louer la reine des reines, of course). Pourtant, je suis piètre connaisseuse de son travail dès lors qu'il n'est pas romanesque. Voilà une lacune que j'ai décidé de combler dernièrement en écoutant Une chambre à soi (que je n'ai pas chroniqué car, chose étrange, je n'ai pas réussi à mettre en mots un ouvrage que je n'ai techniquement pas lu. Et cela sonne donc le glas de mes tentatives infructueuses des livres audio car c'est tout de même frustrant d'avoir toujours la sensation d'un manque au final) (Autant vous dire que je n'ai pas intérêt à finir aveugle dans mes vieux jours, je serais bien malheureuse) (Mais je digresse lamentablement ; excusez-moi...). En écoutant Une chambre à soi, donc, et à présent en picorant ce recueil d'essais et d'articles compilés par les éditions Rivages autour du triangle amoureusement littéraire : l'écrivain, le lecteur et le critique. Quelle(s) relation(s) chacun de ces trois protagonistes entretient-il avec la littérature, avec le livre et l'un avec les autres ? Telles sont trois axes qui synthétisent les textes ici rassemblés, publiés initialement entre 1916 et 1937.
Il n'est plus nécessaire que j'avoue mon amour pour Virginia Woolf. Depuis la création de ce blog, je n'ai cessé de le clamer dès que je rédige un billet sur l'un de ses romans - ou même lorsque je n'en rédige pas (toute occasion est bonne pour louer la reine des reines, of course). Pourtant, je suis piètre connaisseuse de son travail dès lors qu'il n'est pas romanesque. Voilà une lacune que j'ai décidé de combler dernièrement en écoutant Une chambre à soi (que je n'ai pas chroniqué car, chose étrange, je n'ai pas réussi à mettre en mots un ouvrage que je n'ai techniquement pas lu. Et cela sonne donc le glas de mes tentatives infructueuses des livres audio car c'est tout de même frustrant d'avoir toujours la sensation d'un manque au final) (Autant vous dire que je n'ai pas intérêt à finir aveugle dans mes vieux jours, je serais bien malheureuse) (Mais je digresse lamentablement ; excusez-moi...). En écoutant Une chambre à soi, donc, et à présent en picorant ce recueil d'essais et d'articles compilés par les éditions Rivages autour du triangle amoureusement littéraire : l'écrivain, le lecteur et le critique. Quelle(s) relation(s) chacun de ces trois protagonistes entretient-il avec la littérature, avec le livre et l'un avec les autres ? Telles sont trois axes qui synthétisent les textes ici rassemblés, publiés initialement entre 1916 et 1937.
Sans vous en faire le détail article par article (il faudra pour cela les lire, c'est bien plus amusant), je relèverai ce qui m'a particulièrement plu/interpelée/marquée.
Tout d'abord, la plume de Virginia se reconnait décidément entre mille, qu'elle fasse courir un roman ou quelques songeries théoriques. Il sera toujours question d'enchâsser une pensée à une autre afin de donner la primauté à l'expérience physique du mot assemblé en phrase. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas d'organisation, vous vous en doutez bien, c'est à dire qu'elle est souvent sous-jacente. C'est à l'émotion, au corps même - car Virginia Woolf propose décidément une écriture terriblement physique (c'est peut-être bien là une définition de la poésie d'ailleurs), de penser le texte avant la raison. Et là où la raison à besoin d'une architecture ultra apparente avec des connecteurs logiques (méthodologie de la dissertation, bonjour), le corps s'en tamponne les miches avec une plume de paon. Ce procédé est particulièrement frappant dans le second texte intitulé La lecture. En bon lecteur moulé par l'université, on s'attend à quelques dizaines de pages autour de la problématique "qu'est-ce que la lecture ?" et blah blah blah. Virginia Woolf, au contraire, nous promène dans des jardins. Je me suis demandée un petit moment où elle m'emmenait, très sincèrement. J'étais vaguement paumée. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle nous invitait à réfléchir sur la lecture, non pas en nous expliquant par A + B ce qu'elle en pense, mais en nous faisant expérimenter ce qu'elle en ressent. Bingo ! Et là, il n'y a qu'à s'incliner.
 Par ailleurs, Virginia Woolf sans ironie et sans snobisme n'est pas Virginia Woolf. Il y en a donc un peu partout, sans déguisement. Parfois, l'un allié à l'autre frise la mauvaise foi, pour ne pas dire y plonge tout à fait. Ainsi, l'article intitulé La chronique littéraire ne cache pas une animosité cinglante enrubannée de bonne éducation british. Virginia Woolf, ce n'est pas un secret, avait un problème avec les chroniqueurs littéraire (occupés de littérature contemporaine # les critiques, occupés de littératures passées selon ses propres définitions). Elle n'y va pas par quatre chemins : le chroniqueur ne sert à rien, ni l'auteur ni les lecteurs, et il faut être sacrément dénué d'égo et de talent pour verser dans cette activité. Bon, on peut donc aller se faire tailler un short. Cet article est néanmoins si plein de mauvaise foi, comme je vous le disais, que Leonard Woolf s'est senti obligé d'ajouter un post-scriptum pour que le tout paraisse moins partial. Même dans ces moments là, je l'aime quand même. Pour le coup, ce type d'article éclaire particulièrement bien la personnalité de Woolf, et la manière dont elle réceptionnait les critiques de ses romans (à mettre en relation avec les nombreuses remarques de son journal)
Par ailleurs, Virginia Woolf sans ironie et sans snobisme n'est pas Virginia Woolf. Il y en a donc un peu partout, sans déguisement. Parfois, l'un allié à l'autre frise la mauvaise foi, pour ne pas dire y plonge tout à fait. Ainsi, l'article intitulé La chronique littéraire ne cache pas une animosité cinglante enrubannée de bonne éducation british. Virginia Woolf, ce n'est pas un secret, avait un problème avec les chroniqueurs littéraire (occupés de littérature contemporaine # les critiques, occupés de littératures passées selon ses propres définitions). Elle n'y va pas par quatre chemins : le chroniqueur ne sert à rien, ni l'auteur ni les lecteurs, et il faut être sacrément dénué d'égo et de talent pour verser dans cette activité. Bon, on peut donc aller se faire tailler un short. Cet article est néanmoins si plein de mauvaise foi, comme je vous le disais, que Leonard Woolf s'est senti obligé d'ajouter un post-scriptum pour que le tout paraisse moins partial. Même dans ces moments là, je l'aime quand même. Pour le coup, ce type d'article éclaire particulièrement bien la personnalité de Woolf, et la manière dont elle réceptionnait les critiques de ses romans (à mettre en relation avec les nombreuses remarques de son journal)
Enfin, ce qui m'a semblé le plus délicieux sont ses balades autour de la lecture, sans doute parce que c'est l'activité entre toutes dont je ne peux me passer ; sans doute parce qu'elle la met si plaisamment en valeur. Le premier article, Heures en bibliothèque, m'a tout particulièrement séduite. Virginia Woolf développe le cheminement d'un lecteur qui pourrait être n'importe qui - en l'occurrence, il pourrait être moi tant tout cela m'a parlé ! Le lecteur n'est pas le savant, nous dit-elle, car le savant vise la connaissance et la lecture n'est qu'un moyen potentiel de l'atteindre ; il la cherche assis à sa table de travail, aimable, un peu blême et concentré. Le lecteur, au contraire, est jeune, vigoureux et aventureux. La connaissance ? Pourquoi pas, se dit-il ! Mais d'abord découvrir et gravir les montagnes de livres ! Voici que lors de cette grimpette exaltante, le lecteur rencontre d'abord les classiques car ceux-ci gratifient, offrent caution, éclairent d'une aura millénaire ; puis il se tourne vers ses contemporains ; puis le voici qui revient en arrière et lit les classiques d'un nouvel œil. Tout cela est tellement juste, tellement pertinent. Bon Dieu, comment Virginia Woolf fait-elle pour tout comprendre en une si petite quinzaines de pages, aussi nonchalantes que des bouquets de violettes sur un buffet de campagne ? (Je tiens à préciser que si le cheminement que j'ai tenté ici de résumer vous parait obscur ou discutable, c'est entièrement imputable à mon résumé pourri. Il faut évidemment lire l'article original pour vous rendre compte qu'il est parfait).
Mais voilà, je m'emporte, je deviens lyrique. C'est quand même dingue : je suis incapable de garder la tête froide cinq minutes avec Woolf ! Il y a presque quelque chose d'exaspérant, tiens ! (Non, ne répondez pas). Pourtant, en toute franchise, je n'ai pas aimé avec la même vigueur tous les articles. Mais dans l'ensemble, j'y ai trouvé ce que j'aime toujours chez cette auteure tellement divine : son génie évidemment, sa sagacité, sa poésie et l'expérience physique qu'elle inspire, son ironie, sa fragilité. Oserai-je préciser à quel point il y a quelque chose de jouissif à retrouver tout cela en un seul et même écrivain ?
 Challenge Mélange des genres chez Miss Léo
Challenge Mélange des genres chez Miss Léo
1ere participation dans la catégorie Essais
 Challenge Virginia Woolf chez Lou
Challenge Virginia Woolf chez Lou
4eme participation
27/03/2014 | Lien permanent | Commentaires (16)
La défense des droits de la femme vu par Virginia Woolf
 Comme chaque 8 mars, chers lecteurs et amis, nous marquons aujourd'hui d'une pierre une énième Journée internationale des droits des femmes (oui, "les droits des femmes" et non pas juste "la femme", on est pas en train de commémorer jalousement le fait qu'on a des nichons et qu'on aime se faire offrir des fleurs - pour ça, y a la Saint Valentin si besoin). A cette occasion, notre consoeur bloggeuse Sophie nous propose d'en profiter pour mettre à l'honneur un auteur féminin et son oeuvre et je ne peux que me rallier à cette excellente idée ! Merci Sophie !
Comme chaque 8 mars, chers lecteurs et amis, nous marquons aujourd'hui d'une pierre une énième Journée internationale des droits des femmes (oui, "les droits des femmes" et non pas juste "la femme", on est pas en train de commémorer jalousement le fait qu'on a des nichons et qu'on aime se faire offrir des fleurs - pour ça, y a la Saint Valentin si besoin). A cette occasion, notre consoeur bloggeuse Sophie nous propose d'en profiter pour mettre à l'honneur un auteur féminin et son oeuvre et je ne peux que me rallier à cette excellente idée ! Merci Sophie !
Mon choix se porte évidemment sur l'extraordinaire Virginia Woolf (Vous remarquerez comme je fais preuve d'une désopilante originalité puisque je ne lui porte AUCUNE admiration hein), non seulement écrivain géniale mais aussi fervente defenseuse des droits des femmes dans une société anglaise encore bien rigide.


Virginia Woolf vient au monde en 1882 dans une famille typiquement victorienne et (mais je pourrais aussi mettre "donc") typiquement patriarcale. Son père Leslie Stephen était de ces intellectuels érudits à plusieurs casquettes et sa mère Julia, une parfaite mère de famille occupée, en outre, à aider quelques familles dans le besoin. Cette dernière était une fervente opposante au mouvement des suffragettes ; la place des femmes, d'après elle, n'était pas dans la rue à se pavaner. Concernant la fratrie liée par une belle entente, les deux frères Toby et Adrian iront à l'université tandis qu'elle-même et sa soeur Vanessa seront privées de cette opportunité, se forgeant leur propre éducation à domicile au gré de leurs envies et de leurs accointances - l'art pour Vanessa et la littérature pour Virginia.
Je vous le disais donc, une famille typiquement victorienne.
Cela étant dit, ne soyons pas mesquins : Virginia Woolf connaitra une jeunesse plutôt privilégiée du point de vue de la culture et des moyens financiers. La fratrie devenue orpheline rassemblera un petit groupe de passionnés d'arts et lettres à leur nouveau domicile de Bloomsbury et cela marquera l'épanouissement de la personnalité et de l'écriture de Virginia Woolf.
 Dès lors, Virginia Woolf n'aura de cesse d'écrire en faveur d'une véritable autonomie et d'une culture féminine. Elle n'était pas féministe au sens contemporain du terme ; il n'était pas question de réclamer une égalité stricto sensu entre hommes et femmes. Elle souhaitait par contre que les femmes puissent accéder à une liberté d'être, à la possibilité de choisir une vie qui leur serait propre, en adéquation avec leurs dispositions et leurs talents particuliers. C'est ce qu'elle a défendu dans un certains nombres de conférences, de cours et d'essais. Dans l'Angleterre engoncée du début du XXe siècle, la femme était cantonnée aux travaux domestiques, pourtant affirme-t-elle, elle ne nourrit pas plus d'intérêt pour cet emploi que l'homme. Sans aucun espace privé à l'intérieur de son domicile tandis que le mari avait son bureau, l'entier de la maison était le territoire de la femme sans l'être du tout. Virginia Woolf milite donc en faveur d'une chambre à soi, d'un espace privé pour la femme, où elle aurait le temps et le loisir de laisser libre cours à ses aspirations, tout aussi diverses et avec autant de compétences que son acolyte à couilles (puisque le cas des femmes célibataires n'était pas vraiment répandu à l'époque)
Dès lors, Virginia Woolf n'aura de cesse d'écrire en faveur d'une véritable autonomie et d'une culture féminine. Elle n'était pas féministe au sens contemporain du terme ; il n'était pas question de réclamer une égalité stricto sensu entre hommes et femmes. Elle souhaitait par contre que les femmes puissent accéder à une liberté d'être, à la possibilité de choisir une vie qui leur serait propre, en adéquation avec leurs dispositions et leurs talents particuliers. C'est ce qu'elle a défendu dans un certains nombres de conférences, de cours et d'essais. Dans l'Angleterre engoncée du début du XXe siècle, la femme était cantonnée aux travaux domestiques, pourtant affirme-t-elle, elle ne nourrit pas plus d'intérêt pour cet emploi que l'homme. Sans aucun espace privé à l'intérieur de son domicile tandis que le mari avait son bureau, l'entier de la maison était le territoire de la femme sans l'être du tout. Virginia Woolf milite donc en faveur d'une chambre à soi, d'un espace privé pour la femme, où elle aurait le temps et le loisir de laisser libre cours à ses aspirations, tout aussi diverses et avec autant de compétences que son acolyte à couilles (puisque le cas des femmes célibataires n'était pas vraiment répandu à l'époque)
Loin d'agiter un féminisme de carnaval (comme je déplore de le voir de plus en plus aujourd'hui), Virginia Woolf fustige l'oppression des institutions patriarcales (qu'elle comparera à l'oppression nazie dans Trois Guinées) et a fait une vertu de la liberté de penser, quel que soit son sexe (parce qu'elle était pas misandre non plus hein).
Pour aller plus loin sur le sujet dans son oeuvre :
Une chambre à soi (1929), ed. 10/18, 6€ ou ed. Rivages payot, 7€ (avec la traduction du titre Une pièce bien à soi)
Trois guinées (1938), ed. 10/18 (actuellement plus édité visiblement, c'est honteux) MAIS future nouvelle édition aux editions BlackJack dans une nouvelle tradition à partir du 20 mars 2012.
La force du féminin : sur trois essais de Woolf de Frédéric Regard, ed. La Fabrique, 2002
"Les difficultés matérielles auxquelles les femmes se heurtaient étaient terribles ; mais bien pires étaient pour elles les difficultés immatérielles. L'indifférence du monde que Keats et Flaubert et d'autres hommes de génie ont trouvée dure à supporter était, lorsqu'il s'agissait de femmes, non pas de l'indifférence, mais de l'hostilité. Le monde ne leur disait pas ce qu'il disait aux hommes : écrivez si vous le voulez, je m'en moque...Le monde leur disait avec un éclat de rire : Ecrire ? Pourquoi écririez-vous ?"
dans Une chambre à soi

 Tous les autres billets littérairement féminins sont listés ici chez Sophie
Tous les autres billets littérairement féminins sont listés ici chez Sophie
Bonne lecture !
08/03/2012 | Lien permanent | Commentaires (11)
Virginia Woolf de Michèle Gazier et Bernard Ciccolini
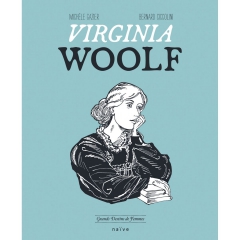
Virginia Woolf de Michèle Gazier et Bernard Ciccolini, Naïve, 2011, 90p.
Depuis quelques années, les éditions Naïve sévissent à coups de Grands Destins de Femmes. Il s'agit de faire découvrir aux lecteurs la vie de quelques figures majeures des siècles passés et présent, toutes disciplines confondues. Qui avait-il derrière le génie, l'artiste ou le médecin ? Telle est la question.

Si j'ai empoigné cette BD dénichée fortuitement à la bibliothèque, ce n'est pas tant parce que la biographie de Woolf m'est inconnue (on ne va pas se mentir) que parce que le nom de Woolf fonctionne chez moi comme un aimant - aimant à double-tranchant car il ne manque pas d'aiguiser autant ma curiosité que mon exigence. Dans les faits, je dirais que la présente bio-graphique n'est pas rageusement mauvaise, elle se laisse même lire sans déplaisir (elle a agréablement occupé mon temps lecture avant le sommeil l'autre soir) mais est clairement loin de casser trois pattes à un canard. Comprendre par là que je suis contente de l'avoir louée à la bibliothèque ; 23€ pour ça, il ne faut quand même pas pousser mémé hein.
Le scénario ne me semble pas trop mal monté. On pourrait bien sûr reprocher à Michèle Gazier d'avoir transformer la riche existence de la plus géniale des auteures du XXème siècle en une suite de rencontres et de drames successifs, la conduisant à l’effondrement progressif. Loin de moi l'idée de lui jeter la pierre : je ne la soupçonne pas de le penser mais il faut bien convenir que le format de la collection en 90 pages impose quelques raccourcis. C'est au fond le problème des biographies en BD : soit il faut pouvoir s'étaler en pavé, soit il vaut sans doute mieux se concentrer sur tel ou tel épisode marquant de la vie de l'auteur conté. On a beau accepter de manière complaisante les contraintes qui ont présidé aux raccourcis, il n'empêche qu'à la fin, on se dit que la lecture du produit fini était sympathique mais assez dispensable.
Ce qui m'a néanmoins le plus gênée, je dois l'avouer, c'est le graphisme. En toute franchise : qu'est-ce que cette horreur ?! Je reconnais à Bernard Ciccolini la capacité à croquer avec un certain talent certains visages et expressions de Woolf mais dans l'ensemble, le travail est loin d'être un régal pour les yeux. Grossièreté des couleurs et du trait, naïveté ambiante... Même les bulles et la typographie sont moches ! Il fallait quand même le faire ! Allez, j'exagère peut-être un peu : preuve en est, je l'ai quand même lu jusqu'au bout. Mais franchement, c'était plus pour le joie de m'immerger une petite vingtaine de minutes dans la vie de Woolf que pour le plaisir des yeux.
Exemple de graphisme moche : Voilà comment le dessinateur "illustre" l'inspiration de VSW pour Orlando. J'en ai les poils qui frisent.

Vous l'aurez compris : s'il n'y a pas de quoi se priver de cette lecture, c'est uniquement si elle ne vous coûte rien. Par ailleurs, si vous êtes intéressés par la vie de Woolf, je vous conseille l'excellente biographie de Hermione Lee - un beau pavé de plus de mille pages. A lire si vous êtes vraiment intéressés par la vie de Woolf, donc. Je vous conseille en outre de jeter à la poubelle ou de vous servir de papier toilette de l'odieuse biographie récente de Viviane Forrester. Celle-ci ne mérite d'être mentionnée que pour rappeler qu'elle ne consiste qu'à enfiler des conneries à la chaîne.
Amis woolfiens, bonne journée ! ;)

 Challenge Le mélange des genres chez Miss Léo
Challenge Le mélange des genres chez Miss Léo
Catégorie BD
30/10/2014 | Lien permanent | Commentaires (6)
La fascination de l'étang de Virginia Woolf
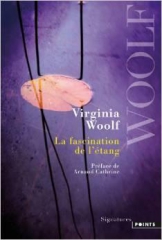
La fascination de l'étang de Virginia Woolf, Points, 2013, 290p.
 Femme indigne, peut-être, à sa manière et en son temps : Virginia Woolf a vécu plusieurs années en célibataire avec ses frères dans une maison qui rassemblait ce fameux cercle de Bloomsbury rempli d'hommes. D'une extrême sensibilité aux humeurs, perméable aux sensations et soumise aux aléas de la dépression, Virginia Woolf dénotait à plus d'un titre dans l'atmosphère encore bienséante du début du XXème siècle, sans parler de son génie hors norme et de son ironie aiguisée. Indignée, assurément, du sort des femmes, et de cette culture qui autorise à l'homme et non à la femme une chambre à soi. Tout cela, on le sait déjà : Virginia Woolf n'est plus à présenter, à tous points de vue. Pourtant, de ses œuvres romanesques magistrales nous manque peut-être une vue d'ensemble - à moins d'avoir déjà tout lu.
Femme indigne, peut-être, à sa manière et en son temps : Virginia Woolf a vécu plusieurs années en célibataire avec ses frères dans une maison qui rassemblait ce fameux cercle de Bloomsbury rempli d'hommes. D'une extrême sensibilité aux humeurs, perméable aux sensations et soumise aux aléas de la dépression, Virginia Woolf dénotait à plus d'un titre dans l'atmosphère encore bienséante du début du XXème siècle, sans parler de son génie hors norme et de son ironie aiguisée. Indignée, assurément, du sort des femmes, et de cette culture qui autorise à l'homme et non à la femme une chambre à soi. Tout cela, on le sait déjà : Virginia Woolf n'est plus à présenter, à tous points de vue. Pourtant, de ses œuvres romanesques magistrales nous manque peut-être une vue d'ensemble - à moins d'avoir déjà tout lu.
La fascination de l'étang nous offre cette possibilité d'un voyage à travers toutes ses années de création littéraire - en somme, le voyage express vers l'aperçu génial d'un devenir écrivain, d'une voix qui se cherche, d'un style qui s'affirme. Au tout début, en 1906, les marottes de Virginia Woolf sont déjà là : la féminité, la recherche d'une indépendance de l'être, la solitude au sein du bourdonnement des villes. "Phyllis et Rosamund" questionne déjà tout cela autour du mariage et de l'affirmation de ses propres décisions, mais dans un style encore emprunt d'une certaine neutralité. On est encore, en 1906, dans un récit à la troisième personne. C'était déjà très bon, évidemment, puisque c'est déjà Woolf, mais ce n'était pas encore la Woolf de Mrs Dalloway ou de La promenade au phare ; plutôt une Woolf en gestation, au sein du cocon des Lettres, mâchouillant déjà propos et idées qui ne la quitteront plus mais cherchant le bon mot, le bon angle, le bon flux. A cette époque, nous sommes quelques neuf ans avant la parution de son premier roman, The Voyage Out.
- Fuyons ! La lune est noire sur la lande. Partons à l'assaut de ces vagues d'obscurité, couronnées par les arbres, qui se soulèvent à jamais, solitaires et noires. Les lumières montent et chutent. L'eau est légère comme de l'air ; la lune luit derrière. Sombrer ? Rouler ? voir les îles ? Seul avec moi. p. 114 (in "La soirée")
Et puis, "La soirée". Génial tournant, claque magistrale : 1919, époque de Night and Day, ce deuxième roman dont on s'accorde à dire qu'il ne marque pas encore l'éclosion totale du style de Woolf, et pourtant, tout était déjà dans cette nouvelle ; il n'attendait plus que quelques années avant de s'épanouir sous la forme romanesque. Le flux de conscience fait son entrée délicate en l'esprit d'une jeune femme invitée à une réception et les pensées fusent entre les paroles au point de ne plus savoir exactement qui est quoi. Plus que de la littérature, la voix de Woolf émerge comme chant, comme incantation de l'instant présent et des êtres évanescents. Une pure merveille que j'ai relue plusieurs fois, presque d'affilée, puis à plus longs intervalles, avec un ravissement renouvelé. Chaque mot est poésie pure.
Progressivement, les nouvelles deviennent ainsi, à l'image des titres de deux d'entre elles, "Tableaux" et "Portraits". On glisse du factuel au vivant, au saisissement d'impressions et d'instants de vie fugaces. Une certaine fascination pour l'eau, tantôt stagnante de l'étang, tantôt flux et reflux des vagues, s'affirme peu à peu, à l'image du courant qui porte progressivement la vie et l'existence de Woolf. Mrs Dalloway, aussi, est déjà là, dans Bond Street en 1922, année de la parution de Jacob's room et trois ans avant le roman éponyme. A cette époque, ce sont des gants qu'elle s'en va acheter, traversant Londres et s'en laissant traverser. Les nouvelles qui suivent livreront au lecteur certains de ses invités croqués sur le vif, révélant du même coup d'autres visages de Mrs Dalloway.
Il est impossible de mettre des mots là-dessus, et puis c'est superflu. Sous les vibrations vacillantes de ces petites créatures, il y a toujours un réservoir profond, et la mélodie simple, sans le dire, lui fait quelque chose de curieux : elle en ride la surface, elle le liquéfie, elle y crée des remous, le fait rouler et palpiter dans les profondeurs de l'être jusqu'à ce que des idées surgissent de cette nappe d'eau et montent au cerveau faire des bulles. p. 205 (in "Mélodie simple")
Ainsi s'offre au lecteur le cabinet de création d'une des plus grandes auteures anglaises (et malgré le grincement de dents que peut susciter le féminin de cette auguste profession, je crois qu'il sied à Woolf d'affirmer son combat pour la reconnaissance des femmes de Lettres). Nous y voilà donc, au génie, au cheminement de l'alliance inespérée de la prose et de la poésie.
 Le mois anglais 2016 chez Lou et Cryssilda
Le mois anglais 2016 chez Lou et Cryssilda
2ème participation
LC Femmes indignes et indignées
 Challenge Femmes de Lettres chez George
Challenge Femmes de Lettres chez George
1ère participation pour une auteure du XXème siècle
03/06/2016 | Lien permanent | Commentaires (13)




