26/09/2016
Carter contre le diable de Glen David Gold
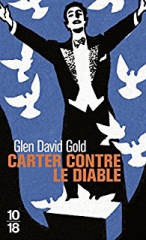
Carter contre le diable de Glen David Gold, 10/18, 2015[2002], 762p.
 Charles Carter n'était pas né pour être saltimbanque. D'un père homme d'affaires et d'une mère un peu toquée de trop d'oisiveté, Charles se destinait à Yale, tout comme son jeune frère. Mais quelques aventures rocambolesques, dont le vol d'une pièce rare ou la correction un peu salée du jardinier un soir d'hiver, vont décider Charles à s'entraîner sans relâche pour devenir magicien. Ce n'est pas sans mal qu'il balade sa famille pour repousser d'années en années son entrée à l'université, préférant voyager à travers le pays, avec d'autres artistes de scène, pour se produire avec ses cartes et ses foulards. De ce départ un peu miteux, il va finir par devenir un des plus grands magiciens du début de siècle, aux côtés d'Houdini, et s'octroyer le sobriquet de Carter le Grand. Un beau soir de 1923, c'est même le président des Etats-Unis, Warren G. Harding qui vient assister à l'une de ses représentations à San Francisco. Ils affrontent tout deux le diable. Jusque là, rien que la routine pour Charles Carter. A ceci près que, quelques heures plus tard à peine, le président décède dans de mystérieuses circonstances. Le magicien est évidemment soupçonné et ce n'est pas sans une pointe d'amusement qu'il entame un jeu d'esquives et d'illusions avec les membres du Service Secret.
Charles Carter n'était pas né pour être saltimbanque. D'un père homme d'affaires et d'une mère un peu toquée de trop d'oisiveté, Charles se destinait à Yale, tout comme son jeune frère. Mais quelques aventures rocambolesques, dont le vol d'une pièce rare ou la correction un peu salée du jardinier un soir d'hiver, vont décider Charles à s'entraîner sans relâche pour devenir magicien. Ce n'est pas sans mal qu'il balade sa famille pour repousser d'années en années son entrée à l'université, préférant voyager à travers le pays, avec d'autres artistes de scène, pour se produire avec ses cartes et ses foulards. De ce départ un peu miteux, il va finir par devenir un des plus grands magiciens du début de siècle, aux côtés d'Houdini, et s'octroyer le sobriquet de Carter le Grand. Un beau soir de 1923, c'est même le président des Etats-Unis, Warren G. Harding qui vient assister à l'une de ses représentations à San Francisco. Ils affrontent tout deux le diable. Jusque là, rien que la routine pour Charles Carter. A ceci près que, quelques heures plus tard à peine, le président décède dans de mystérieuses circonstances. Le magicien est évidemment soupçonné et ce n'est pas sans une pointe d'amusement qu'il entame un jeu d'esquives et d'illusions avec les membres du Service Secret.
Quelle n'est pas ma surprise de découvrir à l'instant (puisque, bien sûr, je n'avais pas lu avant les notes de fin d'ouvrage) que le roman se base sur de nombreux faits réels, à commencer par l'existence de Charles Carter, véritable magicien emblématique du passage au vingtième siècle ! C'est d'ailleurs le chapitre qui est consacré à son enfance et à sa formation qui m'a le plus enthousiasmée. J'ai adoré voyager dans la vie de cet esprit libre, original, pétri de solitude, d'égo et de rêves un peu fous. Il semble au lecteur circuler dans les méandres d'un temps totalement révolu et d'un monde plutôt méconnu - il y a bien eu la série Carnival sur le cirque des années 20, mais c'était nettement plus glauque. Ici, on vit plutôt dans le music-hall chic que parmi les freaks. Evidemment, tout est très très librement revu et corrigé par Glen David Gold mais les descriptions d'affiches ou les numéros de Carter le Grand sont exactement ce qu'ils étaient. Ce dernier faisait bel et bien disparaître un éléphant sur scène.
Autre personnage véritable de ce roman : Warren G. Harding, vingt-neuvième président des Etats-Unis et véritablement mort dans des circonstances douteuses le 2 août 1923 à San Francisco durant sa tournée de la Compréhension (les politiciens pratiquaient déjà l'art de la communication à coups de voyages d'agrément auprès du petit peuple). Mort douteuse car sa femme a refusé toute autopsie, ce qui, évidemment, n'a fait qu'enfler la rumeur d'attentat.

Si nous en restions là, Carter contre le diable ne serait finalement qu'un biopic, sauf que rien n'accrédite l'hypothèse d'une rencontre entre les deux hommes et encore moins toutes les autres élucubrations du roman. C'est donc là qu'il prend la tournure d'un polar fantaisiste, afin d'imaginer un envers du décor aussi léger et brillant qu'un tour de magie. Toutefois, certains passages manquent un peu de souffle, il faut bien l'avouer. Le bouquin est opulent mais n'est pourtant pas exactement ce qu'on pourrait appeler un page-turner. Mieux vaut s'attacher à la personnalité de Carter pour poursuivre sans trop s'essouffler au fil des centaines de pages. C'est dommage d'ailleurs que l'essentiel soit porté sur ses frêles, bien que magiques, épaules : un peu plus de consistance apportée à l'aspect policier du roman n'aurait pas été de trop. malheureusement, si Glen David Gold est plutôt doué pour faire vivre une époque et un personnage en particulier, il l'est moins pour en créer d'autres de toutes pièces qui ne soient pas fort caricaturaux et une intrigue qui ne soit pas tantôt mollassonne (à la limite du décor inutile), tantôt tellement grosse qu'elle en est ridicule (le dénouement brille particulièrement par son énormité).
Carter contre le diable n'est donc pas un chef d'oeuvre, loin de là et mieux vaut ne pas trop en attendre de la partie polar pourtant vendue comme haletante sur la 4ème de couverture. C'est cependant une lecture agréable, attachante, sans vraiment de prétention, qui m'a fait voyager le temps de quelques semaines (période de rentrée oblige, je lis à la vitesse d'une locomotive à vapeur) et m'a surtout donné envie de poursuivre quelques lectures dans l'univers de la magie. On n'a décidément pas trouvé mieux pour s'évader avec le sourire ! (Et je crois que je commence à comprendre les aficionados qui relisent régulièrement Harry Potter !)
 Le Mois Américain 2016 chez Titine
Le Mois Américain 2016 chez Titine
4ème participation
 Challenge un pavé par mois chez Bianca
Challenge un pavé par mois chez Bianca
2ème participation de septembre 2016
07:56 Publié dans Challenge, Littérature anglophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : charles carter, carter le grand, magie, polar, biopic, warren harding
18/09/2016
Black-Out de Brian Selznick

Black Out de Brian Selznick, Bayard Jeunesse, 2014, 640p.
 Le premier abord fait un peu peur : 640 pages, c'est une sacrée somme pour un roman ado - pour un roman tout court - et l'épaisseur du papier fait que le livre est sacrément imposant. Au deuxième abord, c'est la curiosité qui prend le dessus puisqu'à le feuilleter, on s'aperçoit qu'il y autant d'images que de texte, peut-être même plus. Quel est donc, alors, ce curieux objet-livre qui n'est ni un roman au sens strict du terme, ni un roman graphique, ni un album ?
Le premier abord fait un peu peur : 640 pages, c'est une sacrée somme pour un roman ado - pour un roman tout court - et l'épaisseur du papier fait que le livre est sacrément imposant. Au deuxième abord, c'est la curiosité qui prend le dessus puisqu'à le feuilleter, on s'aperçoit qu'il y autant d'images que de texte, peut-être même plus. Quel est donc, alors, ce curieux objet-livre qui n'est ni un roman au sens strict du terme, ni un roman graphique, ni un album ?
C'est l'histoire de deux adolescents qu'a priori rien ne rapproche : Ben vient de perdre sa mère bibliothécaire et vit avec son oncle et sa tante non loin de son ancien chez-lui, à Gunflint Lake. Nous sommes en 1977 et Ben s'accroche à une petite collection d'objets insolites qui lui rappelle nombre de souvenirs envolés. Rose, quant à elle, souffre d'un père trop directif dans une maison vide. Elle s'évade en construisant une réplique de New-York dans sa chambre et collectionne tout ce qui concerne une star du cinéma muet. Nous sommes en 1927. Cinquante ans et quelque états les séparent et pourtant, Ben et Rose partagent une immense solitude et la quête d'un ancrage, d'un lieu auquel appartenir, d'êtres à qui s'accrocher. L'un comme l'autre partent pour New-York pour y chercher des réponses et un peu de chaleur. C'est ainsi que leurs destins deviennent parallèles, l'un marchant dans les pas de l'autre, avant de mieux se retrouver.
La grande force de ce récit réside dans sa forme originale et parfaitement maîtrisée (Brian Selznick l'avait déjà expérimentée dans L'invention de Hugo Cabret, adapté à l'écran par Scorcese) : une alternance de dessins en noir et blanc et de texte correspondant, dans Black Out, à la vision ou, plus justement, à l'expérience, de chacun des deux protagonistes. Ainsi, Rose se découvre au lecteur sans le truchement du mot mais non sans une grande sensibilité, comme un clin d'oeil au cinéma muet qu'elle admire et comme l'expression de cette sensation qu'elle éprouve d'être souvent coupée d'une partie du monde : celui qui entend, celui qui use de mots, au lieu de ressentir par d'autres sens. Ben expérimente aussi la surdité mais plus tardivement, aussi est-il encore un point entre les sourds et les entendants et la parole est encore son mode de communication privilégié. En somme, au-delà de la beauté de la forme, celle-ci fait sens dans l'évolution du récit jusqu'à mêler les deux comme le symbole d'une communion retrouvée.
L'histoire en elle-même est évidemment touchante, même si je l'ai trouvée assez superficielle et téléphonée. Clairement, le principal, ici, est mis sur la forme plus que sur des personnalités consistantes et élaborées. Ce ne sont pas tant Ben et Rose qui me resteront en tête, malgré tous les bons sentiments que cet ouvrage (que je ne sais toujours pas classer, et c'est tant mieux !) véhicule, mais bien l'exercice passionnant de renouveler le dialogue narratif entre le texte et les arts plastiques.


 Le Mois Américain 2016 chez Titine
Le Mois Américain 2016 chez Titine
3ème participation
 Challenge un pavé par mois chez Bianca
Challenge un pavé par mois chez Bianca
Participation de septembre 2016
15:44 Publié dans Art, Challenge, Littérature ado, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (8)
09/09/2016
La maison de l'aube de N. Scott Momaday

La maison de l'aube de N. Scott Momaday, Folio, 2005[1966], 300p.
Littérature amérindienne II, le retour ! Depuis mon mémoire sur le sujet, c'est-à-dire il y a deux ans, je n'y avais plus retouché. Pas tellement de façon consciente mais il faut croire que je suis tombée dans le même triangle des Bermudes que tous les post-mémoires ou post-thèses : un besoin de lire ailleurs si on y est. Et puis, on revient toujours à ses premières amours voire, dans le cas présent, j'en reviens aux sources de mes premières amours puisque La maison de l'aube, publié en 1966 est considéré comme LE roman marquant de la renaissance amérindienne littéraire.
Il y est question d'Abel, un jeune métis dont on ignore qui est le père : peut-être un Navajo, un Sia ou un Isleta ? Il ne lui reste plus que son grand-père dont on ne saurait dire s'il est proche. Abel glisse sur le flot de la vie : tantôt en communion avec une nature aride, solitaire, tantôt dans l'impossibilité de communiquer avec les hommes, dans l'impossibilité d'être en adéquation avec cette vie et ce monde. Cette quasi-absurdité le conduit à tuer un "homme blanc" - non pas l'homme blanc habituel des récits amérindiens mais un albinos, étranger et étrangeté par excellence - et à vivre une errance chaotique à Los Angeles après son séjour en prison. Des tours et détours, des rencontres et bien des déboires pour finir, peut-être, par rentrer chez lui.
Décidément, certains éléments de la littérature amérindienne ne trompent pas : le topos du métis comme protagoniste, symbole de l'errance identitaire, l'importance d'une narration fragmentée et cyclique, l'image répétée du tambour comme cercle de vie, l'impossibilité de communiquer, la figure de l'aïeul... Que d'éléments qu'il me semble avoir lus bien des fois chez bien auteurs amérindiens, à chaque fois selon des nuances et des modalités différentes. A chaque fois, aussi, traités avec plus ou moins de talent stylistique.
Je ne vous cache pas avoir ressenti une petite pointe de déception au cours de ma lecture. C'est qu'on commence à être exigeant, à force de connaître un peu mieux les ficelles... Il m'a fallu me rappeler à plusieurs reprises que tout ce qui est devenu, aujourd'hui, un cliché était vierge à l'époque d'écriture de Scott Momaday. Il a été le précurseur de tout un renouveau aussi bien littéraire qu'identitaire. Ce statut de défricheur à ses deux revers, comme toute médaille : d'une part on ne peut que saluer l'inventivité et la prescience, d'autre part, on ne peut s'empêcher de relever quelques maladresses, quelques lourdeurs, quelques tentatives un peu hasardeuses. La principale difficulté de lecture, à cet égard, réside à mon sens dans une fragmentation encore malhabile et donc parfois pénible. Autant j'avais adoré la fragmentation virtuose de Ceremony chez Leslie Marmon Silko, pourtant très ardue, abrupte, et qui ne rend donc pas la lecture aisée, autant la fragmentation de Momaday m'a paru moins à propos à de nombreuses reprises, moins subtile dans ce qu'elle ambitionnait de mettre en lumière. Le récit de La maison de l'aube est honnêtement moins fort et moins passionnant que celui de Ceremony, de manière générale - Je précise que je me permets cette comparaison car les deux romans écrits à une dizaine d'années d'intervalle ont une histoire très similaire. Ils poussent même le vice jusqu'à situer le récit dans la même région des USA. Il faut croire que Marmon Silko a particulièrement bien retenu la leçon initiée par Momaday pour la transcender de façon encore plus géniale dans son propre roman dix grosses années plus tard.
En somme, La maison de l'aube représente une excellent document pour qui, passionné de littérature amérindienne, aimerait goûter aux sources d'une flopée d'auteurs postérieurs passionnants. Il ne manque pas d'intérêt, met en lumière à la fois tous les éléments narratifs et toutes les problématiques qui seront au coeur de cette littérature riche d'Histoire et d'avenir. De nombreux morceaux sont délicieusement poétiques et font évidemment montre d'un talent indéniable. Toutefois, ce n'est certainement pas ce que j'ai lu de plus vibrant, de plus marquant de cette période de renaissance amérindienne. Quitte à choisir, je conseillerai indéniablement Ceremony de Marmon Silko !

18:43 Publié dans Challenge, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : amérindiens, usa, momaday, littérature amérindienne, métis




