16/02/2018
LaRose de Louise Erdrich
Une bombe vous faisait sauter en un instant ; recoller vos morceaux prenait le restant de vos jours.
A la toute fin des années 90, la partie de chasse qui marque l'arrivée de l'automne chez les Ojibwés tourne mal pour Landreaux Iron : Au lieu du cerf qu'il visait, c'est Dusty, le jeune fils d'un ami et de la demi-sœur de sa femme, qu'il tue. L'incompréhension fait place à la stupeur puis à la dévastation chez tous. Le vide d'une telle mort semble impossible à porter, impensable à combler. Lors d'une cérémonie, Landreaux choisit de respecter une tradition ancestrale : celle de donner son plus jeune fils aux parents en deuil. Ainsi, LaRose, ce petit bonhomme de cinq ans, ancien copain de jeu du défunt, se voit confier la mission tacite de guider chacun sur le chemin de la guérison.
Avant d'emmener LaRose chez les Ravich, l'automne précédent, Landreaux et Emmaline avaient prononcé son nom. Mirage. Ombanitemagad. C'était le nom que recevait chaque LaRose. Le premier nom de la fille de Vison. Il le protégerait de l'inconnnu, de ce que l'accident avait libéré. Il arrive que ce genre d'énergie - le chaos, la malchance - s'échappe dans le monde et ne cesse d'enfanter encore. La poisse s'arrête rarement après un seul événement. Tous les Indiens le savent. Y mettre fin rapidement exige de grands efforts, ce pourquoi LaRose avait été envoyé.
Il faut dire que LaRose s'inscrit dans une longue lignée de passeurs de mémoire animés d'un souffle de vie incroyable. Plus d'un siècle et demi plus tôt, la première LaRose avait déjà développé mille trésors de force et de résilience pour survivre d'abord, puis pour vivre tout à fait en harmonie avec ses ancêtres, ses racines Ojibwés et les arcanes d'un monde nouveau. De cette lutte-là naquit doucement l'amour et s'y tressèrent les fils puissants du métissage comme un élan vers l'avenir.
La nuit, elle s'envolait, traversait le plafond et s'élançait vers le ciel comme on le lui avait appris. Elle entreposa des parties de son être au sommet des arbres. Elle reviendrait les chercher plus tard, quand les cloches s'arrêteraient de sonner.
A travers la voix de LaRose, fils de Landreaux et Emmaline, ce sont ainsi tous les LaRose qui chantent et résonnent entre les lignes. Cette plongée nécessaire dans le passé et ses multiples échos au présent, projetés vers l'avenir comme une ramure de cerf, une sève millénaire ou une poussière d'étoiles impriment à la structure narrative cette circularité si caractéristique de l'écriture d'Erdrich - ce que d'aucuns pourraient trouver éclaté, décousu ou erratique mais ne l'est que pour notre esprit formaté à la linéarité.
Elle était archaïque et avait surgi de la terre en ébullition. Elle avait sommeillé, mené une vie latente dans la poussière, s'était élevé en fin brouillard.
Il y a, indéniablement, dans ce dernier roman de l'auteure, un équilibre précaire c'est-à-dire parfait entre la profonde noirceur du drame et du poids des ans, impeccable de douleur sourde et une lumière incroyable, miroitante, ténue mais persistante. Louise Erdrich, comme toujours, délivre subtilement par la fiction la réalité d'une blessure jamais refermée, qui envenime toutes les autres, et son nécessaire mouvement de guérison : tisser la toile des résonances multiples entre tous les âges. Puis récréer.
Le cerf savait, songea Landreaux. Evidemment qu'il savait. Landreaux l'avait observé, parfois armé de son fusil, parfois non. Très souvent, il avait vu qu'à son tour le cerf l'observait. Il s'arrêtait, sentant le regard de l'animal posé à l'arrière de son crâne, et lorsqu'il se retournait il était là, immobile, les yeux profonds et liquides. S'il avait écouté, ou compris, ou encore s'il s'était soucié de savoir ce qu'il comprenait, jamais il ne l'aurait chassé. Jamais. il aurait su que le cerf cherchait à lui communiquer une information de la plus haute importance. Ce n'était pas un être ordinaire, mais un pont vers un autre monde.
Bien que je n'aie pas goûté ce titre-là avec le même plaisir délicieux que beaucoup des précédents - je lui reproche notamment des facilités de style qui m'ont déplu et quelques longueurs trop anecdotiques à mon goût, je dois pourtant reconnaître que j'en garde un éclat particulier quelque part dans la mémoire. LaRose, ce personnage protéiforme aux cinq visages, incarnation de bien des excès, de la douceur, de l'ingéniosité, de la candeur et de la vitalité tout à la fois, est de ceux qui marquent, qui trottinent encore longtemps dans la tête, et dont on se dit "Que ferait-il à ma place ?" pour trouver la juste voie. Alors, malgré les défauts, je dois bien avouer que c'est là le signe indéniable qu'on a à faire à un bon cru.
Romans précédemment lus et chroniqués de l'auteure :
Le pique-nique des orphelins, Dans le silence du vent, Ce qui a dévoré nos coeurs (dont j'ai honteusement méjugé alors la première partie qui est, en fait, une mine d'or), Derniers rapports sur les miracles à Little No Horse, Love medicine.
10:46 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : larose, louise erdrich, littérature amérindienne, rentrée littéraire 2018, rentrée hiver 2018, meurtre, décès, deuil, passé, avenir, résilience, guérison, dakota du nord, amérindiens, ojibwés
18/01/2017
Le pique-nique des orphelins de Louise Erdrich
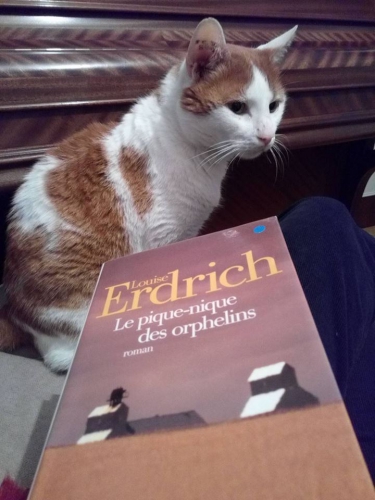 Fidèle à Love Medicine, Louise Erdrich poursuit la veine du roman choral avec ce très beau second roman intitulé The Beet Queen (La Reine Betterave) mais traduit La branche cassée en 1988 par Robert Laffont et aujourd'hui Le pique-nique des orphelins par Albin Michel. Allez comprendre ! (Ok, avouons que "La Reine Betterave" sonne peu engageant)
Fidèle à Love Medicine, Louise Erdrich poursuit la veine du roman choral avec ce très beau second roman intitulé The Beet Queen (La Reine Betterave) mais traduit La branche cassée en 1988 par Robert Laffont et aujourd'hui Le pique-nique des orphelins par Albin Michel. Allez comprendre ! (Ok, avouons que "La Reine Betterave" sonne peu engageant)
Le contour de mes os était bordé de noir. J’étais une balise. D’un bout à l’autre de la nuit je ne cessai de palpiter, rappelant à moi les uns ou les autres – Giles ou Mary, ma mère, ou même le bébé qui avait détruit ma mère en la faisant fuir.
Durant quarante ans, de 1932 à 1972, Louise Erdrich brosse le portrait de Karl et Mary Adare, frère et soeur abandonnés lâchement par une mère presque veuve (si seulement elle avait été l'épouse légitime et non la maîtresse...), déchue et revenue à une pauvreté tragique. C'est lors d'un pique-nique de charité au profit des orphelins de Saint-Jérôme (tiens, tiens) qu'Adelaïde s'envole - littéralement - avec le pilote local venu divertir les ouailles. Dans la foulée, Karl et Mary perdent leur jeune frère nourrisson. Il n'y a plus qu'eux d'eux en direction d'Argus dans le Dakota du Nord et de leur tante Fritzie. Aussitôt arrivés, c'est cette fois une branche cassée qui les sépare (tiens, tiens, bis). Frère et soeur ne se verront plus de longtemps.
Mary débarque chez sa tante qui tient une boucherie. Celle-ci l'accueille comme elle peut ; lui donne une chambre, des habits. En somme, tout ce qui appartenait initialement à Sita, sa fille et la cousine de Mary. De ce mauvais départ, il n'y aura jamais entre elles de relations - seulement l'attente désespérée de pouvoir un jour cesser de partager une chambre. Il faut dire que les personnalités des cousines n'ont pas grand chose pour s'accorder : Sita est superficielle, envieuse, ambitieuse ; Mary est teigneuse, rêche, aride. Sita aura plusieurs relations sulfureuses ; Mary vivra dans la solitude. Sita sera mannequin, restauratrice, habitera une belle maison ; Mary reprendra la boucherie familiale, développera un goût prononcé pour arts divinatoires et reportera le peu d'affection dont elle est capable sur Dot, la fille de son amie Celestine.
Celestine, d'ailleurs : sacrée brin de femme ! Cette jeune métisse était d'abord l'amie de Sita. Et puis Mary l'a accaparée comme le reste. Celestine est puissante et vaillante mais ne trouve pas l'amour. Elle tente d'y croire brièvement avec Karl, devenu un commercial itinérant bisexuel, mais la relation n'a rien de satisfaisant. En même temps qu'elle tire un trait sur ses rêves à l'eau de rose, elle tombe enceinte de Wallacette, dite Dot, une petite fille qui synthétise quasiment tous les personnages de ce roman en un personnage dur, cinglant mais plein de ressources et avide de quêter quelque chose en plus, quelque chose pour vivre pleinement.
La lumière de la cour jetait une vague lueur dans son dos. Les conifères semblaient d'une noirceur impénétrable, et même effrayante. Mary songea aux vagabonds, aux hiboux, aux mouffettes et aux souries enragées que le brise-vent abritait peut-être. Elle s'avança pourtant dans l'herbe haute. Avec ce premier pas, elle sentit la pesanteur s'accumuler dans ses jambes. Au suivant, ses yeux avaient hâte de se fermer. Elle plongea tout de même en avant, parmi les branches entrecroisées. La terre était humide, fraîche, et Mary s'enfonça dans l'herbe. Elle eut l'impression, dans sa transe, que beaucoup de temps passait. Les prunes étaient vertes et dures lorsqu'elle s'était allongée, les graines des mûres invisibles, l'herbe verte et souple. Puis la lune monta dans le ciel, les étoiles tournoyèrent en motifs pailletés, des oiseaux s'envolèrent. La saison déclina et le bébé de Célestine devint aussi grand que le jour.
Le pique-nique des orphelins pourrait avoir quelque chose de tragique, comme si le fardeau du passé se portait sur plusieurs générations et distillait, mine de rien, ses conséquences sur les êtres futurs. Le passé influence présent et avenir, certes, mais chez Louise Erdrich, on sent à quel point tous ces temps s'imbriquent, fusionnent, se répondent. A travers une construction pourtant linéaire a priori - ici, les années se suivent ; nul va-et-vient ne vient perturber la progression des ans - on sent la forte influence d'un temps cyclique où les événements sont tressés et inter-dépendants. Ce jeu d'échos est particulièrement brillant, fascinant et fait profondément résonner le récit de tous ces êtres à la fois très seuls, dont l'unicité ne fait aucun doute, et fonctionnant en même temps tous ensemble comme les cordes d'un même instrument. Dot, la fameuse jeune fille qui les réunit tous, s'inscrit comme le point d'orgue de ce temps cyclique. Elle qui, avec le plus de force et d'affirmation, voit une forme d'échappatoire et d'espoir dans l'acte de sa grand-mère Adélaïde, boucle précisément la boucle sans toutefois rejouer exactement la partition passée. Ce fameux temps cyclique ne fait pas tourner les êtres en rond. Il rappelle le passé, le rend vivant et porteur d'avenir, les êtres s'y enracinent, y puisent la sève nécessaire pour exister, se construire puis avancer. Alors, progressivement on se détache, on agrandit le cercle : on perpétue et on continue à inventer. Tel est le message finalement très lumineux de ce roman choral passionnant, vibrant, plein d'ombres de relief.
Le pique-nique des orphelins de Louise Erdrich, Albin Michel, 2016[1986], 468p.
09:06 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : pique-nique, orphelins, mary, karl, adare, sita, wallacette, dot, celestine, argus, dakota, louise erdrich, littérature amérindienne
09/09/2016
La maison de l'aube de N. Scott Momaday

La maison de l'aube de N. Scott Momaday, Folio, 2005[1966], 300p.
Littérature amérindienne II, le retour ! Depuis mon mémoire sur le sujet, c'est-à-dire il y a deux ans, je n'y avais plus retouché. Pas tellement de façon consciente mais il faut croire que je suis tombée dans le même triangle des Bermudes que tous les post-mémoires ou post-thèses : un besoin de lire ailleurs si on y est. Et puis, on revient toujours à ses premières amours voire, dans le cas présent, j'en reviens aux sources de mes premières amours puisque La maison de l'aube, publié en 1966 est considéré comme LE roman marquant de la renaissance amérindienne littéraire.
Il y est question d'Abel, un jeune métis dont on ignore qui est le père : peut-être un Navajo, un Sia ou un Isleta ? Il ne lui reste plus que son grand-père dont on ne saurait dire s'il est proche. Abel glisse sur le flot de la vie : tantôt en communion avec une nature aride, solitaire, tantôt dans l'impossibilité de communiquer avec les hommes, dans l'impossibilité d'être en adéquation avec cette vie et ce monde. Cette quasi-absurdité le conduit à tuer un "homme blanc" - non pas l'homme blanc habituel des récits amérindiens mais un albinos, étranger et étrangeté par excellence - et à vivre une errance chaotique à Los Angeles après son séjour en prison. Des tours et détours, des rencontres et bien des déboires pour finir, peut-être, par rentrer chez lui.
Décidément, certains éléments de la littérature amérindienne ne trompent pas : le topos du métis comme protagoniste, symbole de l'errance identitaire, l'importance d'une narration fragmentée et cyclique, l'image répétée du tambour comme cercle de vie, l'impossibilité de communiquer, la figure de l'aïeul... Que d'éléments qu'il me semble avoir lus bien des fois chez bien auteurs amérindiens, à chaque fois selon des nuances et des modalités différentes. A chaque fois, aussi, traités avec plus ou moins de talent stylistique.
Je ne vous cache pas avoir ressenti une petite pointe de déception au cours de ma lecture. C'est qu'on commence à être exigeant, à force de connaître un peu mieux les ficelles... Il m'a fallu me rappeler à plusieurs reprises que tout ce qui est devenu, aujourd'hui, un cliché était vierge à l'époque d'écriture de Scott Momaday. Il a été le précurseur de tout un renouveau aussi bien littéraire qu'identitaire. Ce statut de défricheur à ses deux revers, comme toute médaille : d'une part on ne peut que saluer l'inventivité et la prescience, d'autre part, on ne peut s'empêcher de relever quelques maladresses, quelques lourdeurs, quelques tentatives un peu hasardeuses. La principale difficulté de lecture, à cet égard, réside à mon sens dans une fragmentation encore malhabile et donc parfois pénible. Autant j'avais adoré la fragmentation virtuose de Ceremony chez Leslie Marmon Silko, pourtant très ardue, abrupte, et qui ne rend donc pas la lecture aisée, autant la fragmentation de Momaday m'a paru moins à propos à de nombreuses reprises, moins subtile dans ce qu'elle ambitionnait de mettre en lumière. Le récit de La maison de l'aube est honnêtement moins fort et moins passionnant que celui de Ceremony, de manière générale - Je précise que je me permets cette comparaison car les deux romans écrits à une dizaine d'années d'intervalle ont une histoire très similaire. Ils poussent même le vice jusqu'à situer le récit dans la même région des USA. Il faut croire que Marmon Silko a particulièrement bien retenu la leçon initiée par Momaday pour la transcender de façon encore plus géniale dans son propre roman dix grosses années plus tard.
En somme, La maison de l'aube représente une excellent document pour qui, passionné de littérature amérindienne, aimerait goûter aux sources d'une flopée d'auteurs postérieurs passionnants. Il ne manque pas d'intérêt, met en lumière à la fois tous les éléments narratifs et toutes les problématiques qui seront au coeur de cette littérature riche d'Histoire et d'avenir. De nombreux morceaux sont délicieusement poétiques et font évidemment montre d'un talent indéniable. Toutefois, ce n'est certainement pas ce que j'ai lu de plus vibrant, de plus marquant de cette période de renaissance amérindienne. Quitte à choisir, je conseillerai indéniablement Ceremony de Marmon Silko !

18:43 Publié dans Challenge, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : amérindiens, usa, momaday, littérature amérindienne, métis





