27/08/2016
Les échecs de l'été
Une fois n'est pas coutume, et peut-être parce que cet été aura été particulièrement riche en livres qui me sont tombés des mains, j'ai décidé de garder la trace d'un petit florilège de mes échecs.
Je sais qu'il y a eu dernièrement (et ce n'est pas la première fois) une polémique sur l'intérêt de chroniquer un livre qu'on n'a pas aimé et, a fortiori, un livre qu'on n'a même pas fini. Après tout, sur quoi se base-t-on pour émettre un jugement (forcément péremptoire) si l'on n'a parcouru que le tiers, le quart voire le dixième du livre ? Que cela plaise ou non aux auteurs, je suis persuadée (et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent beaucoup de critiques et d'éditeurs, je n'ai donc pas inventé le concept) que le style et le propos d'un livre se cernent assez rapidement entre les premiers chapitres, et quelques autres pages prises au hasard. On saura vite si on a affaire à un bon roman, un grand roman, un chef d'oeuvre intersidéral, un ovni (et je classe dans cette catégorie les livres qui me laissent toujours dubitative au début de la lecture, ceux dont je ne sais quoi penser - dans ces cas-là, je poursuis toujours), un roman médiocre, un roman commercial, un roman déjà écrit cent fois et/ou un roman surfait. Ce n'est sans doute pas infaillible, évidemment. C'est sans doute aussi pétri de subjectivité. Mais à partir du moment où cette subjectivité est bonne à dire lorsqu'elle est positive, l'inverse doit être également valable.
Partant de cette idée, je me dis qu'un partage des romans interrompus peut représenter autant d'intérêt que le partage d'un coup de cœur. En tout cas, pour ma part, je suis très curieuse d'échanger au sujet de ces échecs, afin de saisir ce que j'ai peut-être raté, de me sentir aussi moins seule dans mon ennui ou mon agacement face à certains ouvrages, et/ou, pourquoi pas, me faire changer d'avis et m'inviter à repartir du bon pied avec un livre rencontré au mauvais moment.
*
 Les singuliers d'Anne Percin, Le Rouergue, 2014, 393p. (J'ai constaté en librairie avant-hier qu'il venait de sortir en poche chez Babel.)
Les singuliers d'Anne Percin, Le Rouergue, 2014, 393p. (J'ai constaté en librairie avant-hier qu'il venait de sortir en poche chez Babel.)
Que de promesses pour ce roman épistolaire qui plonge son lecteur au cœur d'une communauté artistique de la fin du XIXème, entre le fantasme (Hugo Boch et Hazel sont, entre autres, des mirages de l'auteure pour mener à bien son processus narratif) et la réalité (où l'on croise un Gauguin truculent, jouisseur et l'image d'un Van Gogh déjà évanescent, insaisissable). Le roman se veut la peinture bouillonnante d'une fin de siècle en pleine création et mutation : la peinture ne cesse de se renouveler, la photographie et la Tour Eiffel deviennent les symboles de la technologie faite art, les femmes commencent à être acceptées en écoles d'art et, dans tout ce tourbillon, les voyages forment toujours le mieux les artistes. C'est bien souvent du côté de petits villages perdus de la Bretagne d'Hugo Boch devise sur le monde, ses amis, l'inspiration, laissant deviner au lecteur une communauté éclectique et passionnante.
Connaissant mon amour de l'art, de la peinture en particulier et de la peinture du XIXème encore plus précisément, connaissant une certaine accointance pour l'épistolaire depuis un certain chef d'oeuvre du genre que je place au panthéon des miracles de la littérature, ce livre était fait pour moi à condition d'être à la hauteur des deux domaines sus-mentionnés - ce qui ne fut pas le cas, vous le voyez venir : entre une correspondance cousue de fil blanc (quoiqu'à ce stade-là, on frise le fluo) à laquelle on ne croit pas trois lettres et des propos sur l'art d'une banalité déconcertante, j'ai réussi à m'acharner sur 200 pages très molles avant d'abdiquer face à la platitude du style et l'inexistante profondeur du propos. Certains morceaux sont doux, plein de bonnes intentions, et parfois, pas trop mal vus mais l'ensemble est malheureusement trop lisse et trop superficiel à mon goût. Ecrire un livre sur la création artistique en se contentant de collectionner les clichés ne peut me convenir. Ce n'est pas désespéramment mauvais, non, c'est simplement médiocre - et je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, en fait.
 Le grand marin de Catherine Poulain, L'Olivier, 2016, 368p.
Le grand marin de Catherine Poulain, L'Olivier, 2016, 368p.
Je ne vais pas vous faire l'affront de résumer l'histoire de ce roman, parce qu'en toute honnêteté, je ne m'y suis pas acharnée très longtemps (beaucoup moins longtemps que le livre d'avant par exemple). Du coup, je ne sais même pas véritablement de quoi ça parle, à part ce que j'en ai lu dans les revues critiques et sur les blogs. Ce qui m'a par contre franchement marquée dès les premières pages, c'est l'incompréhension totale que j'ai ressenti lorsque j'ai attaqué le bouquin, pleine d'enthousiasme à la lecture des éloges démentiels qui en avaient été fait. Sans tourner autour du pot ni faire des courbettes diplomatiques, j'ai tout bonnement trouvé le style de Catherine Poulain d'une nullité limite insultante pour le lecteur et ce qu'elle racontait pas beaucoup plus élevé. Or quand je vois tous les prix que ce roman a glanés, tous les avis positifs qu'il a suscités dans des revues ou sur des blogs que je sais exigeants dans leurs lectures, je me dis que j'ai dû louper une marche, me planter de bouquin, ou faire une indigestion de champignons hallucinogènes. Avis à tous les lecteurs du Grand marin donc : qu'avez-vous trouvé au style (qui, définitivement, m'est rédhibitoire - non, en fait, vraiment, je le trouve insultant), à l'histoire ?! Ou inversement, y-a-t-il des lecteurs déconfits qui ont fait le même constat d'échec agacé que moi ?

Le huitième livre de Vésale de Jordi Llobregat, Le cherche midi, 2016, 620p.
Rien de tel, lorsqu'on est en panne estivale de lecture, qu'un bon thriller un poil obscur, historique, érudit et, qui sait, peut-être un peu ésotérique. En repérant ce roman sur le site du Cherche Midi qui mentionnait une comparaison avec Carlos Ruiz Zafon, j'ai immédiatement pensé à Marina que j'avais fort apprécié. Communauté linguistique oblige, j'ai aussi beaucoup pensé à José Carlos Somoza dont je dévore chaque ouvrage. Bref, ce roman devait me réconcilier avec le plaisir de dévorer avidement des centaines de pages en une après-midi, ce qui m'a décidé à le demander en SP (une fois n'est pas coutume).
Et là, c'est le drame... La scène d'ouverture, découverte d'un corps non identifié, presque irréel et donc censé être hautement flippant, est à la limite du risible. Soit, une plantade arrive et la tentation du cliché, dans ce genre littéraire, n'est jamais loin. Il faut savoir accepter de passer outre certaines facilités pour se laisser embarquer (oui, je suis faible, parfois). Poursuivant, donc, je découvre que les chapitres suivants dévoilent un personnage clé successivement, et l'histoire est ainsi vue alternativement par tel ou tel regard - regard qui perpétue malheureusement le cliché sus-mentionné : qui, le tout jeune professeur d'université à qui tout sourit mais qui reçoit une lettre le ramenant sur les traces de son passé (suspeeeeeeens), qui le journaliste pouilleux, endetté jusqu'à la moelle, risée de son journal mais qui cache, en fait, un scoop en or massif qu'il ne peut pas tout de suite dévoiler (ouh ouuuuuh), qui un personnage mystérieux dont la noirceur frise en fait le satanisme de farces et attrapes (depuis que beaucoup trop d'auteurs se sont amusés avec). Bref, on en revient aux ficelles fluo que j'évoquais tout à l'heure chez Anne Percin, à la différence près que j'ai trouvé ici une prétention narrative pas du tout en accort avec le mauvais style de gare effectif de l'auteur. Cette prétention fallacieuse a achevé de me rendre le bouquin carrément détestable. Anne Percin avait le mérite d'être d'une sincérité humble dans ses mots. Ici, jordi Llobregat semble persuadé d'avoir inventé la poudre alors qu'il écrit, à tout casser, un mauvais thriller déjà écrit cent fois, pompeux, ennuyeux et téléphoné.
Je m'excuse auprès du Cherche Midi qui a eu la gentillesse de me faire parvenir ce roman pour cet avis virulent et sans aucune nuance. Ça ne m'arrive pas souvent de trouver un livre à ce point mauvais mais quand c'est le cas, je préfère ne pas tourner autour du pot.
*
Quelqu'un parmi vous a-t-il lu l'un de ces trois romans ? J'attends vos avis divers et variés - plus pondérés, mitigés, aussi virulents que moi, dubitatifs, tranchés, opposés, passionnés, à paillettes ? - pour enrichir mes propres lectures !
16:12 Publié dans Divers, Littérature anglophone, Littérature française et francophone, Littérature hispanique | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : le grand marin, les singuliers, le huitième livre de vésale, livre, livres, vésale, peinture, xixème, gauguin, van gogh, hugo boch, boch, lili, marin, jordi llobregat, catherine poulain, anne percin, l'olivier, cherche midi, rouergue, thriller, prix littéraires
25/05/2016
Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez
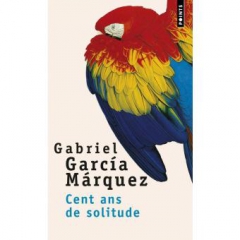
Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, Points, 1997 [1967], 461p.
Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace.
 On dit des grands romans qu'ils se repèrent dès la première phrase. Il en va ainsi Du côté de chez Swann ou de Mrs Dalloway. Il en va de même pour Cent ans de solitude dont le génie éclabousse dès l'incipit - ce génial incipit où le réalisme merveilleux de Garcia Marquez se dévoile éblouissant, drôle, savoureux, parodique et lyrique tout à la fois.
On dit des grands romans qu'ils se repèrent dès la première phrase. Il en va ainsi Du côté de chez Swann ou de Mrs Dalloway. Il en va de même pour Cent ans de solitude dont le génie éclabousse dès l'incipit - ce génial incipit où le réalisme merveilleux de Garcia Marquez se dévoile éblouissant, drôle, savoureux, parodique et lyrique tout à la fois.
Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons en glaise et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et, dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineau, qui répondait au nom de Melquiades, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés, et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melquiades. "Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un accent guttural ; il faut réveiller leur âme, toute la question est là."
Au commencement était Macondo - puisque tout est mythique dans ce roman où chaque phrase contient le monde et toute l'histoire est une prophétie de solitude infligée à la descendance du couple premier José Arcadio et Ursula Buendia pour avoir commis le péché d'inceste puis le meurtre. Descendance ô combien hallucinante et hallucinée, entre le rêve et la cruauté la plus brute, où chacun dessine les contours cent fois vécus et réinvente en même temps le présent d'un village fantasmé. Aux sentiments violents de la passion, de l'orgueil ou de la gourmandise se mêlent les guerre et les fléaux, un déluge impressionnant, la colonisation ou la dictature militaire. Entre les mailles d'une nouvelle Bible gorgée de sang et des fleurs délicieuses d'un style tout en nuances sous les atours de l'hyperbole, Garcia Marquez évoque aussi l'Histoire de son pays et construit le mythe de la Colombie à travers le mythe de l'Homme.
Se succède ainsi une série de vies entrecroisées, tantôt fulgurantes, tantôt étonnamment dilatées, qui se répètent inlassablement, suivant un déclin pré-destiné. Un tel projet enjoint deux réflexions au lecteur au fil de la lecture : la première est relative à l'intelligence de la construction, l'admiration face à l'ampleur d'un univers imaginaire ahurissant ; la deuxième avoue pourtant la difficulté d'en suivre les méandres sur la longueur tant la circularité des destins - les nombreux prénoms identiques - peuvent perdre à force de se répéter. Malgré tout, c'est l'impression d'avoir touché du doigt un chef d'oeuvre comme on en fait peu qui prévaut indéniablement. La certitude que Garcia Marquez est un prix Nobel évident. Je n'ose imaginer quel pouvait être le cerveau d'un tel homme. Etait-ce d'ailleurs encore un homme, à un tel stade du génie ?
Il n'y avait, dans le coeur d'un Buendia, nul mystère qu'elle ne pût pénétrer, dans la mesure où un siècle de cartes et d'expérience lui avait appris que l'histoire de la famille n'était qu'un engrenage d'inévitables répétitions, une roue tournante qui aurait continué à faire des tours jusqu'à l'éternité, n'eût été l'usure progressive et irrémédiable de son axe.
 Challenge des 100 livres à lire chez Bianca
Challenge des 100 livres à lire chez Bianca
24ème participation
15:51 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature hispanique | Lien permanent | Commentaires (10)
13/03/2015
L'Appât de José Carlos Somoza

L'Appât de José Carlos Somoza, Babel, 2014, 531p.
Dans un Madrid presque semblable au nôtre mais qui aurait subi un terrible attentat quelques années plus tôt, un fameux 9 novembre (vas-y lecteur, lis le jour et le mois à l'envers), la Police a maintenant recours à une arme révolutionnaire : les appâts. Il n'est plus question d'attendre que les criminels se manifestent pour les épingler, au risque de faire de nombreuses victimes au passage. Non. Maintenant, on va les chercher. Et quand je dis "on", je veux dire les appâts. Des hommes, des femmes et même des enfants, tous entraînés et conditionnés à chaque minute de leur vie pour percer à jour le plaisir des êtres et ainsi les manipuler. Cette méthode se base sur la découverte révolutionnaire des psynomes par Victor Gens. Tout comme nos caractéristiques physiques sont inscrites dans le génome, nos caractéristiques psychologiques, toutes déterminées par le désir, s'énoncent clairement par le psynome. Chacun vit, agit, réagit en fonction de son désir. Le libre-arbitre dans tout ça, et les sentiments ? Une expression du désir, tout simplement. Il existe évidemment autant de psynomes que d'êtres vivants. Néanmoins, beaucoup se recoupent par des caractéristiques communes, que l'on peut classer en grands groupes : les philias. Et c'est là qu'entrent en scène les appâts. Ces derniers sont capables d'identifier la philia de tout un chacun et d'agir en fonction pour posséder et soumettre. Voire pour tuer - d'un excès de plaisir qui confère à la folie. Au fond, les appâts sont des acteurs professionnels qui feignent tout et charment tous grâce au plus grand des dramaturges : William Shakespeare. En chacune de ses pièces, les ingrédients pour envoûter une philia, appelés "masques". Bienvenue dans la dystopie de Somoza où la vie est un théâtre.
Rentrons à présent dans le vif de l'intrigue. Diana Blanco est un des appâts les plus doués de la capitale espagnole. En bonne philique de Travail, elle fait preuve d'une pugnacité sans pareille lorsqu'il s'agit de traquer un psycho. Justement, Diana est assignée à celle du Spectateur, un des plus dangereux serial killer depuis des lustres - depuis Jack L’éventreur, en gros. Tandis qu'elle envisageait un temps un retrait de la profession par amour (mais encore une fois, cela existe-t-il vraiment dans ce monde étrange régit par le désir?), l'enlèvement de sa sœur par le Spectateur vient chambouler tous les plans et la pousse à tout tenter pour sauver sa seule famille.
Et bien, on ne va pas se mentir : ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un Somoza aussi malsain. Les univers de l'auteur sont toujours alambiqués et à la limite du tordu, soit, je commence à en avoir l'habitude, mais ce qui les caractérisent le plus, à mon sens, est leur complexité et l'érudition qui les sous-tend. Si cela est toujours vrai dans L'Appât, on ne peut nier qu'une noirceur glauque et gluante colle en outre à chaque page et crée une atmosphère dérangeante à souhait. Ce n'est pas tant la monstruosité des serial killers (oui, des. Mais je ne vous en dis pas plus car comme dirait River Song : Spoileeeeeers) qui l'installe - bien qu'ils y participent de tout leur soûl - mais cette idée du psynome, des philias et des appâts. Que sommes-nous, si tout est désir ? Que deviennent la Raison, la volonté, la capacité de choisir et d'aimer ? L'homme n'est pas même un animal ; il est un pantin. Un pantin, qui plus est, répertoriable comme un bon dossier. Tel pantin est philique d'Holocauste, tel autre d'Aura ou de Demande. Et dès lors, vous n'être plus seulement un pantin aux mains de votre désir mais aussi aux mains des appâts qui se serviront de vous comme d'un vulgaire accessoire de théâtre. Absolument tout est factice et manipulable. Franchement, quand on fait le point sur la question, il y a de quoi frissonner. Le plus délicieux étant la manière dont ceux qui usent ou chapeautent toute cette entreprise de domination par le désir parviennent à justifier leurs actes. On est en droit de se demander qui est véritablement le psycho dans l'histoire.
Et pourtant, tout cela est malsain mais je le trouve aussi délicieux, disais-je. Je dois être philique de Somoza. A chaque roman, j'ai beau soulever tel ou tel défaut, telle ou telle faiblesse, tel ou tel point qui me déplaît ou me chatouille, je dévore quand même le pavé comme une affamée. Ici, l'auteur renoue en plus avec les ressors du thriller qui ajoutent clairement un zeste de plus à des qualités déjà avérées de cuistot du page turner. J'ai commencé par être dérangée, puis par m'interroger, pour enfin être accrochée sans restriction. De l'accrochage à la séduction qui réjouit le désir d'un bon roman, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi sans bouder mon plaisir et, comme toujours, sans voir les pages et les heures défiler.
 Challenge Un pavé par mois chez Bianca
Challenge Un pavé par mois chez Bianca
Participation de mars
19:45 Publié dans Challenge, Littérature hispanique, Polar | Lien permanent | Commentaires (8)




