13/05/2013
Accabadora de Michela Murgia
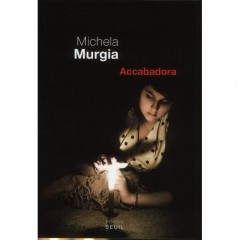
Accabadora de Michela Murgia, ed. Seuil, 2011 (édité en poche chez Point en 2012), 212p.
Dans la Sardaigne des années 50 où subsiste superstitions et traditions, Maria est cédée par sa mère à l'énigmatique Bonaria Urria. Elle devient alors fill'e anima, une fille d'âme "doublement engendr[ée] de la pauvreté d'une femme et de la stérilité d'une autre", comme nous le dit joliment l'auteur. Elle grandit en apprenant à être la seule là où elle n'était rien jadis, joue avec le jeune Andria lors des vendeanges estivales et met le voile sur les absences nocturnes de Tzia Bonaria. Pourtant, quelques années plus tard, le frère aîné d'Andria décède la nuit de la Toussaint. L'adolescent était alors caché et identifie dans un éclair de lune la Tzia Bonaria en train d'étouffer Nicola. Tout d'abord incrédule puis profondément choqué, il en informe Maria. Et de fait, elle découvre que Bonaria Urria est l'accabadora, la dernière mère. Celle qui porte les vivants en agonie vers le dernier souffle. La confiance de Maria s'effondre alors et elle décide de partir...
Ce livre là m'attirait depuis sa sortie littéraire en 2011 par sa couverture à la fois douce et mystérieuse, sans trop savoir pourtant de quoi il retournait (encore un ouvrage abondammant chroniqué sur les blogs dont j'avais zappé les chroniques...). Je l'ai déniché par hasard à la bibliothèque, sentant que c'était le bon moment de le découvrir.
Et ce fut une très belle lecture ! J'ai immédiatement été charmée par le style de Michela Murgia qui déploie une délicate poésie sans faire preuve d'artifice ni d'inutiles fioritures - j'ai pris au contraire plaisir à suivre cette langue simple et inspirée qui s'offre à au lecteur comme un conte. La relation entre Maria et sa seconde mère sans âge, habillée d'amples jupes noires, est l'occasion de plonger dans un petit village de Sardaigne hors du temps où tout se dit et se sait, et où la tradition de l'accabadora résiste comme celle d'humer l'air pour lancer le début des vendeanges. Je ne connaissais rien de cet étrange rôle qu'endossait certaines femmes pour soulager des souffrants en fin de vie et ai éprouvé un sentiment de sympathie pour le personnage intègre de Tzia Bonaria.
Je vous recommande chaudement la lecture ce conte au sujet certes difficile mais au style envoûtant et plein de talent. Auteur à suivre, sans aucun doute !
 Ce livre participe au challenge "A tous prix" chez Laure
Ce livre participe au challenge "A tous prix" chez Laure
Prix Campiello 2010
09:03 Publié dans Challenge, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (15)
10/09/2012
Si c'est un homme de Primo Levi

Si c'est un homme de Primo Levi, 1947
Si je devais choisir un seul livre témoin des camps de concentrations, ce serait celui-là. Non que j'en ai lu beaucoup d'autres et non qu'ils ne m'aient pas bouleversée. Mais c'est ouvrage de Primo Levi est plus que bouleversant : il est essentiel.
Re-situons dans le contexte. Primo Levi à vingt-quatre ans lorsqu'il est déporté à la suite d'une arrestation inévitable. Il ironise lui-même sur le caractère passablement amateur et superficiel de son engagement dans un groupe de résistants sans moyen ni expérience. Lors de son arrestation, il pense à tort qu'il risque plus gros en se déclarant opposant politique que juif ; il opte donc pour la seconde alternative. Il est envoyé quelques jours plus tard, au tout début de l'année 1944, avec quatre-vingt seize autres juifs italiens au camp d'Auschwitz. Il y restera durant une année, échappant avec étonnement à l'hiver implaccable, la faim, les maladies et la chambre à gaz jusqu'à l'arrivée de l'armée russe en janvier 1945.
Le présent témoignage, dont Primo Levi commence la rédaction dès décembre 1945 - pour ne rien oublier, dans l'urgence nécessaire de dire, de faire connaître - relate cette année hors des hommes libres.
Je pourrais ergoter longtemps sur le caractère saississant, vibrant, terrible de ce récit. Nul ne peut ressortir de cette lecture sans la prégnante sensation d'avoir été assommé avec une poele en fonte. Mais au delà de ce retournement des tripes, il y a aussi et surtout l'ouverture à une série de questionnements essentiels. Car Primo Levi a choisi pour rédiger son ouvrage un ton volontairement neutre, ou disons au plus près de la neutralité - le plus possible dépourvu de pathos afin de laisser au lecteur la distance nécessaire pour apprécier le texte comme levier d'un raisonnement. Le point essentiel est là : Si c'est un homme n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières ou pour soulager son auteur - on comprend la futilité de supposer un tel objectif au bout d'une trentaine de pages tant rien ne pourrait soulager une telle expérience ; il est là pour faire en sorte qu'un deuxième Auschwitz n'existe jamais.
Et tous les questionnements, au fond, portent sur l'humanité.
Il est question d'humanité lorsqu'une mère, sachant qu'elle va à la mort, s'applique à nettoyer et à nourrir son enfant comme si rien n'allait changer.
Il est question d'humanité lorsqu'un civil est capable d'offrir une chemise à un détenu sans rien demander en échange, par bonté pure - et de lui rappeler en cela que malgré tout l'acharnement des nazis, il est encore un homme.
Il est question d'humanité lorsqu'on parvient à balayer la tentation de la haine après une telle expérience.
Il est aussi, malheureusement, question d'humanité lorsqu'on touche à la volonté abyssale de démolir un homme, méthodiquement, avec l'oeil froid ou lorsqu'on s'aperçoit que la brute engendre la brute et que le supplicié d'hier se défoule le lendemain sur ses subalternes sans aucune mauvaise conscience (et les exemples de ce triste état de fait dans l'Histoire, oserais-je dire encore aujourd'hui, sont nombreux).
Les exemples pourraient être énumérés à l'infini.
Enfin, il est encore question d'humanité lorsque tout le long, Primo Levi questionne le langage et affirme à plusieurs reprises combien nos mots d'hommes livres ne peuvent dire le vécu des camps. Au fond, transparait cette question : comment écrire, comment créer tout simplement après la seconde guerre mondiale. Question à laquelle j'éviterais, évidemment, de répondre une formule ridicule de philosophie de comptoir mais qui mérite néanmoins de trotter dans nos têtes de littéraires.
Après hésitation et relecture de ce bouquin, j'ai décidé de le faire étudier à ma classe de 3eme pro cette année. C'est un ouvrage clairement difficile, tant dans le fond que dans la forme et sans doute que pas mal d'entre eux, si ce n'est la totalité, n'en lirons même pas les vingt premières pages. Malgré tout, le simple fait de prendre le temps d'en parler en classe et de lancer quelques bribes de questions, pourquoi pas d'en faire matière à débat, leur allumera peut-être quelques lumières insoupçonnées. Il me semble que Si c'est un homme soulève trop de questions primordiales pour être balayé par la peur de la difficulté. Je croise les doigts pour que cette année me donne raison.
En attendant, si tu tombes sur ce modeste article et que tu n'as pas encore lu Si c'est un homme, un seul conseil : accroche-toi et lis.
 Challenge Un classique par mois
Challenge Un classique par mois
Septembre 2012 bis (je rattrape Août comme ça !)
09:00 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Littérature italienne, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (4)
11/03/2012
Requiem d'Antonio Tabucchi

Requiem d'Antonio Tabucchi, traduit du portugais par Isabelle Pereira et la collaboration de l'auteur, ed. Christian Bourgois, 1993/Folio 2006, 184p.
Sous-titré "une hallucination", cet ouvrage ne pourrait être mieux décrit. Escapade fantaisiste, fantasme de rencontres improbables, le lecteur est invité à vivre douze heures de grand n'importe quoi. Il aura pour acolyte un personnage qui ne comprend pas plus ce qui lui arrive. En train de lire tranquillement la seconde d'avant, il s'assoupit et se réveille dans un Lisbonne halluciné où il va évoluer durent une journée de juillet. Il croisera toute une série de personnages étranges, fascinants - imaginaires ou réels, vivants ou morts - le tout dans un enchaînement délirant jusqu'à dîner avec un raconteur d'histoires que l'on sait grand poète du XX - s'agirait-il de Fernando Pessoa pour qui l'auteur nourrit une grande passion ?
Il y a sans doute mille manières de lire ce type de livres, pour ma part j'en vois deux : soit le lire à cloche pages, en prenant un maximum de recul et de distance, soit prendre du LSD et se marrer comme une baleine en vivant en même temps le voyage. Je vous conseille la première solution (moins risquée pour la santé), et ainsi, on savoure pleinement la loufoquerie de l'ouvrage servie avec une langue rythmée et piquante qui relève bien le plaisir. Ne le lisez surtout pas trop sérieusement, vous risquerez de vous ennuyer et ce serait dommage.
A noter que l'édition Folio nous offre un très chouette appendice en fin de livre, initialement paru dans La NRF en 1999, dans lequel l'auteur revient sur son processus d'écriture et surtout sur le choix d'une langue étrangère pour rédiger cette "hallucination". Un ajout passionnant sur le travail d'écrivain.
*
Incipit :
"Je me dit : ce mec n'arrivera donc jamais. Puis, je pensai : je ne peux pas l'appeler "ce mec", c'est un grand poète, peut-être le plus grand poète du XXe siècle, il est mort depuis longtemps, je lui dois du respect - disons mieux, un grand respect. Malgré tout, je commençais à m'ennuyer ferme, le soleil était brûlant, un soleil de fin juillet, et j'ajoutai pour moi-même : je suis en vacances, je me trouvais tellement bien là-bas, à Azeitao, dans la ferme de mes amis, pourquoi donc ai-je accepté ce rendez-vous ici, sur ce quai au bord du Tage ? C'est complètement absurde. Et je regardai à mes pieds la silhouette de mon ombre, qui me parut elle aussi absurde, incongrue, dénuée de sens, courte comme elle était, écrasée par le soleil de midi, et c'est alors que je me souvins ; il m'a donné rendez-vous à douze heures, mais il voulait peut-être dire douze heures du soir, parce que les fantômes apparaissent à minuit. Je me levai, je longeai le quai. La circulation sur l'avenue avait cessé, les voitures étaient rares, certaines emportaients des parasols sur leur porte-bagages - tous ces gens-là s'en allaient vers les plages de Caparica, il faisait une chaleur étouffante, et je pensai alors : mais qu'est-ce-que je fais ici, le dernier dimanche de juillet ? Et j'allongeai le pas pour arriver le plus vite possible au jardin de Santos, peut-être y ferait-il un peu plus frais."
09:01 Publié dans Littérature italienne, Littérature lusophone | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : voyage, rêve, hallucination, rencontres, lisbonne




