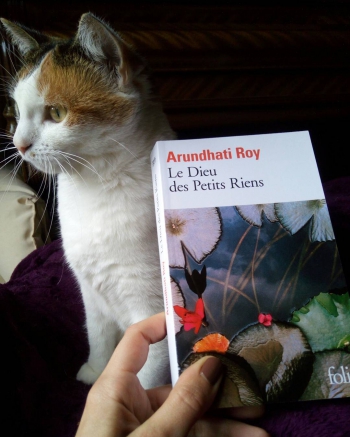28/02/2018
Les fleurs d'hiver d'Angélique Villeneuve
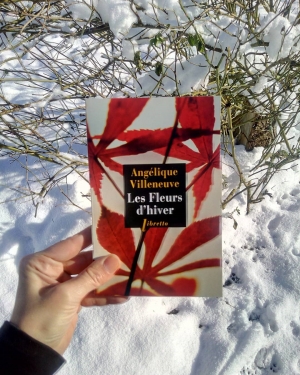 Automne 1918. Il fait déjà froid et Jeanne prie pour que l'hiver à venir ne soit pas aussi rigoureux que le précédent. Elle vit seule avec sa petite Léonie depuis le début de la guerre et trime comme ouvrière fleuriste. Le poêle tourne à peine, la moindre denrée est rare et précieuse. Malgré l'aide de la voisine Sidonie, malgré la saison riche en commandes de fleurs, le quotidien de Jeanne et Léo est rude, et triste aussi de l'absence de Toussaint. Dans les premiers temps de la guerre, ces deux-là se sont écrits. Les mots ont dessiné un nouvel amour, un nouveau désir, la continuation d'une vie à deux. Et puis Toussaint a été blessé et transporté au Val de Grâce. Toussaint est vivant mais brisé. En même temps qu'il refuse d'être vu, les mots lui échappent. C'est le silence qui s'instaure avec le monde et avec Jeanne. Il lui écrit Je veux que tu viennes pas et ces mots-là résonnent douloureusement en elle.
Automne 1918. Il fait déjà froid et Jeanne prie pour que l'hiver à venir ne soit pas aussi rigoureux que le précédent. Elle vit seule avec sa petite Léonie depuis le début de la guerre et trime comme ouvrière fleuriste. Le poêle tourne à peine, la moindre denrée est rare et précieuse. Malgré l'aide de la voisine Sidonie, malgré la saison riche en commandes de fleurs, le quotidien de Jeanne et Léo est rude, et triste aussi de l'absence de Toussaint. Dans les premiers temps de la guerre, ces deux-là se sont écrits. Les mots ont dessiné un nouvel amour, un nouveau désir, la continuation d'une vie à deux. Et puis Toussaint a été blessé et transporté au Val de Grâce. Toussaint est vivant mais brisé. En même temps qu'il refuse d'être vu, les mots lui échappent. C'est le silence qui s'instaure avec le monde et avec Jeanne. Il lui écrit Je veux que tu viennes pas et ces mots-là résonnent douloureusement en elle.
C'est tout. Mais c'est loin. C'est loin et c'est trop près.
Jeanne s'avance vers lui et ses yeux sautillent, elle les voudrait solides et voilà qu'ils sursautent, indociles.
A cet éclair blanc, là-bas, ils se brûlent.
A son retour, ils doivent se réapprendre. Les corps ont changé - Toussaint est-il plus grand, plus petit ? Pourquoi dort-il tant ? Que se cache-t-il derrière ces bandes ? Comment est son visage ? - et le silence fourrage durement entre tous. Jeanne supporte difficilement le mutisme de Toussaint, dont elle devine certaines raisons mais dont une grande part la rejette, la laisse dubitative et interdite. L'un et l'autre ressentent des émotions contradictoires, sourdes, violentes mais ne savent pas expliquer. Ne savent pas mettre les mots. En fond de ce nouvel apprivoisement, la Grande Guerre n'est pas finie. Elle vient toquer à la porte de Sidonie un beau matin, elle se rejoue perpétuellement dans le corps de Toussaint, elle conditionne tout. La vie, plus que jamais semble fragile et pourtant terriblement déterminée à faire son chemin.
Les hommes. Eugène et Toussaint.
Morts à moitié. Sans sépulture connue.
Les femmes. Sidonie, Jeanne et Léo.
Ni veuves, ni orpheline de guerre, et pourtant demi-mortes d'être toujours vivantes, d'avoir tellement perdu. Elles, les trois, qui ne portent aucun nom, ne peuvent veiller aucun cadavre.
Quel sujet délicat et peu traité finalement, au regard des romans de guerre, que celui du quotidien des êtres loin des tranchées. Mais comment dire le silence ? Quels mots poser sur cet après indicible, terrible : celui du réapprentissage de l'humanité ? La langue d'Angélique Villeneuve s'insinue doucement dans les aspérités de cette réalité obscure, procède de flash-backs et d'avancées feutrées dans le quotidien taiseux de Jeanne et Toussaint. Chaque pas est une victoire ; chaque phrase la tentative d'être et d'aimer encore. L'auteure écrit avec une sobriété et une pudeur excessivement poétiques qui sont un régal à lire sans se presser. Dévorer ce livre serait passer à côté de son essence : celui d'une invitation à laisser le temps guérir les blessures. Au moment où le livre se referme, Jeanne, Toussaint et Léonie ne sont qu'au début du chemin. Nous n'avons accompagné que la naissance d'une nouvelle lumière entre eux. Tout le reste s'appelle la vie.
Certaines choses allaient donc en couple, prenaient en s'épousant une semblable courbure. Certaines choses étaient roses et douces autour d'un cœur noir.
(Et puisque j'ai lu ce roman en miroir de Moka, je me dois de poser la question : Alors, as-tu aimé Au bonheur des dames ? ^^)
10:12 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : les fleurs d'hiver, angélique villeneuve, phébus, libretto, première guerre mondiale, wwi, gueule cassée, souffrance, silence, après, solitude, amour, temps, deuil, mort
18/08/2017
Le dieu des petits riens d'Arundhati Roy
Je ne suis pas une grande lectrice de littérature indienne. D'ailleurs, constatant que la catégorie existait déjà sur le blog au moment d'entamer cette chronique, je suis allée vérifier ce que j'avais bien pu déjà lire et chroniquer ici. Verdict : rien. Je n'ai créé cette catégorie que le jour où j'ai reçu le swap d'Ellettres puisque le roman que voilà s'y trouvait ! Ça veut tout dire. Tiens toi le pour dit donc, cher lecteur : eu égard à la littérature indienne, je sais que je ne sais rien.
Et le plus dur, très franchement, ça va être de commencer à parler de ce livre. Une fois que je serai lancée, ça va le faire. Mais il faut que je prenne le départ. Qu'émerge le commencement de tout.
Est-ce si simple ?
C'est une chose d'envoyer le truisme il y a un début à tout, un autre de débusquer le dit-début, timide et furtif tel qu'il est parfois. C'est là toute la problématique de ce livre : remonter les méandres du temps et des origines d'êtres tortueux et torturés pour déterrer la fêlure ontologique qui les lie tous dans la douleur. Le décor de cette quête impossible, par essence non linéaire, éclatée, fascinante à bien des égards est la ville d'Ayemenem dont la moiteur n'a d'égale que l'exotisme à mes yeux d'européenne. Tout se joue du côté des sens : vue, odorat, goût, toucher, ouïe se pénètrent tour à tour et font pénétrer le lecteur dans un univers terriblement étrange et étranger.
Ayemenem en mai est chaud et maussade. Les journées y sont longues et humides. Le fleuve s'étrécit, les corneilles se gorgent de mangues lustrées dans l'immobilité des arbres vert olive. Les bananes rouges mûrissent. Les laques éclatent. Les grosses mouches bleues sont ivres et bourdonnent sans but dans l'air lourd et fruité. Pour finir par aller s'assommer contre les vitres transparentes et mourir, pansues et effacées, dans le soleil.
Les nuits sont claires mais baignées de paresse et d'attente chagrine. (incipit)
A l'âge adulte, Rahel, émigrée depuis longtemps, rentre au pays retrouver son jumeau Estha qu'elle n'a plus vu depuis ses huit ans. Jadis inséparables, avec un langage bien à eux comme symbole de leur bulle gémellaire, ils ont été séparés subitement après un drame terrible. Tous deux en portent aujourd'hui les séquelles : Rahel mène une vie maritale chaotique ; Estha ne parle plus. Tout s'est joué des années auparavant et les retrouvailles sont l'occasion pour Rahel de déterrer ce lourd fardeau - peut-être dans l'espoir de s'en délester ? En tous cas, de s'en ressaisir, de reprendre possession d'elle-même et de sa relation avec Estha en reprenant possession de leur histoire. La clé de l'avenir en somme, se dénichera dans le gouffre du passé.
A mesure que l'on avance sur ce chemin qui n'a donc rien de linéaire - et il faut parfois s'accrocher pour ne pas perdre le fil ou, au contraire, arrêter quelques temps la lecture pour ne pas s'essouffler comme ce fut mon cas -, on tombe sur des perles d'une noirceur assez décapante. D'autant plus d'ailleurs qu'Arundhati Roy ne joue pas la carte du mélodrame familial convenu qui pince la corde sensible sans autre forme de procès. Tout le poids de cette histoire tragique - puisqu'on voit se dérouler sous nos yeux impuissants une histoire dont on connait dès le départ l'issue fatale - se situe dans le contrepoint loufoque du style et des images : si Estha se vit quelques secondes en sorcière de MacBeth, c'est coiffé d'une banane à la Elvis ! Et ce seul exemple illustre exactement l'essence burlesque de ce roman qui fait sourire et pleurer à la fois.
Tandis que tournait la confiture chaude d'un rouge magenta, Estha se transforma d'abord en Derviche Tourneur à la banane écrasée et aux dents irrégulières, puis en sorcière de MacBeth.
Feu, brûle ; banane, fais des bulles. p. 263
Le dieu des petits riens, pour une de mes premières rencontres indiennes (je n'ose pas dire la toute première : j'ai forcément dû lire un autre roman indien un jour quand même.... non ?), est extrêmement foisonnant, tourbillonnant même, et a fortement suscité ma curiosité. Il n'est pas parvenu à m'hypnotiser totalement mais il m'a indéniablement intriguée. J'ai voyagé en Inde grâce à lui, et dans la profondeur des êtres ; en cela, ce fut sacrément riche.
Merci, Ellettres, pour ce très beau voyage !
L'espace d'un éclair, Velutha vit des choses qu'il n'avait jamais soupçonnées. Des choses jusqu'ici hors de portée, que les œillères de l'histoire avaient laissées dans l'ombre.
Des choses d'une simplicité extrême. p. 239
16:27 Publié dans Littérature anglophone, Littérature indienne, Swap | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : arundhati roy, le dieu des petits riens, inde, estha, rahel, jumeaux, histoire, passé, douleur, temps, deuil, mort, séparation, amour, circularité
08/02/2012
La demande de Michèle Desbordes
[Les inscriptions pour le swap du printemps, c'est par ici. N'hésitez pas!]

La demande de Michèle Desbordes, Verdier, 1998 / Folio, 2001, 141p.
Lui, l'artiste, quitte un beau jour l'Italie pour ne plus y revenir. Il sait qu'il mourra en France, dans ce château près d'Orléans, entouré de ses travaux pour le Roi et de sa solitude d'exilé. Elle, la servante dévouée et discrète, est auréolée de la lumière des jours banals et des travaux érintants du quotidien. On ne sait rien d'elle ; même sa parole est rare. Ils passent des mois côte à côte, s'effleurant, se parlant à peine, ne se connaissant pas et se comprenant pourtant, au-delà des mots. En filigrane de cette relation étrange, indicible et sensible, la mort tisse son nid et prépare la demande au terme de quelques saisons.
Couronné par le Prix France Télévision, entre autres, cet ouvrage - deuxième de l'auteur - a été encensé sans exception par la critique. Pour ma part, je suis dans l'impossibilité d'émettre un avis aussi enthousiaste pour la raison suivante : J'ai découvert Michèle Desbordes il y a quelques années, peu de temps après la publication de son dernier ouvrage, Les petites terres, et suis littéralement tombée amoureuse de ce style au plus près de l'âme, ruisselant dans la demi-teinte de l'attente et du ressassement. Aussitôt, j'ai décidé qu'elle serait l'une des trois auteurs dont j'étudierai l'oeuvre pour mon mémoire de Littérature comparée. De ce fait, j'ai lu beaucoup de ces travaux et au final, je m'en suis lassée - le présent livre, d'ailleurs, avait été acheté à cette époque et laissé en jachère pour cette raison. Le style et le propos de Michèle Desbordes sont captivants, envoûtants lorsqu'on lit un livre ou deux de la sorte. Trois peut-être. Mais au-delà, c'est perpétuellement la répétition du même livre. Alors bien sûr, tous les auteurs ont leur sujet de prédilection et leur manière de le dire mais à ce point là ?! Chez Desbordes, j'en viens à retrouver les mêmes phrases qui n'en finissent pas d'attendre on ne sait quoi, les mêmes paysages, le même déroulement du propos et c'est bien au-delà du simple tic d'écriture. Je ne sais pas... Trop de ressassement tue le ressassement.
C'est quand même étrange comme on peut être passionnément touchée par un auteur et le trouver profondément ennuyeux par la suite...
Cela étant dit, si vous n'avez jamais lu Michèle Desbordes, découvrez-là ! Son écriture est délicate et perçante et d'une grande beauté au premier abord !
*
Extrait :
"Plus que jamais elle se taisait, et le silence et le regard détourné parlaient mieux que n'auraient fait les paroles, ils disaient l'habitde et la résignation, en elle parlaient toutes celles qui s'asseyaient sans rien dire près des fenêtres et croisaient les mains dans leurs jupes, comme en lui qu'elle regardait d'un regard fatigué vivaient tous les idiots, ce qu'ils voyaient n'était qu'un infime, misérable fragment du temps, sans fin ni commencement, depuis longtemps et pendant longtemps encore des gens comme eux s'arrêteraient dans une rue ou un jardin pour regarder un vieil âme ou un idiot, les observeraient en se disant qu'ils regardaient un âne et un idiot de tous les temps, inchangés, éternels comme le ciel et le soleil, les profondeurs effrayantes de la terre, le malheur, le bonheur."
09:00 Publié dans Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : attente, ressassement, saisons, servante, artiste, de vinci, mort, temps, campagne