03/04/2016
Kinderzimmer de Valentine Goby

Kinderzimmer de Valentine Goby, Actes Sud, 2013, 218p.
 N'est pas Valentine Goby qui veut. Comprendre par là : comment parvenir à mettre des mots sur ce roman, qui lui rendent hommage sans le déflorer, et comment mettre des mots sur les camps de concentration, puisque tel est le lieu du roman ? Je tourne autour du pot, j'écris puis j'efface, j'hésite mais il me faut bien arriver au bout de quelque chose. Il faut bien mettre des mots sur cette lecture passionnante et bouleversante à tous points de vue.
N'est pas Valentine Goby qui veut. Comprendre par là : comment parvenir à mettre des mots sur ce roman, qui lui rendent hommage sans le déflorer, et comment mettre des mots sur les camps de concentration, puisque tel est le lieu du roman ? Je tourne autour du pot, j'écris puis j'efface, j'hésite mais il me faut bien arriver au bout de quelque chose. Il faut bien mettre des mots sur cette lecture passionnante et bouleversante à tous points de vue.
Le camp est une régression vers le rien, le néant, tout est à réapprendre, tout est à oublier.
Il faut plonger à Ravensbrück, se faire la puce sur l'épaule de Mila qui s'y trouve avec des milliers d'autres femmes, avec sa cousine Lisette, après une dénonciation. Mila est prisonnière politique. Nous sommes en janvier 1944 et, jusqu'à la fin de la guerre, elle ne codera plus de messages sur des partitions musicales. Elle va connaître, heure après heure, minute après minute, seconde par seconde, la faim, le froid, la honte, la douleur, la maladie. La mort enfin, partout autour, qui pullule comme les poux. Même cet enfant que porte Mila est signe de mort : peut-il seulement y avoir une étincelle de vie dans cet univers noir ? La survie, seulement.
Il n'y a pas un bébé dans ce camp, pas une mère parce que mettre au monde c'est mettre à mort.
Et puis Mila échappe au chien des surveillantes. Pour une raison qu'elle ignore, il ne l'attaque pas. Elle prend ça comme un signe fort, qui reviendra souvent : "Le chien n'a pas mordu", comme une litanie pour croire encore en quelque chose de possible pendant le camp, après le camp. Des amitiés de fortune mais fortes, essentielles se nouent. Surtout celle avec Teresa qui devient la branche sur laquelle s'appuyer pour aider le petit être dans le ventre de Mila à arriver à terme, à survivre lui aussi. Sans le savoir, il devient la branche de toutes ces femmes qui l'attendent, l'espèrent, font leur possible pour le garder en vie.
Vivre est une œuvre collective.
A force de s'accrocher, on veut se souvenir. Mila consigne dans sa tête les dates et les évènements à mesure que la situation allemande se délite. A mesure que l'on compte les jours pour la survie des bébés qui sont pris dans le même flot tragique que les mères. A mesure que l'hiver pénètre dans les os, que des prisonnières sont envoyées vers des camps d'extermination - car il faut faire le ménage avant l'arriver des Alliés. Puis Mila consigne sur des feuillets. Se répète autant que possible, mais tout ne reste pas dans les confins de sa mémoire. Il faut parfois combler les blancs auxquels elle ne peut répondre, des années plus tard, lorsqu'elle raconte son expérience aux lycéens. C'est alors que littérature prend le relai, exactement.
Il faut des historiens, pour rendre compte des événements ; des témoins imparfaits, qui déclinent l'expérience singulière ; des romanciers, pour inventer ce qui a disparu à jamais : l'instant présent.
Nous y voilà donc, à ce devoir de mémoire par l'imaginaire, par le pouvoir des mots d'inventer, de refaire, de tisser les bribes entre elles et de combler les blancs ; par la nécessité de prendre la langue par les deux bouts, de la triturer, de balayer tous ses possibles : longues phrases amples, gestes saccadés, enflures ici et gouffres là, de formuler sans complaisance jusqu'à toucher ces corps qui suintent, meurent, s'exposent à tout.
Kinderzimmer est saisissant, époustouflant. Valentine Goby y fait un impressionnant travail d'écrivain qui se détourne pas les yeux et empoigne la matière de son art avec une force brute, une intensité admirable pour dire très exactement l'indicible. C'est à peu près parfait à tous points de vue, et pour le peu qui ne l'est pas, vu l'ampleur de la tâche thématique et stylistique, ça l'est quand même.
Mila inspire. Je veux tenir sous la glace, persister droite et dure en aiguille de sapin. Je veux être verte, ferme. Je veux m’économiser jusqu’au retour de la lumière, ralentir le battement de mon cœur, mettre mon corps au diapason, faire d’ultimes réserves de sève fraiche et propre, je veux être prête pour la suite, s’il y a une suite.
Une rencontre marquante avec Mila, avec Sacha-James, Lisette, Teresa et les autres, avec ce camp de Ravensbrück et cette improbable pouponnière ; une rencontre marquante, enfin, avec Valentine Goby, dont il me faudra forcément lire d'autres romans !
19:26 Publié dans Coups de coeur, Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (16)
27/12/2015
Une forêt d'arbres creux d'Antoine Choplin
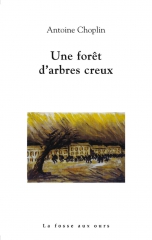
Une forêt d'arbres creux d'Antoine Choplin, La fosse aux ours, 2015, 116p.
 Dans son dernier titre, Antoine Choplin glisse son lecteur dans les interstices de Terezin, en République Tchèque, dans les années 40. Ville ghetto, on y entrepose ceux qui, bientôt, prendront le train et on les occupe à divers postes. On sépare les familles par la même occasion. Bedrich Fritta y séjourne de 1941 à 1944, loge dans des baraquements où la promiscuité n'a que l'insalubrité pour concurrence à la mort, et se voit affecté au bureau des dessins. C'est ici qu'on recycle tous ceux qui ont l'art de manier le crayon, qu'ils soient dessinateurs ou architectes de métier. Il leur revient de créer ces bâtiments mêmes qui les enferment et les détruiront. Pour contrevenir à cette ironie du sort, Bedrich et les autres se retrouvent peu à peu la nuit à la bougie dans le local des dessins pour en produire d'autres, subversifs aux yeux des nazis, criants de vérité. Leur quotidien sous la mine acérée, sur le papier gravé à jamais. Telle est leur résistance face à l'inexorable.
Dans son dernier titre, Antoine Choplin glisse son lecteur dans les interstices de Terezin, en République Tchèque, dans les années 40. Ville ghetto, on y entrepose ceux qui, bientôt, prendront le train et on les occupe à divers postes. On sépare les familles par la même occasion. Bedrich Fritta y séjourne de 1941 à 1944, loge dans des baraquements où la promiscuité n'a que l'insalubrité pour concurrence à la mort, et se voit affecté au bureau des dessins. C'est ici qu'on recycle tous ceux qui ont l'art de manier le crayon, qu'ils soient dessinateurs ou architectes de métier. Il leur revient de créer ces bâtiments mêmes qui les enferment et les détruiront. Pour contrevenir à cette ironie du sort, Bedrich et les autres se retrouvent peu à peu la nuit à la bougie dans le local des dessins pour en produire d'autres, subversifs aux yeux des nazis, criants de vérité. Leur quotidien sous la mine acérée, sur le papier gravé à jamais. Telle est leur résistance face à l'inexorable.
Par son dernier titre, je découvre enfin Antoine Choplin dont on m'a beaucoup parlé avec délicatesse voire hyperboles. De cette découverte, je retiens un art du fragment et de la simplicité que j'aime tout particulièrement ; une écriture qui va à l'essentiel sans oublier de le faire avec élégance et retenue - ce qui sied au sujet difficile des ghettos et de la déportation. Il me faut néanmoins convenir en toute honnêteté, même si cela me vaut d'être à contre-courant des avis sur ce récit, ne pas avoir grand chose d'autre à en dire. Je m'attendais, je crois, à beaucoup plus de poésie - comme il y en a dans certains morceaux, par exemple cette toute première phrase : "Quand il regarde les deux arbres de la place, il pense à tous les arbres du monde". J'aurais voulu que toutes les phrases soient à l'image de celle-ci : simples certes, mais à la poésie éclatante. Malheureusement, les trois quarts du temps, j'ai trouvé une écriture trop blanche à mon goût. Certes non, je n'attendais aucun lyrisme (en même temps, le premier qui amalgame poésie et lyrisme, hein...), mais plus de vibrations, plus de vie. La vérité : je me suis souvent ennuyée. Voilà, c'est dit. Et tandis que je rédige ce billet quelques semaines après ma lecture, je m'aperçois que j'en ai bien peu à en dire. S'il n'y avait pas eu les matchs de la rentrée littéraire de Price Minister grâce à qui j'ai reçu ce titre, il y a même fort à parier que vous n'en auriez jamais entendu parler.
Au fond, c'est un bon livre mais pour d'autres lecteurs que moi.
Merci à PriceMinister pour m'avoir permis de participer une nouvelle fois à leurs matchs de rentrée littéraire ! #MRL15 #PriceMinister
17:58 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (6)
09/10/2015
L'Oeuvre au noir de Marguerite Yourcenar

L'Oeuvre au noir de Marguerite Yourcenar, Folio, 1988 [1968], 469p.
Tout est une question d'alchimie. Les transformations profondes progressent toujours lentement et dans le secret de quelques chambrettes sombres, pour apparaître un beau jour à la face du monde, aussi claires et sonores que l'or après le plomb. C'est un cheminement, le processus d'une vie, d'une œuvre, d'un siècle. C'est précisément ce processus-là qui a pris place durant la Renaissance et que Marguerite (parce que j'ai décidé de la tutoyer) nous découvre passionnant dans L'Oeuvre au noir. Par convenance et praticité, un personnage tient lieu de héros : Zénon, un brin rebelle pour son temps et surtout très en avance dans ses ambitions et ses libertés. Il faut dire que Zénon est un bâtard ; sans doute cette condition bancale pour l'époque appelle-t-elle l'errance joyeuse, sans l'attache d'un nom ou d'une profession familiale. Malgré l'ambition des ordres nourrie par ceux qui l'ont élevé, Zénon s'enfuit jeune sur les routes du monde et se pique de médecine et d'alchimie. Zénon est de ses esprits curieux qui dérangent parce qu'ils cherchent et chatouillent là où ça fait mal. Ainsi, il vaque longtemps, se pose peu. Mais à force de pamphlets divers et variés qui lui mettent quelques mandats aux trousses, il revient dans sa ville belge natale et observe le temps filer comme le vent sous l'auguste pseudonyme de Sébastien Théus.
"Naguère encore, en retrouvant son chemin dans le lacis des venelles de Bruges, il avait cru que cette halte à l'écart des grandes routes de l'ambition et du savoir lui procurerait quelque repos après les agitations de trente-cinq ans. Il comptait éprouver l'inquiète sécurité d'un animal rassuré par l'étroitesse et l'obscurité du gîte où il a choisi de vivre.
Il s'était trompé.
Cette existence immobile bouillonnait sur place ; le sentiment d'une activité presque terrible grondait comme une rivière souterraine...
Le temps qu'il avait imaginé devoir peser entre ses mains comme un lingot de plomb, fuyait et se subdivisait comme les grains du mercure. Les heures, les jours et les mois, avaient cessé de s'accorder aux signes des horloges, et même au mouvement des astres...
Les lieux aussi bougeaient : les distances s'abolissaient comme les jours. "
Mais en marge de Zénon, ne vous y trompez pas : c'est tout le siècle qui mute, toute l'ère moderne qui s'enclenche malgré quelques protestations (parce que, de tous temps, ça a toujours été mieux avant), et tout le talent de Marguerite Yourcenar qui se crée.
Je ne saurais trop vous conseiller de ne pas lire cette auteure à n'importe quel moment. Tout comme Woolf - dont elle a traduit Les vagues, il doit donc y avoir quelque chose entre ces deux auteures - Yourcenar est aussi fascinante et éblouissante que délicate et complexe. L'Oeuvre au noir ne vend certainement pas au lecteur une aventure sensationnelle. Il ne se range aucunement dans la rubrique des romans historiques, même d'excellente facture. Un peu comme dans Les mémoires d'Hadrien, il est question d'Histoire, certes, mais sous son jour le plus philosophique et réflexif. A tel point, très honnêtement, que la deuxième partie peut être parfois pénible à suivre. Autant la première intitulée La vie errante se lit avec un plaisir non dissimulé tant l'érudition s'allie pleine de saveur aux péripéties familiales et voyageuses de différents personnages autour de Zénon. Autant, la suivante, La vie immobile, donne lieu à de nombreuses discussions et considérations intérieures de Zénon dont le lecteur saisit bien toute la portée passionnante mais qui peuvent paraître interminables - et franchement, elles m'ont parfois paru interminables. Je crois que c'est dans ces instants-là que je me rappelle que la philosophie, en tant que matière universitaire où il convient de se gratter la barbichette pendant des heures, ne m'intéresse que peu. La philosophie souffre de trop peu de concision à mon goût et Zénon, par moments, en souffre aussi. Cela dit, et ceci n'engageant que mon absence de passion pour la branlette neuronale trop poussée, il est impossible de ne pas être transporté par le talent extraordinaire de Yourcenar d'allier avec une telle maestria un style fascinant et un fond aussi complexe et érudit.
Chapeau bas, madame Yourcenar ! Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait partie de ces grandes dames de lettres dont on peut abondamment, et sans jamais en faire trop, saluer le talent.
15:33 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12)




