03/09/2016
Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka

Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, Phébus, 2012, 139p.

Sur le bateau nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n’étions pas très grandes.
Nous ne saurons jamais qui parle si ce n'est ce nous, voix polyphonique, vibrante, chœur de femmes toutes différentes, uniques dans leurs expériences, unies dans leur identité.
Le roman commence par un départ vers les Etats-Unis : dans ce pays inconnu, aussi exotique que pourrait l'être pour nous le Japon, ces femmes plus ou moins jeunes, plus ou moins novices, naïves, éduquées, amoureuses, aguerries aux réalités d'une rude existence, pales, déjà mères ou à peine nubiles vont chercher un mari dont elles ne connaissent que la photo et parfois une lettre. Ce mariage représente l'espoir d'une vie meilleure qui sera vite balayé par la découverte d'hommes malhabiles, râblés, beaucoup moins jeunes et beaucoup moins élégants que sur les photos. Beaucoup moins riches aussi : en lieu et place d'avocats, de juges ou de commerçants prospères se trouvent des ouvriers agricoles corvéables à merci, des petits blanchisseurs ou des domestiques. La vie rêvée se révèle un calvaire. Il aurait peut-être mieux valu ne jamais partir plutôt que d'être à jamais perdues dans ce pays étranger, aux côtés d'hommes également étrangers. Mais à quoi bon revenir, et d'ailleurs, comment revenir ?
Tu verras: les femmes sont faibles, mais les mères sont fortes.
Alors ces femmes, ce nous qui fait bloc face à l'adversité, la déception, la douleur, l'harassement ou l'aliénation, continuent. Elles sont l'ouvrier, le blanchisseur ou le domestique parfait. Elles travaillent avec acharnement, sans rien dire, sans jamais se plaindre. Elles deviennent le maillon précieux vers une génération de japonais nés Américains qui, peu à peu, évoluent vers une intégration réussie. Elles entretiennent les coutumes mais véhiculent aussi les valeurs américaines. Elles sont à la fois le passé, et une nostalgie du Japon point toujours dans leur regard, et l'avenir d'une Amérique métissée.
En quelques dizaines d'années, on passe d'un début du vingtième siècle très archaïque à un vingtième siècle bien entamé dont on sent déjà le progrès et l'évolution, tant dans le quotidien que les mentalités.
Et puis arrive la Seconde Guerre Mondiale. On en connaît abondamment les horreurs du nazisme. On en connaît moins les horreurs des Alliés sous prétexte des exigences (lesquelles, déjà?) de la situation de guerre. Aussi, les Américains, ces sauveurs nombreux et braves, n'ont pas hésité à déporter, après moult restrictions des libertés, tous les japonais de la côte ouest, émigrés ou nés sur le sol américain, dans des "camps de relogement" qui rappellent étonnamment d'autres camps, à ceci près qu'il n'y avait pas d'extermination. N'empêche qu'alors, les êtres perdaient doucement leur identité, leur volonté, leur libre-arbitre, leurs libertés. Petit à petit, les êtres ont disparu, on les a oubliés. Nous les avons oubliés.
L'une des nôtres les rendaient responsables de tout et souhaitait qu'ils meurent. L'une des nôtres les rendait responsables de tout et souhaitait mourir. D'autres apprenaient à vivre sans penser à eux. [...]
Beaucoup des nôtres avaient tout perdu et sont partis sans rien dire.
Certaines n'avaient jamais vu la mer fait partie de ces courts romans dont il y a beaucoup à dire et qui restent longtemps à l'esprit. Cette fameuse voix indéterminée, collective, omniprésente peut dérouter - déroute, même, nécessairement. Révéler l'originalité de chaque être et de chaque expérience à travers une unique voix impérieuse semble une gageure que réussit pourtant magistralement Julie Otsuka. Car cette voix unique parle au nom d'une identité partagée à travers la multiplicité des vies racontées. Aussi, elle ne saurait appauvrir, mettant au contraire en lumière l'appartenance primordiale de chacune des femmes du récit à une japonicité qui les sous-tend. Loin du pays, dépouillée de tout ce qui était connu, compris et intégré, c'est ce noyau identitaire qui leur permet de poursuivre, de continuer à vivre.
Le roman fait circuler le lecteur vers un dépouillement progressif que, sans doute, ce nous révèle aussi. Dépouillement des liens de la famille, des traditions, des croyances religieuses, des sentiments, vers un ré-apprentissage douloureux, toujours mitigé malgré les efforts d'intégration parce qu'il ne saura jamais supplanter ce que l'éducation avait inculqué auparavant. Jusqu'à ce que ce ré-apprentissage soit lui-même balayé par un anéantissement progressif à cause de ce que l'on incarne, à cause d'une terreur collective injustifiée, bête et méchante à pleurer. A cet égard, Certaines n'avaient jamais vu la mer est nécessaire pour deux raisons : il rappelle d'une part que rien n'est tout blanc ou tout noir en période troublée de guerre et que les exactions ne sont pas l'apanage de l'ennemi, et il rappelle d'autre part qu'on est pas toujours loin non plus, nous contemporains, de reproduire certains balayages à l'emporte-pièce, par ignorance, par peur - et souvent par les deux à la fois.
En somme, un roman d'une vive intelligence, qui véhicule quelques réflexions universelles nécessaires autour de l'identité, de la lecture critique de l'Histoire et de l'interrogation critique de l'actualité, construit autour d'une voix narrative originale, brillante et éminemment émouvante - ce qui ne gâche rien, bien au contraire. En somme, un roman magistral à lire - je pourrais difficilement mieux résumer !
 Le Mois Américain 2016 chez Titine
Le Mois Américain 2016 chez Titine
1ère participation
10:29 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Histoire, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (8)
25/07/2016
Aziyadé de Pierre Loti
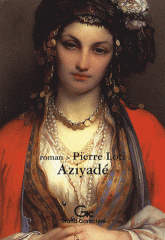
Aziyadé de Pierre Loti, 1879
Lecture numérique
 L'Orient est décidément le territoire de tous les fantasmes au XIXème siècle, mélange d'exotisme, de sensualité et de violence. Il y a quelque chose d'hypnotique dans l'Orient déformé de les auteurs de ce siècle romantique !
L'Orient est décidément le territoire de tous les fantasmes au XIXème siècle, mélange d'exotisme, de sensualité et de violence. Il y a quelque chose d'hypnotique dans l'Orient déformé de les auteurs de ce siècle romantique !
Il y a évidemment de cela dans l'Aziyadé de Pierre Loti qui raconte l'amour passionnel, fulgurant, improbable entre Loti, un officier de marine anglais et la fameuse Aziyadé, toute jeune femme murée dans son harem. Leur rencontre se fait à travers les barreaux qui scellent son appartement puis, sans se parler puisqu'une langue les sépare, ils se rencontrent nuitamment, à la faveur des absences de l'époux d'Aziyadé. Ils se suivent ainsi de Salonique à Stamboul (les noms de villes aussi ont quelque chose d'exotique, n'est-ce pas ?) et vivent à la faveur d'un petit appartement camouflé de feuillages, Loti déguisé en autochtone, et grâce au concours de Samuel, Achmet, ou Kadidja.
Mais c'est trop beau, cela ne peut durer. Loti se fait rappeler par son pays un beau jour de mai 1877. Il n'a que quelques jours avant le départ et malgré des hésitations, il ne peut se résoudre à rester en Turquie. Il laisse Aziyadé qui jure de ne pas pouvoir lui survivre. Le conte oriental prend alors des accents de tragédie shakesperienne.
Aziyadé parle peu ; elle sourit souvent, mais ne rit jamais ; son pas ne fait aucun bruit ; ses mouvements sont souple, ondoyants, tranquilles, et ne s’entendent pas ; C’est bien là cette petite personne mystérieuse, qui le plus souvent s’évanouit quand paraît le jour, et que la nuit ramène ensuite, à l’heure des djinns et des fantômes.
Le plus frappant, dès lors qu'on entame la lecture, est la forme choisie par Pierre Loti. C'est une succession de courts chapitres, qu'on peut qualifier de fragments, qui développent sous forme de journal et de lettres une histoire qui commence immédiatement, sans préambule. Loti arrive à Salonique, décide de se promener en tenue traditionnelle par défi, ennui ou désinvolture, on ne sait trop - pour se divertir tout du moins -, croise les yeux d'Aziyadé et nous voilà dans le vif du sujet. Point de longue mise en place de la situation, du décor, des personnages. Tout est déjà là, en quelques chapitres d'une quinzaine de lignes chacun. C'est progressivement, à mesure que l'histoire se nourrit et, particulièrement, dès lors qu'elle est sise à Istanbul, que l'environnement historique, politique et quotidien de la vie turque fleurit et prend de l'ampleur en écho à l'épanouissement de la relation entre Loti et Aziyadé. Les chapitres s'étoffent et l'on découvre une vie éminemment exotique et chatoyante. Je ne l'ai pourtant pas trouvé si fantasmée que ça et il semble que Pierre Loti ait été un observateur pertinent du tournant vers la constitution turque en 1876 et du début de la guerre russo-turque en 1877.
Par ailleurs, on sent l'esprit fin de siècle gagner le personnage de Loti. Il n'a plus rien de l'exaltation pleine d'espoir, parfois poussive, du personnage romantique. Il se révèle au contraire pétri de contradictions, de questionnements et, surtout, d'une sorte d'impossibilité de vivre le sentiment jusqu'au bout, trop empêtré dans une langueur sourde. Quelque chose de l'esprit déjà blasé, à moitié consumé, qui semble avoir déjà trop vécu pour son jeune âge. Loti apparaît comme le miroir inversé d'Aziyadé, d'une grande naïveté et d'une pureté de sentiments dénuée de calcul. Leur rencontre, tout comme leur relation est improbable. On ne sait comment cela tient, si ce n'est par une magie proche du conte, qui nous embarque dans les rues odorantes, bruyantes, voilées d'une Turquie lointaine, qui n'a peut-être jamais existé.
Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de morale, rien n'existe de tout ce qu'on nous a enseigné à respecter; il y a une vie qui passe, à laquelle il est logique de demander le plus de jouissance possible, en attendant l'épouvante finale qui est la mort.
En somme, ce fut un beau voyage (comme dirait Du Bellay)
Image : La fontaine du Harem, Frederick Arthur Bridgman, 1875
14:24 Publié dans Classiques, Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : aziyadé, pierre loti, loti, turquie, stamboul, istanbul, amour, tragédie, roman épistolaire, journal
27/04/2016
La mort de Napoléon de Simon Leys
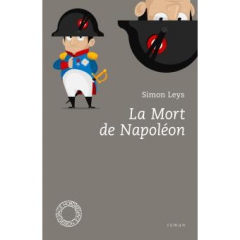
La mort de Napoléon de Simon Leys, Espace Nord, 2015 [1986], 142p. (dont une quarantaine d'excellent appareil critique)
Alors là, avouons-le, Simon Leys s'est payé un culot monstrueux, pour notre plus grand amusement et dont il s'est visiblement beaucoup amusé aussi : Déjà, Napoléon n'est pas mort à Saint Hélène ! - et hop, un détour savoureux par l'uchronie sans avoir l'air d'y toucher - mais en plus, il se révèle bien loin, bien souvent, du personnage que l'Histoire a brossé de lui.
Napoléon, pour le dire tel que Simon Leys l'envisage, a pris la poudre d'escampette de son exil, non sans se faire remplacer au préalable par un sosie maréchal-des-logis, et navigue depuis, de bateaux en points de chute inconnus, afin de reconquérir son empire. Il suit, en fait, un plan tout tracé par on-ne-sait-qui dont les rouages merveilleusement huilés s'enclenchent jusqu'à un petit couac qui vaudra à Napoléon - qui se cache sous le caractère faible et taciturne d'Eugène Lenormand, pour la peine - de vivre quelques loupés rocambolesques dans son entreprise.
Ce qui est tout à fait savoureux, c'est non seulement qu'on a affaire à une aventure, ni plus ni moins, mais que celle-ci est menée clopin-clopant par le plus improbable des anti-héros - celui-là même qu'on s'attendrait plutôt à voir incarner LE héros par excellence ! Ici, nul Napoléon fringant, charismatique (sauf peut-être lorsqu'il s'agit d'engager une vente triomphale de pastèques - à vous de voir dans quelle mesure cela délivre toute l'étendue de son charisme) mais bien plutôt un Napoléon taciturne et taraudé par la question de son histoire, de son avenir et de son identité. Tour à tour, il se trouve fortuitement dépossédé de l'un puis de l'autre, jusqu'à se demander qui il est vraiment et qui il peut encore être dans le regard d'autrui une fois que tout (ou ce qu'il pensait être tout) a foutu le camp.
Il y a un petit côté conte philosophique au vu des thématiques, c'est indéniable, mais que ça ne vous rebute pas (je dis ça parce que le conte philosophique est un peu ma bête noire, a priori) car c'est déroulé avec un humour savamment dosé, une intelligence subtile et une langue qui n'a strictement rien à envier aux plus grands auteurs tant le moindre bout de ciel est l'occasion d'un délicieux arrêt sur image.
Après une telle bonne surprise, je me dois de remercier fort chaleureusement Anne et Mina ainsi que les éditions Espace Nord grâce à qui j'ai remporté ce livre lors du dernier mois belge. Je retenterai forcément le concours de fin du mois lors de cette nouvelle édition si ça doit toujours encore me faire découvrir d'aussi bons morceaux belges !
Chez Mrs Pepys aussi Simon Leys est à l'honneur aujourd'hui !
Le ciel, partagé entre la nuit et l'aube, noir-bleuté de l'ouest jusqu'au zénith, blanc de perle à l'orient, était entièrement investi par la plus fabuleuse architecture de nuages que l'on pût imaginer. La brise nocturne qui avait édifié ce chantier géant de palais, de colonnades, de tours et de glaciers, l'avait abandonné en désordre dans une immobilité et un silence solennels, pour servir de socle à l'aurore. La crête suprême d'un cumulus échevelé déjà était touchée d'un pinceau jaune, premier phare du jour au fronton de la nuit finissante, tandis que les zones inférieures des nuées étaient encore plongées dans une pénombre confuse, creusée de gorges, hérissée de pics, avec des enfilades de falaises et de précipices bleus, de nocturnes champs de neige, de coulées de lave violette. Le ciel entier était possédé d'un élan interrompu, paraissait la proie d'un chaos immobile, le théâtre d'un écroulement figé ; au-dessus de la mer diaphane et sans ride, tout était suspendu dans l'attente du jour. p. 15-16
07:00 Publié dans Challenge, Histoire, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (12)




