19/01/2019
Les Brumes du passé de Leonardo Padura
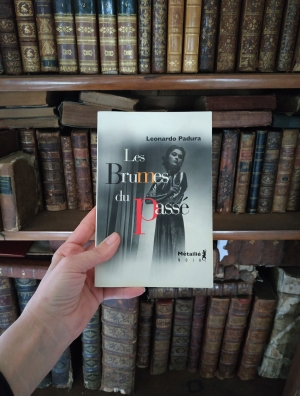 Grâce à ce roman, je découvre enfin Mario Conde, ancien flic cubain reconverti dans la vente de livres d'occasion. A l'époque des faits, il a quitté la police depuis une dizaine d'années - nous sommes en 2003. Cuba souffre de plus en plus du rationnement et Mario galère de plus en plus à trouver quelques livres à revendre pour subsister. Un beau jour, il tombe par hasard sur une bâtisse magnifique un poil décrépite qui renferme une somptueuse bibliothèque, restée intacte selon les dernières volontés d'Alcides Montes de Oca. Conde a un pressentiment violent. Il le pense lié à la rareté de certains ouvrages inestimables ; il s'aperçoit rapidement qu'il a plutôt à voir avec une chanteuse dont il découvre la photo entre les pages : Violeta del Rio, femme fatale tombée dans l'oubli depuis son retrait de la scène, un demi-siècle plus tôt. Pour mener à bien son enquête, Mario Conde erre dans tous les quartiers de la Havane - et certains ne sont pas exactement sortis d'un catalogue touristique - lorsqu'il ne refait pas le monde avec sa bande d'amis indécrottables.
Grâce à ce roman, je découvre enfin Mario Conde, ancien flic cubain reconverti dans la vente de livres d'occasion. A l'époque des faits, il a quitté la police depuis une dizaine d'années - nous sommes en 2003. Cuba souffre de plus en plus du rationnement et Mario galère de plus en plus à trouver quelques livres à revendre pour subsister. Un beau jour, il tombe par hasard sur une bâtisse magnifique un poil décrépite qui renferme une somptueuse bibliothèque, restée intacte selon les dernières volontés d'Alcides Montes de Oca. Conde a un pressentiment violent. Il le pense lié à la rareté de certains ouvrages inestimables ; il s'aperçoit rapidement qu'il a plutôt à voir avec une chanteuse dont il découvre la photo entre les pages : Violeta del Rio, femme fatale tombée dans l'oubli depuis son retrait de la scène, un demi-siècle plus tôt. Pour mener à bien son enquête, Mario Conde erre dans tous les quartiers de la Havane - et certains ne sont pas exactement sortis d'un catalogue touristique - lorsqu'il ne refait pas le monde avec sa bande d'amis indécrottables.
Les Brumes du passé est un roman d'ambiance assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il transpose exactement les codes de roman noir américain, dans l'art duquel Raymond Chandler ou Dashiell Hammett sont passés maîtres en leur temps, en plein Cuba contemporain. L'incertitude, la mélancolie et le mystère sont les mêmes, sans l'once d'une caricature - la tarte à la crème principale du roman noir ; la déliquescence du temps et le désespoir de la faim provoquent toujours les plus sombres crimes. C'est franchement subtil et d'une rare intelligence. L'enquête est au service d'une réflexion sur les dommages collatéraux d'une dictature qui n'a déjà que trop duré et interroge la portée des éthiques lorsque les besoins primaires sont sapés. Elle est aussi l'occasion d'une balade au pays réjouissant de l'amitié et de l'art littéraire, ces nourritures spirituelles capables de tout rendre supportable - du moins, la plupart du temps. Certaines pages consacrées à l'amitié me restent en mémoire comme parmi les plus beaux éloges que j'ai pu lire de ce sentiment, sans emphase ni grandiloquence, en dévoilant la simplicité et la profondeur d'une relation durable et franche.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas, à ce point, eu un coup de foudre à la fois pour un auteur, une ambiance et un personnage. Je ne suis pas prête d'oublier Mario Conde, cet imparfait magnifique, ni de lâcher la grappe à Leonardo Padura, c'est moi qui vous le dit.
Histoire de ne rien dévoiler de l'intrigue par quelques citations, je vous laisse sur l'incipit. Le voyage est déjà amorcé.
Les symptômes arrivèrent soudain comme la vague vorace qui happe un enfant sur une plage paisible et l'entraîne vers les profondeurs de la mer : le double saut périlleux au creux de l'estomac, l'engourdissement capable de lui couper les jambes, la moiteur froide sur la paume de ses mains et surtout la douleur chaude, sous le sein gauche, qui accompagnait l'arrivée de chacune des ses prémonitions.
Les portes de la bibliothèque à peine ouverte, il avait été frappé par l'odeur de vieux papier et de lieu sacré qui flottait dans cette pièce hallucinante, et Mario Conde, qui au long de ses lointaines années d'inspecteur de police avait appris à reconnaître les effets physiques de ses prémonitions salvatrices, dut se demande si, par le passé, il avait déjà été envahi par une foule de sensations aussi foudroyantes.
 Première participation cubaine pour le Challenge Latino d'Ellettres !
Première participation cubaine pour le Challenge Latino d'Ellettres !
14:19 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Littérature hispanique, Polar | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : polar, roman noir, policier, enquête, meurtre, mystère, chanson, boléro, femme fatale, violetta del rio, mario conde, cuba, la havane, dictature, livre, livre ancien, pénurie, amitié, intuition, coup de coeur, métailié, les brumes du passé, leonardo padura
22/10/2017
Lettre à un otage d'Antoine de Saint Exupéry
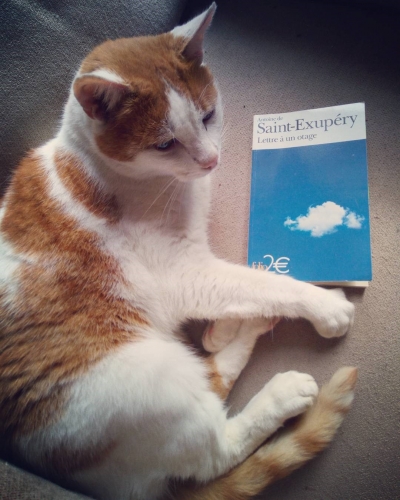 Qui dit texte autobiographique avec la Seconde Guerre Mondiale en toile de fond, dit souvent fête à mémé, tristesse et désespoir. Vu l'ampleur du saccage, comment pourrait-il en être autrement ? Saint-Exupéry ne déroge pas complètement à cette règle dans sa lettre ouverte, initialement prévue comme la préface de 33 jours de Léon Werth, l'otage du titre, avant d'être remaniée et envisagée comme autonome.
Qui dit texte autobiographique avec la Seconde Guerre Mondiale en toile de fond, dit souvent fête à mémé, tristesse et désespoir. Vu l'ampleur du saccage, comment pourrait-il en être autrement ? Saint-Exupéry ne déroge pas complètement à cette règle dans sa lettre ouverte, initialement prévue comme la préface de 33 jours de Léon Werth, l'otage du titre, avant d'être remaniée et envisagée comme autonome.
Le texte s'ouvre sur une première partie d'une mélancolie lancinante où le narrateur apparaît d'autant plus perdu, dans le Lisbonne de 1940, qu'il ne se reconnaît pas en la tripotée de joyeux riches expatriés qu'il rencontre. L'ombre de la guerre, c'est évidemment la peur et la mort, mais aussi le déracinement et le remords de la fuite. Contrairement à ces autres émigrants, Saint Exupéry ne poursuit pas un but pécuniaire - mettre son argent à l'abri - mais politique - convaincre les Etats-Unis d'entrer en guerre. Il n'empêche qu'il porte douloureusement le poids de son départ comme un manquement à ceux qui restent.
Alors commence le vrai voyage, qui est hors de soi-même.
La véritable interrogation de ce récit se dessine alors ici : comment continuer à être soi, comment rebondir, se reconstruire et espérer lorsqu'on est amputé de ses racines, et que la guerre invite à la haine de l'autre et à la suspicion perpétuelle ? Loin de la solitude subie que provoque une foule sans visages, c'est dans une solitude paisible et consentie que l'être se rassérène. Le désert le rappelle au point cardinal de sa géographie intérieure : l'amitié.
Et comme le désert n'offre aucune richesse tangible, comme il n'est rien à voir ni à entendre dans le désert, on est bien contraint de reconnaître, puisque la vie intérieure loin de s'y endormir s'y fortifie, que l'homme est animé d'abord par des sollicitations invisibles. L'homme est gouverné par l'Esprit. Je vaux, dans le désert, ce que valent mes divinités.
La simplicité et la tendresse des relations humaines, développées à travers autant d'anecdotes mettant en scène Léon Werth ou des soldats ennemis, brodent l'espoir profond et ravivé d'une humanité riche de toute sa diversité capable de projeter l'avenir d'une entente universelle.
Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente.
Auprès de toi, je n'ai pas à me disculper, je n'ai pas à plaider, je n'ai pas à prouver ; je trouve la paix.
Certains le liront comme un vœu pieu tant l'Histoire se charge régulièrement de nous décourager ; d'autres comme le souffle vivifiant qui redonne la foi. Une chose est sûre : à lire ce court et beau texte de Saint-Exupéry, ne pas perdre espoir, en certaines périodes particulièrement sombres et troublées, apparaît clairement comme une sacrée preuve de courage.
Cette qualité de la joie n'est-elle pas le fruit le plus précieux de la civilisation qui est la nôtre ? Une tyrannie totalitaire pourrait nous satisfaire, elle aussi, dans nos besoins matériels. Mais nous ne sommes pas un bétail à l'engrais. La prospérité et le confort ne sauraient suffire à nous combler. Pour nous qui fûmes élevés dans le culte du respect de l'homme, pèsent lourd les simples rencontres qui se changent en fêtes merveilleuses.
20:32 Publié dans Ecriture de soi, Histoire, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : lettre, lettre ouverte, histoire, guerre, seconde guerre mondiale, saint exupéry, emigration, exil, isolement, solitude, amitié, humanité, espoir, joie, partage, autobiographie
17/07/2017
Le nouveau nom d'Elena Ferrante

Abolissons tous les filtres qui nous empêchent de jouir pleinement et véritablement de l'hic et nunc. p.293
Il y a des périodes comme ça, où on sent que les lectures vont être bonnes. D'habitude, ce n'est pourtant pas mon cas en été : alors même que j'ai tout mon temps, je ne le vois pas passer ; je lis peu et tout ce que je lis me tombe peu ou prou des mains. Bref, souvent en été, je regarde ma bibliothèque avec une mine ennuyée. Mais cette année, c'est différent ; mon état d'esprit est différent. J'ai envie de profiter à fond de chaque seconde. Je me baigne dans un carpe diem à la guimauve et j'adore ça. Ca vaut toutes les piscines du monde.
Premier plongeon dans la dite-piscine : Le tome 2 de la saga italienne initiée avec L'amie prodigieuse que j'avais beaucoup aimé l'an dernier. Je n'en avais pas fait un coup de cœur sur le moment, pourtant je l'avais recensé comme tel dans mon bilan de fin d'année. Bizarre... Il faut dire qu'immédiatement après lecture, mon esprit objectif avait bien saisi les petites faiblesses du roman mais avec le recul, j'ai surtout retenu ce bouillonnement d'un quartier pauvre de Naples si merveilleusement rendu et l'ambivalence addictive de l'amitié entre Lila et Lenù. En somme, malgré moi et mon esprit d'analyse, j'étais mordue comme tout le monde, un point c'est tout.
Si rien ne pouvait nous sauver, ni l'argent, ni le corps d'un homme, ni même les études, autant tout détruire immédiatement. p. 23
Le tome 2 s'imposait donc et, qu'on se le dise, il est encore plus addictif que le précédent ! Sans transition, on récupère l'histoire des deux amies là où elle s'était arrêtée, c'est à dire le jour du mariage de Lila et Stefano. Celle-ci comprend que son mariage sera un échec alors que la fête n'en est pas encore terminée. Lenù est, quant à elle, toujours tiraillée entre ses aspirations amoureuses et intellectuelles et son quartier d'origine, ce milieu pauvre à tout point de vue qu'elle traîne malgré elle. L'une et l'autre sont prisonnières à leur manière : A vouloir évoluer et s'émanciper, Lila se retrouve empêtrée dans une union cruelle et sans véritable amour (mon Dieu que la condition de la femme à cette époque et dans ce milieu-là fait froid dans le dos !) et Lenù éprouve chaque jour que son acharnement au travail ne masque pas son inculture fondamentale. Pour les deux amies, qui sont toujours le miroir inversé l'une de l'autre, qui s'attirent et se repoussent, s'aiment et se détestent, devenir soi-même, se réaliser en tant qu'être à part entière - impulsion relativement nouvelle pour le Naples pauvre des années 50-60 - se révèle décidément un parcours semé de doutes et de blessures terribles.
En quelques années, Lila avait provoqué tellement de choses ! Et pourtant, maintenant que nous avions dix-sept ans, on aurait dit que la substance du temps n'était plus fluide mais avait pris un aspect poisseux, il semblait tourner autour de nous comme la pâte jaune dans le robot d'un pâtissier. p. 145
Plus long de presque deux cents pages par rapport à L'amie prodigieuse, je n'ai pourtant pas vu le temps passer. Quelques longueurs subsistent, certes - le séjour à Ischia est trop long, il faut l'avouer - mais elles pèsent assez peu et ne ralentissent en aucune façon le rythme soutenu de la lecture addictive. On se détache doucement dans ce titre des querelles de l'enfance et de la fusion irrationnelle des premières amitiés pour mettre en regard et en résonance les constructions des deux protagonistes, et au-delà d'elles, la construction d'une nouvelle société. Les discussions sur l'évolution du monde prennent de plus en plus de place dans la bouche de Pasquale, l'ami d'enfance communiste, et dans celles des intellectuels que fréquente Elena au lycée puis à l'Ecole Normale. Par opposition, l'organisation sempiternellement identique du vieux quartier pauvre, avec les Solara comme point financier névralgique, semble atteindre un âge d'or aussi intense que bref. Rapidement, tout retombe en déliquescence. Seuls ces derniers se sortent à peu près bien de la dégringolade, certes grâce à l'argent, mais surtout car ils n'ont aucun scrupule à évoluer. Le nouveau nom, c'est la photographie d'un monde qui bouge à l'heure de ses premiers mouvements, et c'est admirablement bien rendu. Chaque frémissement pris isolément semble insignifiant et anecdotique mais l'ensemble dessine la cartographie d'une nouvelle ère et interroge, du même coup, la validité des mots dans tout ça.
Le cinéma, les romans, l'art ? Comme les gens changent vite, et comme leurs centres d'intérêt et leurs sentiments sont éphémères ! Des discours bien construits sont remplacés par d'autres discours bien construits ; le temps charrie des flots de paroles qui ne sont cohérents qu'en apparence, et plus on a de mots plus on continu à en amasser. p. 418-419
Pour toutes ces raisons et parce qu'Elena Ferrante a le don sublime de rendre vivant ce qu'elle écrit, je n'ai pas besoin d'un peu de délai pour faire de cette lecture un coup de cœur. La seule question qui subsiste est : vais-je attendre la sortie en poche du tome 3 ou vais-je aller le piquer à la bibliothèque dans les prochains jours ?...
 Le nouveau nom d'Elena Ferrante, Folio, 2016, 623p.
Le nouveau nom d'Elena Ferrante, Folio, 2016, 623p.
14:42 Publié dans Coups de coeur, Histoire, Littérature italienne, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : le nouveau nom, tome 2, elena ferrante, l'amie prodigieuse, lénù, lila, amitié, évolution, mariage, études, condition de la femme, émancipation, violence, société, naples, italie




