16/04/2018
La cigale du huitième jour de Mitsuyo Kakuta
 Février 1985. Kiwako rôde autour de l'appartement d'un jeune couple. Elle attend leur départ pour entrer chez eux. Elle veut voir, toucher où ils vivent. C'est tout. Mais à cet instant, un bébé se met à pleurer. Le nourrisson n'a que quelques mois. Kiwako, désemparée et touchée viscéralement par ces pleurs et l'instinct de les calmer, emmène l'enfant. A partir de là, l'existence n'est que fuite ou presque pour Kiwako et l'enfant, une petite fille qu'elle baptise Kaoru. Le duo va écumer quelques adresses de fortune et de hasard avant d'échoir dans une communauté sectaire quelques années et dont il faudra à nouveau s'échapper. Pourtant, malgré les conditions précaires de leur vie, "la mère" et l'enfant vivent en harmonie. Leur attachement est évident, sensible, touchant. On se prendrait presque à espérer que Kiwako ne soit jamais prise...
Février 1985. Kiwako rôde autour de l'appartement d'un jeune couple. Elle attend leur départ pour entrer chez eux. Elle veut voir, toucher où ils vivent. C'est tout. Mais à cet instant, un bébé se met à pleurer. Le nourrisson n'a que quelques mois. Kiwako, désemparée et touchée viscéralement par ces pleurs et l'instinct de les calmer, emmène l'enfant. A partir de là, l'existence n'est que fuite ou presque pour Kiwako et l'enfant, une petite fille qu'elle baptise Kaoru. Le duo va écumer quelques adresses de fortune et de hasard avant d'échoir dans une communauté sectaire quelques années et dont il faudra à nouveau s'échapper. Pourtant, malgré les conditions précaires de leur vie, "la mère" et l'enfant vivent en harmonie. Leur attachement est évident, sensible, touchant. On se prendrait presque à espérer que Kiwako ne soit jamais prise...
Elle pensa sans raison : je connais cet enfant et cet enfant me connaît. [...] Elle enfouit son visage dans les cheveux vaporeux du bébé en inspirant profondément.
C'était doux. C'était chaud. De ce petit corps si souple qu'il en semblait si fragile émanait pourtant une robustesse inébranlable. Si frêle et si fort. Une petite main effleura la joue de Kiwako. Un contact humide et chaud. Kiwako se dit qu'elle ne devait pas le laisser. Moi je ne te laisserai jamais tout seul, comme ça. Je vais te protéger. De tous les ennuis, de toutes les tristesses, de la solitude, de l'inquiétude et de la peur, je te protégerai. Kiwako était incapable de réfléchir. Elle continua à murmurer, comme une incantation. Je te protégerai, je te protégerai, je te protégerai. Toujours.
Magie des blogs et des swaps que d'avoir ce roman entre les mains ! Merci Ellettres ! Honnêtement, je ne l'aurais sans doute jamais lu sans ça pour deux raisons : le sujet ne m'attirait pas plus que ça de prime abord et surtout, j'ai mis un moment à rentrer dans le roman. Je ne me suis pas attachée d'emblée à Kiwako et le récit très factuel, à l'aveuglette, des premiers jours de sa fuite ne m'a pas passionnée. Mais j'ai continué malgré tout. Ellettres en avait fait un coup de cœur, il y avait donc forcément baleine sous gravillon ! Finalement, je me suis retrouvée happée presque malgré moi, comme ça m'arrive souvent avec la littérature contemporaine japonaise : je lui trouve toujours quelque chose à redire, notamment une trop grande blancheur de style et une trop grande neutralité de ton qui frisent parfois pour mon esprit très occidental un certain ennui (mais il faut tout de même préciser ici qu'en plus d'une mentalité très différente, la littérature japonaise souffre aussi pas mal des traductions, je pense), mais je suis harponnée quand même. D'une façon extrêmement ténue, subtile, infime, l'auteur(e) parvient toujours à me ferrer au quotidien des personnages. C'est ce qui s'est passé ici, clairement. Je me suis attachée sans m'en rendre compte à Kiwako - dont on oublie presque qu'elle est tout de même la kidnappeuse dans l'histoire - et à Kaoru qui trouvent leur bonheur d'être ensemble malgré toutes les difficultés d'un quotidien sans papiers et sans attaches véritables.
J'ai encore plus apprécié la seconde partie du roman - dont je ne vous dis volontairement rien, si ce n'est que Kaoru en devient la narratrice. Si certaines invraisemblances m'ont parfois gênée dans la première partie, celle-ci est incroyablement juste et très nuancée quant à la manière de vivre la situation pour chacun des personnages. Ce n'est pas follement drôle, du coup, mais c'est pourtant lumineux. Comme si tout ce qui était planté un jour avec amour finissait nécessairement par fleurir, même très tard, même d'une façon étonnante et inattendue. La cigale du huitième jour, celle qui survit à toutes les autres, est cet animal étrange et étranger qui vole en équilibre entre la mélancolie et la lumière. Dans les deux cas, les émotions sont pures et nous invitent à la gratitude de chaque instant.
Le billet de ma copinette Ellettres
11:26 Publié dans Challenge, Littérature asiatique, Swap | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : japon, mois japonais, swap, ellettres, mitsuyo kakuta, la cigale du huitième jour, amour, amour maternel, maternité, enlèvement, kidnapping, kiwako, kaoru, fuite, reconstruction
02/04/2018
Robinson de Laurent Demoulin
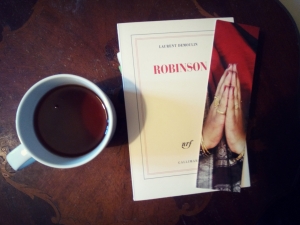 Gallimard voulait estampiller ce texte récit ; Laurent Demoulin le considérait comme un roman ; finalement aucune barrière de genre ne le limite. Dans plusieurs dizaines de fragments dont le rythme est savamment dosé, l'auteur raconte et brode son quotidien avec Robinson, son fils oui-autiste. Tel est le pitch et on pourrait, en vérité, s'arrêter là. Il n'y a pas de fil narratif, dans la mesure où le concept de progression linéaire est inopérant au contact de Robinson. Tout se situe exactement dans les moments présents qui résonnent les uns avec les autres. Ainsi, à défaut d'histoire ordonnée vers une acmé artificielle y a-t-il des échos, souvent scatologiques, et des éclats de tendresse silencieuse.
Gallimard voulait estampiller ce texte récit ; Laurent Demoulin le considérait comme un roman ; finalement aucune barrière de genre ne le limite. Dans plusieurs dizaines de fragments dont le rythme est savamment dosé, l'auteur raconte et brode son quotidien avec Robinson, son fils oui-autiste. Tel est le pitch et on pourrait, en vérité, s'arrêter là. Il n'y a pas de fil narratif, dans la mesure où le concept de progression linéaire est inopérant au contact de Robinson. Tout se situe exactement dans les moments présents qui résonnent les uns avec les autres. Ainsi, à défaut d'histoire ordonnée vers une acmé artificielle y a-t-il des échos, souvent scatologiques, et des éclats de tendresse silencieuse.
Indéniablement, Laurent Demoulin n'a pas pour ambition de donner dans la neutralité et la bien-pensance concernant l'autisme. Aussi n'hésite-t-il pas à qualifier ce syndrome de maladie, ce qui pourra faire tiquer certains lecteurs un peu sensibilisés à la question - comme ça a été mon cas, je dois bien le reconnaître. Ce texte est le regard très personnel qu'il porte sur sa relation avec son fils, d'une façon subjective pleinement assumée. Il n'est pas du côté des concepts et du choix des mots dans l'absolu mais de celui qui tâche de construire une relation avec un jeune garçon de dix ans, privé de langage - le comble pour un professeur d'université spécialiste de Ponge et Barthes-, prenant en compte avec empathie, patience et souvent difficulté, toutes les particularités que cela occasionne. Même s'il y a parfois beaucoup de maladresse, de l'épuisement voire de la colère chez ce père désemparé, le texte respire la tendresse et l'humilité. A défaut de dialoguer avec Robinson, Laurent Demoulin a trouvé le moyen de discuter à travers lui et interroge la force de la relation filiale sans les repères habituels du langage. C'est une manière, plus largement, de nous interroger sur ce qu'est l'humanité, sans trop y toucher et lorsque les mots manquent. Il ressort de ce texte une lumière délicate. Fragile, certes, mais d'une intensité qui donne le sourire.
Si la modernité s'écrit dans le refus de la tradition, alors l'autisme est moderne. Si l'artiste moderne ne craint aucun interdit, alors le oui-autiste vit sa vie comme une oeuvre moderne.
Robinson est un enfant anarcho-oui-austistique qui ne respecte aucun "Non!". Malgré mes sermons et mes reproches, il vient de déchirer son dernier livre d'images, page après page.
Dépité, j'ai jeté les déchets de L'Imagerie des animaux sauvages dans la corbeille à papier de ma chambre - chambre qui jouxte la sienne.
Si le classicisme est désir d'ordre, d'harmonie et de permanence, les oui-autistes sont des artistes classiques : Robinson est allé rechercher dans ma poubelle chacun des petits morceaux de papiers glacés colorés et, patiemment, les a rangés sur son étagère - là où, il y a peu, s'alignait une jolie collection de livres pour enfants.
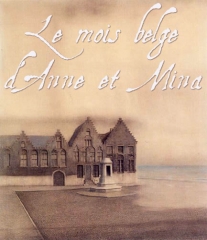 2eme lecture du mois belge à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
2eme lecture du mois belge à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme

18:01 Publié dans Challenge, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : autisme, père, fils, fragments, robinson, gallimard, littérature, langage, relation, amour, mois belge
28/03/2018
Fort comme la mort de Guy de Maupassant
Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ; car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l’Éternel. les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas.
Le Cantique des Cantiques
Si Fort comme la mort nous donne à voir un artiste, il ne s'agit pas d'un artiste maudit. Olivier Bertin a joliment réussi. Il est à l'abri du besoin, très en vogue et occupe les salons - dans tous les sens du terme - de ce monde bourgeois et mondain fin XIXème comme s'il y avait toujours vécu. Sa réputation de portraitiste hors pair le conduit douze ans plus tôt à immortaliser la délicieuse Anne de Guilleroy, dont le charme n'a d'égal que son idée de la perfection. Le deuil qu'elle revêt alors le frappe, la marque d'une aura de pureté, de rigueur, de dignité qui n'est pas sans rappeler la passante baudelairienne. Au fil des ans, la passion a fait place au calme de la sécurité d'un amour qui ne réclame plus de se prouver chaque jour. Olivier Bertin et Anne de Guilleroy s'aiment toujours douze ans plus tard, ce qui est assez rare pour être noté dans cette société superficielle, mais ils s'aiment autrement. Cette sérénité, qui a quelque chose de la platitude des habitudes, suit l'évolution de l'âge pour ces deux êtres mûrs, encore superbes, mais se sentant vieillir irrémédiablement.
Lorqu'Olivier peint Anne pour la première fois, la petite Annette, sa fille, n'est qu'une enfant. C'est le temps des jeux, d'une complicité innocente et amusante. Annette et Olivier se tutoient, en toute familiarité. Après des années d'absence, Annette réapparaît. Elle est métamorphosée : elle a maintenant dix-huit ans. Sa fraîcheur, ses cheveux, sa voix. Tout en fait le portrait exact de sa mère douze ans plus tôt, croquée par Bertin. Ce dernier se pense aguerri et ne se méfie pas. Anne, plus lucide, est éclaboussée pour l'évidence : elle décline quand sa fille s'épanouit. C'est ainsi la lente glissade des êtres qui se débattent avec le temps. L'une s'accroche à l'amour, l'autre s'accroche à son image. Dans ces affres que nul ne saurait contrôler, la jalousie, l'impuissance et la passion deviennent les pires ennemis de ceux qui avaient tout mais n'ont pas supporté l'idée de leur finitude.
De cette ressemblance naturelle et voulue, réelle et travaillée,était née dans l’esprit et dans le cœur du peintre l’impression bizarre d’un être double, ancien et nouveau, très connu et presque ignoré, de deux corps faits l’un après l’autre avec la même chair,de la même femme continuée, rajeunie, redevenue ce qu’elle avait été. Et il vivait près d’elles, partagé entre les deux, inquiet,troublé, sentant pour la mère ses ardeurs réveillées et couvrant la fille d’une obscure tendresse.
Que ce roman est une étrange expérience, surtout lorsqu'on ne sait pas précisément à quoi s'attendre. Je croyais lire un roman sur la peinture ; j'ai découvert bien plus que ça. Je confesse cependant qu'à quelques reprises, mon idée préconçue m'a fait m'ennuyer de certains passages, n'en saisissant pas d'abord l'enjeu véritable. C'est qu'il s'agit de nous planter exactement la société dans laquelle s'inscrivent les personnages - ce cocon bourgeois très policé qui fonctionne en vase clos. On ne saurait mélanger les torchons et les serviettes. Savoir cela, y plonger les mains complètement, c'est mieux comprendre les passions ensuite qu'ils ressentiront. Car il y a quelque chose de privilégié, indéniablement, pour Bertin comme pour la Comtesse, à se torturer de réflexions intenses lorsqu'on n'a pas à se demander comme dormir ou manger. J'ose penser néanmoins qu'à travers l'interrogation de la finitude, et connaissant l'ironie de Maupassant, il y a là une critique de cette société soumise aux mêmes lois de la nature que toutes les autres. Le monde change ; ainsi les sociétés que l'on croyait éternelles.
Au-delà du préjugé social, Olivier Bertin, c'est nous. Sur le déclin, dès le départ. De cela, nous sommes conscients. Mais lorsque ce déclin commence à être flagrant, à se ressentir au quotidien et sous les yeux d'êtres florissants, en pleine jeunesse, d'une lumière qui devient aveuglante, la sérénité est plus délicate à trouver. Aussi Bertin se débat-il et ne parvient-il pas à trouver la paix dans cette fuite du temps. On est tenté de le juger sévèrement bien des fois, du moins je l'ai été, et la pitié rôde dangereusement à mesure que les pages se tournent. Et puis finalement, ce roman m'a fait l'effet d'un ébouriffant Memento mori. Personne n'est au-dessus des doutes, des peurs, des regrets. Qui sait l'effet que le passage de certains âges nous fera ? En attendant, nous sommes ici, maintenant.
Un mot, cependant, avant d'en finir (avec cette chronique seulement) sur l'écriture de Maupassant. Les premières pages sont d'une beauté impressionniste qui n'a peut-être d'égal que celle de Zola. La lumière est là, les reflets vibrent, la couleur foudroie. Je me régale toujours de cette écriture naturaliste si picturale, si caractéristique d'un dialogue aimé entre les arts. A mesure que l'ombre s'avance sur Anne et Olivier, l'écriture se resserre : il ne s'agit pas de brosser à grands traits une gigantesque toile où l'on ne saurait donner de la tête mais de croquer nerveusement les instants décisifs. Je n'ai jamais été grande lectrice de Maupassant, la faute sans doute à sa fréquente prédilection pour le format de la nouvelle qui ne m'émoustille que peu. Sur le tard, je m'aperçois que je suis longtemps passée à côté d'un écrivain extraordinaire du XIXème. Prendre de l'âge me permet donc, en l'occurrence, de réparer le défaut que j'avais eu d'évincer inconsciemment Maupassant de mes lectures potentielles. Que les futures années qui viennent sont belles (malgré les rides) si elles m'offrent de découvrir encore d'aussi beaux textes !
Le jour tombait dans le vaste atelier par la baie ouverte du plafond. C'était un grand carré de lumière éclatante et bleue, un trou clair sur un infini lointain d'azur, où passaient, rapides, des vols d'oiseaux.
Mais à peine entrée dans la haute pièce sévère et drapée, la clarté joyeuse du ciel s'atténuait, devenait douce, s'endormait sur les étoffes, allait mourir dans les portières, éclairait à peine les coins sombres où, seuls, les cadres d'or s'allumaient comme des feux. La paix et le sommeil semblaient emprisonnés là-dedans, la paix des maisons d'artistes où l'âme humaine a travaillé. En ces murs que la pensée habite, où la pensée s'agite, s'épuise en des efforts violents, il semble que tout soit las, accablé, dès qu'elle s'apaise. Tout semble mort après ces crises de vie ; et tout repose, les meubles, les étoffes, les grands personnages inachevés sur les toiles, comme si le logis entier avait souffert de la fatigue du maître, avait peiné avec lui, prenant part, tous les jours, à sa lutte recommencée. Une vague odeur engourdissante de peinture, de térébenthine et de tabac flottait, captée par les tapis et les sièges ; et aucun autre bruit ne troublait le lourd silence que les cris vifs et courts des hirondelles qui passaient sur le châssis ouvert, et la longue rumeur confuse de Paris à peine entendue pardessus les toits.
13:13 Publié dans Art, Classiques, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : art, peinture, peintre, paris, xixème siècle, vieillissement, mort, amour, réflexion, bourgeoisie, réalisme, naturalisme, maupassant





 Participation pour le mois japonais chez
Participation pour le mois japonais chez