20/02/2019
Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë
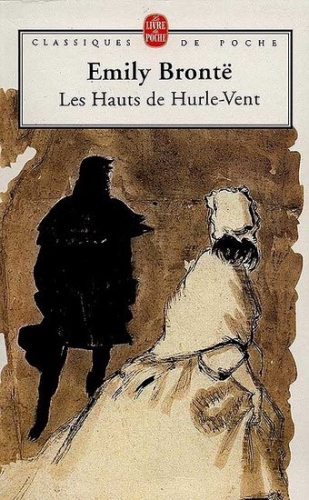 Il y a quinze jours, je concluais mon billet sur Agnès Grey en soulignant que ma lecture des Hauts de Hurlevent datait de bien trop longtemps pour constituer un avis fiable de lecture et qu'il me serait bien agréable de le relire, pour voir ce que j'en penserais aujourd'hui. Ni une ni deux : aussitôt le billet fini, j'ai entamé le dit-roman de la sœur du milieu (deux Brontë coup sur coup : je peux difficilement mieux préparer mon départ demain pour le nord de l'Angleterre).
Il y a quinze jours, je concluais mon billet sur Agnès Grey en soulignant que ma lecture des Hauts de Hurlevent datait de bien trop longtemps pour constituer un avis fiable de lecture et qu'il me serait bien agréable de le relire, pour voir ce que j'en penserais aujourd'hui. Ni une ni deux : aussitôt le billet fini, j'ai entamé le dit-roman de la sœur du milieu (deux Brontë coup sur coup : je peux difficilement mieux préparer mon départ demain pour le nord de l'Angleterre).
En vérité, ce pays-ci est merveilleux ! Je ne crois pas que j'eusse pu trouver, dans toute l'Angleterre, un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope.
J'en fais un rapide résumé pour celles et ceux qui vivraient dans un univers parallèle (n'y voyez aucun snobisme hein, j'ai juste cru comprendre que, tout comme l'oeuvre de Jane Austen, celle d'Emily et celle de Charlotte Brontë font partie des grands classiques de la blogo). Un soir, tandis que la pluie fait rage sur la lande anglaise, Mr. Earnshaw ramène de la ville un jeune garçon, supposé bohémien, qu'il décide d'adopter parmi ses deux autres enfants, Hindley et Catherine. Il sera sobrement surnommé Heathcliff, ce sobriquet valant autant pour prénom que pour nom de famille. Si l'affection du maître lui est d'emblée acquise, son caractère taiseux, taciturne, parfois fier, emporté, et fougueux lui attire autant l'inimitié d'Hindley et des domestiques que l'amour de Catherine - un amour qui ne se nomme finalement jamais vraiment, et qui tient de tous les amours possibles : naïf, instinctif, fraternel, amical, amoureux, passionnel, divin, animal, destructeur. En grandissant, Catherine se tourne vers le fils de la propriété voisine, Edgar Linton, beaucoup plus apte à lui convenir socialement que la rusticité d'Heathcliff, traité comme un vulgaire serviteur par Hindley depuis la mort de son père. Heathcliff ne s'en remettra, disons-le, jamais et cette rupture sans franchise sera le point de départ d'un comportement aussi détestable que machiavélique dont tout le monde, y compris Catherine et y compris lui-même, pâtira.
Hurlevent me causait un oppression inexplicable. Je sentais que Dieu avait abandonné à ses vagabondages pervers la brebis égarée et qu'une bête malfaisante rôdait entre elle et le bercail, attendant le moment de bondir et de détruire.
A la question ai-je adoré une seconde fois ? la réponse est mille fois oui. Emily réussit l'impossible : créer un huis-clos dans un roman où la lande compte parmi les personnages principaux du roman. Cette lande-là cristallise toutes les émotions des personnages. Elle en est leur métaphore perpétuelle (coucou, poésie lyrique). Ainsi, rares sont instants de beau temps dans cette saga étouffante qui dure presque trente ans. Les événement capitaux se passent toujours dans la pénombre, à la nuit tombée, voire en plein cœur de la nuit angoissante et, comme si cela ne suffisait pas, il pleut bien souvent et le vent hurle - comme le titre du roman le laisse un poil deviner - à travers tous les interstices. Si l'on ajoute à cela la décrépitude austère des Hauts de Hurlevent, en position à la fois écartée et dominante sur la lande, l'opposition flagrante qui se dessine entre cette bâtisse et la Grange, et la persécution vengeresse d'Heathcliff tout le long de l'oeuvre, on a l'impression d'avoir mis les deux pieds dans un bon vieux roman gothique comme les anglais du début du dix-neuvième siècle savent si bien faire. Sauf que de créatures surnaturelles, il n'y en a pas vraiment. Evidemment, on va abondamment parler de la maladie, de la mort, de vengeance, de cauchemars et de fantômes - on ne va pas se mentir : Emily avait un petit grain et, si elle vivait à notre époque, elle kifferait sûrement Black Sabbath - mais un pas de côté est tout de même opéré par rapport au roman gothique canonique. C'est qu'Emily s'amuse à en infuser tous les clichés dans la vie quotidienne de son époque. Ainsi, ce n'est pas le surnaturel qui s'invite dans la vraie vie mais la vraie vie qui devient surnaturelle. A partir de là, on comprend déjà qu'on n'a pas à faire à une auteure du dimanche pour jouer avec autant de brio de topoï mille fois vus à son époque (et à la nôtre), elle qui n'a, par ailleurs, jamais vraiment quitté sa lande et connu autre chose que le cocon du presbytère familial. chapeau, l'artiste.
Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeurât, je continuerais d'exister ; mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger, je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois : le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous : source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff ! Il est toujours, toujours dans mon esprit ; non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être.
A la question ai-je adoré comme la première fois ? la réponse est évidemment non. A seize ans, je n'avais lu que l'histoire d'amour passionnelle entre Catherine et Heathcliff et cela m'avait semblé le summum du romantisme noir fabuleux (Il parait d'ailleurs que c'est le "roman favori" des héros de Twilight. D'un coup, j'ai un petit peu envie de mourir). Vingt ans plus tard, je m'aperçois qu'on ne lit finalement dans un livre ce qu'on a envie d'y lire à l'instant T et, accessoirement, que certains éléments réclament une maturité qu'on n'a pas toujours lors d'une première lecture - c'est d'ailleurs ce qui rend la relecture des classiques si passionnante et si nécessaire. Là où je ne m'étais pas fourvoyée, c'est qu'on peut difficilement faire amour plus passionnel. Lorsque l'un ou l'autre protagoniste l'évoque d'ailleurs, l'individualité de l'autre est totalement annihilée : l'autre, c'est soi-même. Cette simple assertion justifie autant l'amour que la souffrance, autant la possession, la vengeance que la destruction. Autant vous dire que ça ne me fait absolument plus rêver - j'ai peine à comprendre, maintenant, comment ça a pu me faire rêver un jour d'ailleurs (on n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans comme dirait l'autre ?). Aussi, je ne peux pas dire, ce coup-ci, que l'histoire m'a plu. Les personnages me sont presque tous apparus détestables, Catherine en tête de file. Enfant indisciplinée, impulsive, manipulatrice puis jeune femme capricieuse, égocentrique et névrosée : le combo gagnant de l'héroïne romanesque la plus antipathique de l'univers. Heathcliff mis à part dont j'ai déjà parlé, du côté des Earnshaw, Hindley est un ivrogne patenté accro au jeu depuis la perte de son amour (coucou Branwell), le serviteur Joseph est un moralisateur exécrable avec tout le monde ; du côté Linton, Edgar est certes lumineux et bon en opposition à Heathcliff mais il est aussi d'une faiblesse de caractère aussi ennuyeuse qu'irritante, Isabelle est mièvre et jalouse et le rejeton qu'elle a avec Heathcliff est un couard pitoyable capable de toutes les bassesses pour sauver sa peau. Non vraiment, les personnages de ce roman sont de vrais petits sucres ♥. Comme tout bon huis-clos qui se respecte, en outre, on reste entre soi, y compris pour les mariages - et là, en plus d'être détestable, c'est carrément malsain.
Je suis sans pitié ! Je suis sans pitié ! Plus les vers se tordent, plus grande est mon envie de leur écraser les entrailles ! C'est comme une rage de dents morale, et je broie avec d'autant plus d'énergie que la douleur est plus vive. (amour, joie, bonheur, tout ça.)
Cela dit, je m'aperçois que je n'ai vraiment pas besoin d'aimer une histoire ou des personnages pour aimer une oeuvre lorsqu'elle est brillante. Toute cette architecture savante - car je n'ai pas parlé de la construction narrative mais cet écheveau de narrateurs est absolument magistral : Heathcliff et Catherine ne sont saisis qu'à travers le regard de tiers qui ne se privent pas de mettre leur grain de sel dans l'appréciation de tel ou tel et l'on passe de l'un à l'autre comme si l'on écoutait une histoire - gothique - racontée un soir de grand vent au coin du feu. Toute cette architecture savante, donc, particulièrement novatrice pour l'époque, offre sans ennuyeuses tirades une fascinante réflexion métaphysique sur le bien et le mal, sur la nature exacte de l'enfer, sur l'essence même de la vie et des rapports humains. Là où Agnès Grey m'a semblé trop moralisateur, j'ai aimé la réflexion ouverte de ce roman-là, qui ne se permet pas de penser à la place du lecteur mais qui l'invite tout de même à se poser mille questions. Mon Dieu, décidément, que c'est brillant ; tellement brillant que c'en est violent et cinglant - mais comme j'ai moi-même un petit grain et que je kiffe Black Sabbath, vous pensez bien que je n'ai pas boudé mon plaisir.
16:43 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : les hauts de hurlevent, wuthering heights, emily bronte, littérature anglaise, classique, littérature victorienne, amour, passion, mort, vengeance, gothique, cliché, paysage, lande, pluie, nuit, maladie, tuberculose, alcool, heathcliff, catherine, earnshaw, linton, morale, fantôme, tombe, helen dean, lockwood, narrateur
27/01/2018
Minuit en mon silence de Pierre Cendors
J'allai à vous comme on marche au bord du vide, fouillé par la peur et un pressentiment mortel.
L'objet de ce très court récit (non paginé, au passage) est une lettre de Werner Heller, lieutenant du 5ème corps d'armée prussien en 1914. Enlisé dans cette Première Guerre Mondiale qui a tout de l'enfer, il s'adresse à la femme qu'il aime, à peine croisée, à la nuit tombée. Récit d'un sentiment amoureux que l'absence cristallise, réchauffe et mûrit, cette lettre se fait aussi réflexion sur la beauté, le silence et la mort, sainte trinité du poète. Embarqué aux côtés de l'esprit solitaire, étonnamment calme dans la tempête, de Heller, le lecteur le suit dans sa nuit de l'âme, plein d'une dignité lumineuse.
Je murmure des mots nocturnes. Peu à peu, je me rapproche de vous à voix basse. Et parce que la parole ne peut aller beaucoup plus loin, j'écris ce silence qui ira seul ouvrir le chemin.
Les thèmes et le ton ne sont pas sans rappeler quelques romantiques et néo-romantiques allemands - la quatrième de couverture cite d'ailleurs fort opportunément Novalis et Rilke. Pierre Cendors parvient le tour de force assez virtuose d'allier une certaine exaltation lyrique à la retenue nécessaire pour composer un texte fascinant. Honnêtement, écrivant cette chronique plusieurs semaines après ma lecture, je ne suis pas loin d'en faire l'éloge, tant je m'aperçois de l'originalité et du talent assez rares de Cendors dans le paysage littéraire et poétique actuel.
Il fait acte de poésie celui qui vous rend votre âme sans la négocier derrière le comptoir d'une religion. Sans poésie, un homme meurt sans mourir à soi, un enfant ne connaît pas d'enfance, car la poésie est l'imagination du réel, de ce réel que la société contrefait et nie par le boniment vernissé de sa culture.
La poésie, madame, c'est désimaginer le monde tel qu'on nous le vend. C'est découvrir qu'il n'est rien et que s'en éveiller est tout.
Pourtant, en toute franchise, je me dois de signaler le léger bémol qui m'est apparu au fil de ma lecture : cette sensation que, parfois, le verbe manquait du souffle nécessaire pour délivrer toute la pureté du propos. En d'autres termes, certains passages relevaient parfois trop de cette démonstration sensible dans une écriture poétique qui se sait être de la poésie. On n'est pas loin de la perfection, soyons bien clairs. Mais il ne manque plus à l'auteur que de l'oublier pour l'atteindre véritablement.
Comme si quelque chose de plus vivant que la vie pouvait exister ! Voilà sans doute une définition de l'art. Je la fais mienne. Vous me pardonnerez cette lettre. Je continue de l'écrire : les mots sont des yeux qui aident à sonder nos tréfonds, même à notre insu.
Une magnifique découverte, quoiqu'il en soit, qui me donne fort envie de plonger dans les autres textes de Pierre Cendors s'ils sont de cette même rare qualité. Minuit en mon silence est indéniablement de ces textes que l'on aimerait croiser plus souvent. Merci à l'étonnante librairie lyonnaise Le bal des ardents de les mettre en exergue ; merci évidemment aux éditions le Tripode de les publier.
Et le coeur ?
Il battait une mesure hivernale sous sa doublure de nuit.
11:32 Publié dans Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : pierre cendors, le tripode, minuit en mon silence, poésie, lettre, romantique, nuit, guerre, première guerre mondiale, mort, amour, solitude
28/01/2012
Onzains de la nuit et du désir de Jean-Yves Masson
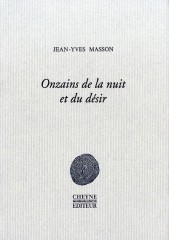
Onzains de la nuit et du désir de Jean-Yves Masson, Cheyne Editeur, 1995.
Prix Kowalski
Né en 1962, Jean-Yves Masson est professeur de Littérature comparée à l'université, traducteur d'écrivains irlandais, italiens et allemands, directeur de la collection de littérature allemande "Der Doppelgänger" aux excellentes éditions Verdier et (car tout cela ne suffit pas, il va sans dire) poète merveilleux.
Ce recueil, une de ses premières publications en maison d'éditions après l'incontournable passage par les revues, exprime une voix mêlée de modernité, de fraîcheur et de lyrisme. Cent vingt et un poèmes se déroulent selon la même structure formelle, maniée avec une virtuosité qui offre la quintessence d'un souffle maitrisé - qui rappelle les pères fondateurs (je n'ai pu m'empêcher de penser à Rilke) tout en laissant libre court à une personnalité qui se construit, s'affirme, nait pleinement poète. Ce n'est pas l'affirmation d'un Je suprême et finalement stérile à force d'être rabâché mais bien d'un Je méditatif, aérien et confiant à travers la lumière diffuse des temps et des espaces.
Une extraordinaire évolution déjà virtuose où l'on respire l'harmonie des tons, l'adequation de l'être à la vie - A lire de toute urgence et sans modération !
*
VII
Même ce qui de moi demeure dans tes rêves,
disait l'ombre, ne reconnaîtrait plus ces chemins.
J'ai passé. Je suis herbe ou rivage et je danse
avec le vent parmi l'espace où je repose,
au fond des mers, je suis ardeur,
et glace au coeur du feu. Amour, implorait-il,
qui saura le secret de nos métamorphoses,
qui dénouera l'énigme que nous sommes,
Oedipe et Sphinx en même temps, et meurtriers
de ce qui nous engendre et nous surprend
un jour sur la route de notre éveil?
XLIII
Je fus. C'était l'hiver en mon pays d'orage,
c'était toujours l'hiver. J'étais voix sur la route,
j'étais cygne blessé, main tendue vers la neige,
vers la voûte du ciel et la vie à venir.
Je fus cri. Mes bras d'ombre étaient déjà la route,
ma chevelure éparse un ruisseau pour mourir,
toute de sang et d'aube il me fallait la terre
et j'accueillais le temps pour l'écouter dormir.
Je fus, je reviendrai. Tout cri est réversible,
toute pierre retourne en amont du torrent,
et moi, fée, je deviens oracle et je t'attends.
*
09:00 Publié dans Coups de coeur, Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lumière, méditation, poésie, virtuose, onzains, nuit, désir, maturité, je




