29/05/2020
Le Lys dans la vallée de Balzac
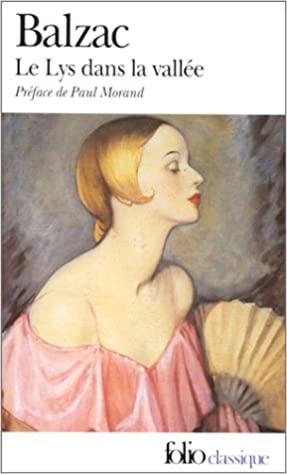 Véritable pensum de mon adolescence, Le Lys dans la vallée a réussi à me brouiller durablement avec Balzac jusqu'à ce que je découvre Le Colonel Chabert en 2014 c'est-à-dire avant-hier. Depuis, je l'ai peu lu mais j'ai toujours aimé. Aussi, me suis-je dit le mois dernier qu'il était temps de faire la paix avec mon vieux traumatisme littéraire (Rien que ça, oui. Toi aussi, tu les as connus, ces pavés chiants du XIXème que ton/ta prof de lettres t'imposaient de lire en Seconde alors que jusqu'ici, tu étais pépouze au collège avec des petits trucs abrégés et/ou faciles à lire ? Si oui, alors je sais que tu comprends cette impression désastreuse de sortir aux forceps 2 pauvres pages en 2 heures en sentant l'ennui étouffer petit à petit ta gorge.) De faire la paix, disais-je donc, et de relire Le lys dans la vallée. Il faut dire que cette idée a germé dans mon esprit en voyant fleurir ici ou là des chroniques hyper élogieuses au sujet de ce roman. Ok, me suis-je dit. A l'époque, tu étais jeune et peu aguerrie aux classiques ; tu n'as rien compris. Il ne faut jamais rester sur un échec. Vas-y et tâte du chef d’œuvre.
Véritable pensum de mon adolescence, Le Lys dans la vallée a réussi à me brouiller durablement avec Balzac jusqu'à ce que je découvre Le Colonel Chabert en 2014 c'est-à-dire avant-hier. Depuis, je l'ai peu lu mais j'ai toujours aimé. Aussi, me suis-je dit le mois dernier qu'il était temps de faire la paix avec mon vieux traumatisme littéraire (Rien que ça, oui. Toi aussi, tu les as connus, ces pavés chiants du XIXème que ton/ta prof de lettres t'imposaient de lire en Seconde alors que jusqu'ici, tu étais pépouze au collège avec des petits trucs abrégés et/ou faciles à lire ? Si oui, alors je sais que tu comprends cette impression désastreuse de sortir aux forceps 2 pauvres pages en 2 heures en sentant l'ennui étouffer petit à petit ta gorge.) De faire la paix, disais-je donc, et de relire Le lys dans la vallée. Il faut dire que cette idée a germé dans mon esprit en voyant fleurir ici ou là des chroniques hyper élogieuses au sujet de ce roman. Ok, me suis-je dit. A l'époque, tu étais jeune et peu aguerrie aux classiques ; tu n'as rien compris. Il ne faut jamais rester sur un échec. Vas-y et tâte du chef d’œuvre.
Et là, ça part assez mal : page 30, je me fais déjà chier. Il faut dire que Félix de Vandenesse n'a rien pour être particulièrement aimable or, manque de bol, c'est le narrateur du récit - fait suffisamment rare pour être noté chez Balzac qui est plutôt adepte ordinairement de la narration à la 3ème personne - fait crucial, même, puisque toute la compréhension du récit est chevillée au fait que Balzac délègue la narration à ce triste pitre. Le roman s'ouvre sur une lettre qu'il rédige à sa fiancée, Natalie (sans h) de Manerville, et qui éclaire le projet du texte qui suit : lui expliquer les rêveries mélancoliques qui le saisissent parfois. Dont acte. Félix remonte loin (tant qu'à faire) et pleurniche sur son enfance de petit garçon non désiré, non aimé, balloté dans des écoles médiocres de province où il était oublié même pendant les vacances. Dans ce passage, heureusement court, l'égocentrisme n'a d'égal que la sensiblerie et je défie quiconque, même plus empathe que moi, d'avoir une autre réaction que l'envie de gifler Félix. Dites-vous pourtant que ce n'est que le début (vous n'avez lu que 10 pages sur plus de 250 à ce stade) parce que tout va s'enliser dans la guimauve au moment de sa rencontre avec LA femme : Mme de Morsauf. Il a la vingtaine toute fraîche ; elle a huit ans de plus que lui. Il ne connaît rien aux femmes ; elle est mariée à un homme malade, irascible, incompétent et est mère de deux enfants. Il a le coup de foudre pour elle lors d'une soirée, la retrouve dans le château voisin de celui d'un ami de la famille chez qui il passe des vacances et c'est parti pour la plus célèbre histoire d'amour platonique de la littérature française - que Félix va tout de même pimenter au bout de quelques années avec une maîtresse anglaise, Lady Arabelle Dudley, parce que le baise-main et les bouquets de fleurs enflammés, ça va bien cinq minutes (men have needs).
Alors si je m'ennuyais déjà page 30, pourquoi ai-je continué, me direz-vous ? La clé se trouve dans ce simple mot : ironie. Je disais tout à l'heure que Balzac délègue la narration à Félix. Aussi, ce récit à la première personne, au cours duquel notre narrateur personnage commet perpétuellement la bévue d'estimer les pensées d'autrui en tombant toujours à côté de la plaque, est-il d'une subjectivité tellement extrême, eu égard à son égocentrisme, qu'il n'y a de recul sur rien ni sur personne. A travers lui, Balzac s'en donne à cœur joie, mais alors vraiment, pour lyncher le lyrisme à coup de tournures stupides et ampoulées. Que dire, par exemple, de cette première vision de Mme de Mortsauf :
Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d'une gaze, mais dont les globes azurés et d'une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle. Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des jouissances infinies: le brillant des cheveux lissés au-dessus d'un cou velouté comme celui d'une petite fille, les lignes blanches que le peigne y avait dessinées et où mon imagination courut comme en de frais sentiers, tout me fit perdre l'esprit. Après m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeai dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère, et je baisai toutes ces épaules en y roulant ma tête.
Si donc on peut vanter l'écriture de ce roman, c'est pour son traitement ironique sans concession, quoi que peu fin du coup, vous l'aurez compris, dont il use pour fustiger et tourner en ridicule la prose romantique sentimentale de son époque. La prendre au premier degré me semble difficile puisque ce serait considérer Balzac comme le pire écrivain de son temps, ce qu'il n'était tout de même pas, quand bien même il avait ses propres lourdeurs à l'occasion. Clairement, je ne qualifierais pas la langue de belle dans ce récit. Elle est aussi légère et subtile que Carlos en string. MAIS elle a indéniablement quelque chose de jouissif et de piquant tant elle se moque sans déguisement avec une outrance telle qu'on est parfois tenté de rire (je confesse néanmoins que j'ai souvent lu en diagonale malgré tout, histoire de ne pas mourir d'overdose. Ironie ou pas, c'est quand même furieusement écœurant sur la durée)(Vous reprendrez bien un peu de guimauve ?).
Avoir mis le doigt sur cet élément déterminant de l’œuvre a miraculeusement tout éclairé et m'a permis d'apprécier, en outre, ces personnages souvent complexes qui gravitent autour de Félix de Vandenesse. A commencer par Mme de Mortsauf, évidemment. Une sorte de Mme de Rênal qui ne cède jamais, à la fois corsetée par la morale chrétienne, les devoirs qu'elle a envers ses enfants et envers son domaine - bien que présentée comme une chose fragile par Félix, elle est en fait d'une incroyable force de caractère, gestionnaire impeccable et suffisamment subtile pour ne pas montrer à son mari son impuissance à diriger lui-même les affaires - et surtout, emberlificotée dans l'image hiératique que son jeune ami à former d'elle. Elle est tour à tour une sainte, un ange, une martyre, bref la figure par excellence de la chaste intouchable que l'on adore à défaut d'aimer. Félix aime d'elle une image et ne la connait pas. Mieux : il ne cherche pas à la connaître. Elle est circonscrite à la tour d'ivoire de Clochegourde (et ce nom, mes amis !). Or, Mme de Mortsauf est bien autrement que cela, mais cette intériorité ne sera jamais décelée par un Félix trop aveuglé par ses propres idées. La sainteté dont il nimbe Mme Mortsauf n'a d'égale que la diabolisation de Lady Dudley, la femme séductrice et sensuelle par excellence, qui devient sous la plume de Félix, à peine mieux qu'une courtisane. Or, elle aussi, on le comprend très vite, est plus complexe et passionnante, en plus d'être passionnée, que ce que Félix voit d'elle. Mme de Mortsauf et Lady Dudley ne diffèrent pas tant que ça, finalement. Elles sont, incarnés en deux personnages distincts, l'avant et l'après de la Présidente Tourvel dans Les Liaisons dangereuses. (Je pourrais en parler encore longtemps mais je vais m'arrêter là : c'est déjà beaucoup trop long) Et Félix, lui, est ce bouffon très infatué qui se prend pour un roi malheureux parce qu'il ne comprend rien.
Tout cela s'achève comme ça a commencé : par une lettre. En l'occurrence, la réponse de Natalie de Manerville qui ne laisse plus aucun doute sur la lecture nécessairement ironique à faire de l’œuvre. Alors, j'ai beaucoup entendu et lu que cette lettre était savoureuse à souhait. Je dirais pour ma part que j'en ai fait une lecture qui prête autant à discussion que le reste car tout ne me semble pas non plus de très bon goût. Mais ce qui est sûr, c'est que ça remet joliment ce crétin de Félix à sa place et rien que ça, c'est pas dommage !
C'était donc super mal parti et aussi fou que ça puisse paraître - j'en suis vraiment la première étonnée - je crois que j'ai beaucoup aimé. C'est dingue parce que je me rends compte que je n'ai saisi l'ironie de quasiment aucune de mes lectures classiques d'adolescence. J'avais eu le même problème avec Madame Bovary par exemple. Ce qui est assez logique d'ailleurs : Ne pas tout prendre au premier degré s'apprend (pour moi). A fortiori, comprendre l'ironie d'un texte lorsque celle-ci est subtile et intrinsèquement liée à la compréhension d'un courant littéraire, du style littéraire d'un auteur, d'une époque, de ses mœurs et de sa politique, ça se travaille doublement. Ce qui revient au poncif absolument vrai qui consiste à dire qu'aimer ou pas un livre, finalement, c'est une affaire de rencontre et donc une affaire de timing (oui, parfois, les poncifs disent vrai).
J'en tire trois conclusions :
1/ Ne jamais hésiter à relire ces lectures qu'on a détestées plus jeune. Le faire dès qu'on le sent parce qu'il y a de grandes chances qu'elles ne soient plus du tout les mêmes.
2/ Ne plus jamais se forcer à aller au bout d'un livre qui saoule. Alors quand je dis "ne plus se forcer"... Évidemment, un livre un peu costaud peut résister quelques dizaines de pages au début et c'est normal. Faire l'effort de sortir de sa zone de confort pour se frotter à un nouveau style, plus exigeant, ne fait pas de mal à l'occasion. Non, là, je parle du bouquin dont tu as déjà lu plusieurs dizaines de pages et qui persistent à te raser. Alors là, tant pis pour lui ou tant pis pour toi. Mais en attendant, le moment de la rencontre n'est pas là et te forcer ne sert à rien (Spéciale dédicace aux Frères Karamazov de Dostoievski et à Nord et Sud d'Elizabeth Gaskell qui m'ennuyaient toujours autant au bout de deux cents pages).
3/ Balzac est un auteur que j'aime de plus en plus et que j'ai de plus en plus envie de lire. Dingue ! Mon moi d'il y a vingt ans est en PLS sur le carrelage de la cuisine et la prof de Lettres en moi le regarde en souriant. On évolue et c'est heureux. J'ai des grosses envies d'Illusions perdues pour cet été. La suite au prochain numéro, donc !
Précédemment chroniqués de Balzac : Le Colonel Chabert, Le père Goriot et Le Chef d’œuvre inconnu.
18:05 Publié dans Classiques, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : balzac, le lys dans la vallée, la comédie humaine; amour, lyrisme, ironie, romantisme, lettre, confession, critique
20/04/2020
Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne
 Non mais regardez-moi cette beauté... Je ne sais pas vous mais avec ce confinement, j'ai des envies d'aventures littéraires ! Pour cela, j'ai toujours eu une affinité particulière pour la mer, qui exalte à merveille l'Histoire, la liberté, l'exotisme et la technique.
Non mais regardez-moi cette beauté... Je ne sais pas vous mais avec ce confinement, j'ai des envies d'aventures littéraires ! Pour cela, j'ai toujours eu une affinité particulière pour la mer, qui exalte à merveille l'Histoire, la liberté, l'exotisme et la technique.
La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle ! Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à trente pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît ! Ah ! Monsieur, vivez, vivez au sein des mers ! Là seulement est l'indépendance ! Là je ne reconnais plus de maîtres ! Là je suis libre !
Puisque je n'avais encore jamais lu Jules Verne, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'embarquer à bord du Nautilus aux côtés du Professeur Aronnax, son serviteur Conseil et le harponneur Ned Land après le naufrage de leur navire. Ceux qui avaient pris la mer pour détruire le Nautilus, qu'ils pensaient un mammifère marin selon l'expertise d'Aronnax, se trouvent finalement secourus par lui et, conséquemment prisonniers à son bord : pour rien au monde, le commandant de cet étrange équipage ne voudrait que les secrets de son existence ne soient révélés. Dans un premier temps, nos personnages, surtout Aronnax, semblent vite s'en accommoder tant la vie à bord est riche, confortable et les découvertes alentours nombreuses.
Adieu, soleil ! s'écria t-il. Disparais, astre radieux ! Couche toi sous cette mer libre, et laisse une nuit de six mois étendre ses ombres sur mon nouveau domaine !
Quel paradoxe, me suis-je dit très rapidement dans ma lecture, que de choisir pour m'évader du confinement un roman qui en est en même temps le parangon ! En effet, comment faire plus confiné qu'un sous-marin ? D'autant que le séjour de nos trois personnages n'est ni plus ni moins qu'une incarcération à vie, quand bien même les premières semaines se vivent dans la joie et la bonne humeur de mets nouveaux et de poissons en tous genres.
Paradoxal, oui, mais pas tant que ça. Les murs du Nautilus se révèlent vite une fenêtre ouverte sur le monde. Aronnax et Conseil se gorgent d'observations naturalistes à travers les immenses hublots du bâtiment quand ils ne descendent pas les fonds marins en scaphandre. En dehors de cela, ils se repaissent aussi des prouesses techniques étourdissantes du sous-marin. Le dépaysement de cette lecture se trouve précisément dans cette acclimatation des personnages et dans leurs surprenantes découvertes.
Ce fut particulièrement fascinant de lire si flagrante la paternité vernienne du steampunk. L'auteur pose les jalons d'aventures et de personnages à la fois ultra ancrés dans le XIXème siècle - la plupart des considérations politiques, sociales, humaines ou inter-espèces sont très exactement de leur époque - et pleine d'imagination voire d'anticipation sur le plan technique - exaltation typiquement dix-neuvièmiste aussi, d'ailleurs. J'ai goûté avec plaisir ce retour aux sources littéraires d'un mouvement né réellement cent ans plus tard mais dont les fondations sont déjà présentes dans chaque page de ce roman, brillantes d'une confiance absolue et aveugle en les capacités scientifiques humaines.
Néanmoins, ce dépaysement fut parfois un poil ennuyeux aussi, soyons francs. On sait que Jules Verne écrivait des romans à vocation didactique selon les préconisations de son éditeur Hetzel et cela se ressent à travers les très (trop) nombreuses listes taxinomiques ou les détails techniques pointus et longs de telle ou telle spécificité du Nautilus. On finit par s'y faire, tant cette lenteur narrative est immersive. Cela devient un peu la berceuse lancinante, le rendez-vous théorique et régulier des pages du roman, et l'on n'y fait plus trop attention. Selon l'humeur, on les lit comme si l'entièreté de l'océan défilait sous nos yeux, ou on les saute pour attaquer directement dans le vif du sujet.
Non seulement, il s'était mis en dehors des lois humaines, mais il s'était fait indépendant, libre dans la plus rigoureuse acceptation du mot, hors de toute atteinte! Qui donc oserait le poursuivre au fond des mers, puisque, à leur surface, il déjouait les efforts tentés contre lui?
[...]
À dix heures du soir, le ciel était en feu. L’atmosphère fut zébrée d’éclairs violents. Je ne pouvais en supporter l’éclat, tandis que le capitaine Nemo, les regardant en face, semblait aspirer en lui l’âme de la tempête.
Evidemment, c'est impossible de vous parler de Vingt mille lieues sous les mers sans m’appesantir sur le cultissime Capitaine Nemo. Quel personnage étrange et mystérieux ! Au fond, nous ne savons ni ne saurons rien de lui dans ce roman, si ce n'est ce qu'il veut bien montrer au présent : un caractère libre et solitaire, une misanthropie patentée, une grande soif de culture et de connaissance du monde marin, un charisme incroyable et des blessures dont on ne constate que les conséquences dévastatrices. Son histoire ne sera contée que dans L'île mystérieuse ; je dois donc attendre la fin du confinement pour la découvrir ! En attendant, même si Nemo n'est pas aimable, loin s'en faut, je n'ai pu m'empêcher d'être touchée par son magnétisme et cette dualité intrinsèque qui le rend très humain. En tournant la dernière page du roman, je me suis sentie triste de devoir le laisser poursuivre sa route solitaire, sans vraiment savoir ce qu'il advenait de lui. Jules Verne a réussi à me piquer suffisamment pour me donner envie de le retrouver dès que possible ! Certes, ce ne fut pas toujours de tout repos mais quelle verve et quel souffle épique !
Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la terre, mais de nouveaux hommes!
PS : Un certain 20 avril :
Cette terrible scène du 20 avril, aucun de nous ne pourra jamais l’oublier. Je l’ai écrite sous l’impression d’une émotion violente. Depuis, j’en ai revu le récit. Je l’ai lu à Conseil et au Canadien. Ils l’ont trouvé exact comme fait, mais insuffisant comme effet. Pour peindre de pareils tableaux, il faudrait la plume du plus illustre de nos poètes, l’auteur des Travailleurs de la Mer.
J’ai dit que le capitaine Nemo pleurait en regardant les flots. Sa douleur fut immense...
Voilà, il va vous falloir lire le roman pour savoir ce qu'il s'est passé... Et moi, il faudrait peut-être que j'en revienne à Hugo. On peut tout de même saluer l'honnêteté de Verne quant à ses talents littéraires face au dieu des dieux !
15:59 Publié dans Aventure, Classiques, Coups de coeur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : vingt mille lieues sous les mers, jules verne, classique, aventure, nautilus, capitaine nemo, aronnax, sous-marin, océan, technique, steampunk, science
09/03/2020
Le Turquetto de Metin Arditi
 Un tableau, L'homme au gant du Titien, et c'est le point de départ de tout.
Un tableau, L'homme au gant du Titien, et c'est le point de départ de tout.
A partir de l'anomalie chromatique de la signature, Metin Arditi fantasme un peintre de la Renaissance, effacé de l'histoire de l'art parce que juif, nommé Elie Soriano puis Ilias Troyanos, dit Le Turquetto.
Le roman saisit cette personnalité peu sympathique mais déterminée et étourdissante de génie à trois moments clés de son existence : son enfance à Constantinople avec un père et une nourrice marchands d'esclaves, une des rares professions autorisées aux juifs, et un désir déjà violent de braver cette religion dont il se fiche pour s'adonner à l'art pictural ; à Venise où il s'enfuit et apprend cet art sublime, devenu adulte, en équilibrant à la perfection le dessin et la couleur ; et, de retour à Constantinople enfin, où il devra se réconcilier avec son passé.
J'aime ce point de départ car j'ai souvent rêvé moi-même toute une histoire face à des oeuvres grandioses. J'aime que Metin Arditi en ait brossé une époque par la même occasion et ait interrogé conjointement, parce qu'indissociables à ce moment-là, la question de la religion, ou devrais-je dire des religions, et celle de la création artistique. Ça se lit très facilement et si aucun passage ne m'a vraiment marquée en terme de style, j'ai par contre été extrêmement sensible aux scènes relatives au procès du Turquetto. C'est là qu'on se rappelle que les religions, toutes dans le même panier au passage, ont quand même le potentiel de foutre un beau merdier. Même si l'un des plus beaux personnages est un haut dignitaire religieux, on voit précisément comme il n'est d'aucun pouvoir face à l'inepte machine dogmatique et finit broyé comme n'importe qui.
Et sinon, je viens de dénicher un reportage sur L'homme au gant. Inutile de dire que j'ai envie d'en savoir plus, maintenant !

07:30 Publié dans Art, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : le turquetto, metin arditi, art, peinture, renaissance, titien, l'homme au gant, religions, actes sud




