29/07/2020
L'Education sentimentale de Gustave Flaubert
 Depuis quelques années, je redécouvre Flaubert et plus je le lis/plus je vieillis, plus je l'apprécie. Aussi, je me suis dit qu'il était temps de réessayer L'Education sentimentale qui m'avait rasée il y a quelques quinze ans au point d'en abdiquer la lecture aux alentours de la page 140 (mon nombre de pages fatidique à l'époque). Pour me motiver à réitérer l'expérience dans l'année en cours, j'avais inclus ce titre dans ma pile des 20 pour 2020 (challenge initié sur Instagram par Fanny). Honnêtement, dans les faits, je me voyais moyennement atteindre mon objectif mais deux éléments m'ont finalement décidée à en faire le premier livre des grandes vacances :
Depuis quelques années, je redécouvre Flaubert et plus je le lis/plus je vieillis, plus je l'apprécie. Aussi, je me suis dit qu'il était temps de réessayer L'Education sentimentale qui m'avait rasée il y a quelques quinze ans au point d'en abdiquer la lecture aux alentours de la page 140 (mon nombre de pages fatidique à l'époque). Pour me motiver à réitérer l'expérience dans l'année en cours, j'avais inclus ce titre dans ma pile des 20 pour 2020 (challenge initié sur Instagram par Fanny). Honnêtement, dans les faits, je me voyais moyennement atteindre mon objectif mais deux éléments m'ont finalement décidée à en faire le premier livre des grandes vacances :
1/ J'ai passé l'épreuve folle de relire Le lys dans la vallée de Balzac il y a quelques mois et ça s'est finalement plutôt bien passé. A partir de là, toutes les lectures étaient possibles ;
2/ Electra avait prévu de le lire cet été. J'ai profité de l'occasion pour lui proposer une lecture commune histoire de me motiver. Nous y voilà !
L'Education sentimentale couvre grosso modo 12 ans de la vie de Frédéric Moreau, protagoniste velléitaire, avec une ellipse temporelle finale qui nous projette directement en 1867 dans les tous derniers chapitres conclusifs. En parallèle, et peut-être bien principalement, c'est autant d'années d'existence d'une époque que dépeint Flaubert : celle du déclin de la dernière monarchie française, de l'avènement de la 2ème République puis du Second Empire. Bref, le virage du milieu du XIXème siècle.
Mais revenons-en brièvement à Frédéric pour planter le nœud du récit - extrêmement ténu, soyons clairs, attendu que Flaubert ici ne fait pas dans le roman palpitant à tiroirs. En septembre 1840, Frédéric Moreau, jeune homme de 18 ans rentre à Nogent chez sa mère après une visite chez un oncle dont il brigue l'héritage. Il n'a aucune envie de retourner s'enterrer deux mois dans ce trou avant d'attaquer son droit à Paris, aussi rentre-t-il par la voie la plus longue : le bateau. Durant le trajet, il fait la connaissance d'Arnoux, un marchand d'art à la faconde séduisante mais vulgaire, et de sa femme, la belle madame Arnoux dont il tombe instantanément amoureux. Durant toutes les années qui vont suivre, il n'aura de cesse de se rapprocher du cercle des Arnoux pour fréquenter cette femme simple et belle qui lui inspire tant de respect et un amour aussi constant que sincère sans qu'il ne se passe finalement jamais rien. En parallèle de quoi, il nourrit bien des projets sans jamais aller au bout de rien. Contrairement à son ami d'enfance Deslauriers, Frédéric vit dans une aisance financière suffisante, bien que fluctuante au cours de sa vie, pour ne pas nourrir d'ambition forcenée. Il n'a pas besoin de parvenir, il est déjà un bourgeois installé depuis sa naissance. Aussi, même politiquement, contrairement à Sénécal, très extrémiste dans son engagement par exemple, il ne se mouille pas vraiment. Il suit le mouvement en ne voyant que ce qu'il veut voir. Frédéric, en somme, est l'incarnation de la médiocrité bourgeoise, ce juste milieu qui ne crée ni ne construit rien sans être méchant pour autant (en même temps, il ne manquerait plus qu'il morde). Il est exactement le contraire du Rastignac balzacien auquel l'auteur fait référence avec son ironie subtile et délicieuse au tout début du roman, dans la bouche de Deslauriers :
- Rappelle-toi Rastignac dans la Comédie humaine ! Tu réussiras, j'en suis sûr !
Évidemment, ce sera un échec cuisant à tous points de vue.
Cette existence plutôt insipide est finalement l'occasion de brosser une époque, cette charnière décisive du XIXème siècle. L'esprit romantique incarné par Frédéric atteint ses limites : beaucoup de projets et de rêves, de grandes aspirations (j'allais dire de Grandes espérances) mais aucune inscription véritable dans la société. Beaucoup de bruit pour rien dirait Shakespeare. Voilà. A un moment donné, c'est beau de rêver et de s'exalter mais ça n'aboutit à rien si ce n'est pas nourri d'effets concrets. Rapidement, d'ailleurs, Frédéric laissera tomber ses velléités (parmi d'autres) d'écriture poétique et de création picturale. Littérairement, le virage entre le romantisme et le réalisme est ainsi fait.
Il s’était arrêté au milieu du Pont-Neuf, et, tête nue, poitrine ouverte, il aspirait l’air. Cependant, il sentait monter du fond de lui-même quelque chose d’intarissable, un afflux de tendresse qui l’énervait, comme le mouvement des ondes sous ses yeux. À l’horloge d’une église, une heure sonna, lentement, pareille à une voix qui l’eût appelé.
Alors, il fut saisi par un de ces frissons de l’âme où il vous semble qu’on est transporté dans un monde supérieur. Une faculté extraordinaire, dont il ne savait pas l’objet, lui était venue. Il se demanda, sérieusement, s’il serait un grand peintre ou un grand poète ; — et il se décida pour la peinture, car les exigences de ce métier le rapprocheraient de Mme Arnoux. Il avait donc trouvé sa vocation ! Le but de son existence était clair maintenant, et l’avenir infaillible.
Quand il eut refermé sa porte, il entendit quelqu’un qui ronflait, dans le cabinet noir, près de la chambre. C’était l’autre. Il n’y pensait plus.
Flaubert se concentre aussi sur le portrait politique et social de cet entre-deux du siècle. Ainsi, de longs passages (très intéressants intellectuellement mais je dois vous dire avec honnêteté qu'ils ne sont pas toujours très enthousiasmants pour le lecteur néanmoins...) sont consacrés aux discussions politiques lors desquelles Frédéric, fidèle à lui-même, reste très en retrait et l'on observe de façon distanciée et toujours ironique les motivations révolutionnaires (l'ambition, la domination, l'égalité) des insurrections successives (1848, le coup d’État de Napoléon III).
— Est-ce que les journaux sont libres ? est-ce que nous le sommes ? dit Deslauriers avec emportement. Quand on pense qu’il peut y avoir jusqu’à vingt-huit formalités pour établir un batelet sur une rivière, ça me donne envie d’aller vivre chez les anthropophages ! Le Gouvernement nous dévore ! Tout est à lui, la philosophie, le droit, les arts, l’air du ciel ; et la France râle, énervée, sous la botte du gendarme et la soutane du calotin !
L'auteur nous invite également à déambuler dans nombre de soirées mondaines où d'autres ambitions se découvrent, notamment celles des femmes qui n'ont finalement pas cinquante possibilités à leurs dispositions à l'époque : épouser ou se prostituer. Une mention spéciale pour le personnage de Rosanette, la courtisane qui passe entre tous les bras comme moyen de s'extirper de son effroyable condition d'origine. Celle qui apparaît au départ comme une Marie couche-toi-là écervelée - par opposition à Marie Arnoux, sainte entre toutes, sorte de Mme de Tourvel qui ne flanche pas (il faut dire à sa décharge que Frédéric n'a rien de Valmont) - est en fait d'une complexité intéressante. J'ai particulièrement apprécié que les personnages féminins soient d'une heureuse profondeur, à la fois factuelle et symbolique.
L’affranchissement du prolétaire, selon la Vatnaz, n’était possible que par l’affranchissement de la femme. Elle voulait son admissibilité à tous les emplois, la recherche de la paternité, un autre code, l’abolition, ou tout au moins « une réglementation du mariage plus intelligente ». Alors, chaque Française serait tenue d’épouser un Français ou d’adopter un vieillard. Il fallait que les nourrices et les accoucheuses fussent des fonctionnaires salariés par l’État ; qu’il y eût un jury pour examiner les œuvres de femmes, des éditeurs spéciaux pour les femmes, une école polytechnique pour les femmes, une garde nationale pour les femmes, tout pour les femmes ! Et, puisque le Gouvernement méconnaissait leurs droits, elles devaient vaincre la force par la force. Dix mille citoyennes, avec de bons fusils, pouvaient faire trembler l’hôtel de ville !
(Et hop, un joli discours indirect libre flaubertien comme on les aime ♥)
Le bilan de ma lecture est donc plutôt positif dans la mesure où, intellectuellement parlant, Flaubert coche toutes les cases de ce qui me ravit les neurones : une finesse stylistique sans pareille, une musicalité syntaxique impeccable, une ironie aussi subtile que mordante et un propos ô combien maîtrisé qui s'exprime à travers une construction narrative parfaite. Pour autant, comme je l'ai brièvement mentionné précédemment, ce n'est pas une lecture exaltante. Flaubert a voulu signifier les limites du romantisme, en marquer son essoufflement, et sanctionner le passage d'une ère à une autre ; dont acte. Mon professeur de XIXème à l'université avait résumé L'Education sentimentale en disant qu'il s'agissait d'un roman sur l'ennui - ce qui m'avait marquée, évidemment, parce que ce n'est pas la mise en bouche la plus engageante, n'est-ce pas ! Et en effet, c'est tout à fait ça. C'est tellement bien fait, d'ailleurs, qu'on est pas loin de s'ennuyer régulièrement en le lisant, du coup... Autant vous dire que ce qui m'a sauvée, comme avec Le Lys dans la vallée, c'est d'avoir su lire un certain nombre de passages en lecture rapide. Il n'est pas dit, sinon, que j'aurais tenu jusqu'au bout - ce que je suis ravie d'avoir fait au demeurant, car la conclusion de l'histoire d'amour durable bien que platonique entre Frédéric et Mme Arnoux est vraiment touchante et belle. Vous voilà donc prévenus si vous ambitionnez de vous attaquer à ce monument.
Bien qu’il connût Mme Arnoux davantage (à cause de cela, peut-être), il était encore plus lâche qu’autrefois. Chaque matin, il se jurait d’être hardi. Une invincible pudeur l’en empêchait ; et il ne pouvait se guider d’après aucun exemple puisque celle-là différait des autres. Par la force de ses rêves, il l’avait posée en dehors des conditions humaines. Il se sentait, à côté d’elle, moins important sur la terre que les brindilles de soie s’échappant de ses ciseaux.
A présent, allons lire le billet d'Electra !
Textes de Flaubert précédemment lus et chroniqués : Un coeur simple, Madame Bovary et Salammbô, coup de coeur absolu que je vous encourage à lire absolument ♥
07:30 Publié dans Classiques, Histoire, Lecture commune | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : l'éducation sentimentale, gustave flaubert, xixème siècle, amour, ennui, vélleité, politique, monarchie de juillet, restauration, révolution, art, amour platonique, frédéric moreau, madame arnoux, lecture commune, ironie, louis-philippe
29/05/2020
Le Lys dans la vallée de Balzac
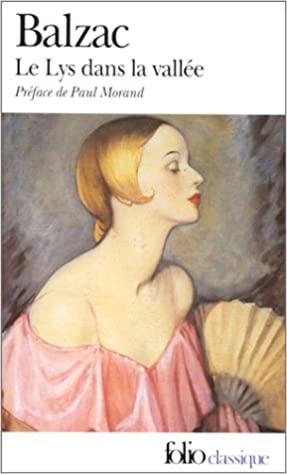 Véritable pensum de mon adolescence, Le Lys dans la vallée a réussi à me brouiller durablement avec Balzac jusqu'à ce que je découvre Le Colonel Chabert en 2014 c'est-à-dire avant-hier. Depuis, je l'ai peu lu mais j'ai toujours aimé. Aussi, me suis-je dit le mois dernier qu'il était temps de faire la paix avec mon vieux traumatisme littéraire (Rien que ça, oui. Toi aussi, tu les as connus, ces pavés chiants du XIXème que ton/ta prof de lettres t'imposaient de lire en Seconde alors que jusqu'ici, tu étais pépouze au collège avec des petits trucs abrégés et/ou faciles à lire ? Si oui, alors je sais que tu comprends cette impression désastreuse de sortir aux forceps 2 pauvres pages en 2 heures en sentant l'ennui étouffer petit à petit ta gorge.) De faire la paix, disais-je donc, et de relire Le lys dans la vallée. Il faut dire que cette idée a germé dans mon esprit en voyant fleurir ici ou là des chroniques hyper élogieuses au sujet de ce roman. Ok, me suis-je dit. A l'époque, tu étais jeune et peu aguerrie aux classiques ; tu n'as rien compris. Il ne faut jamais rester sur un échec. Vas-y et tâte du chef d’œuvre.
Véritable pensum de mon adolescence, Le Lys dans la vallée a réussi à me brouiller durablement avec Balzac jusqu'à ce que je découvre Le Colonel Chabert en 2014 c'est-à-dire avant-hier. Depuis, je l'ai peu lu mais j'ai toujours aimé. Aussi, me suis-je dit le mois dernier qu'il était temps de faire la paix avec mon vieux traumatisme littéraire (Rien que ça, oui. Toi aussi, tu les as connus, ces pavés chiants du XIXème que ton/ta prof de lettres t'imposaient de lire en Seconde alors que jusqu'ici, tu étais pépouze au collège avec des petits trucs abrégés et/ou faciles à lire ? Si oui, alors je sais que tu comprends cette impression désastreuse de sortir aux forceps 2 pauvres pages en 2 heures en sentant l'ennui étouffer petit à petit ta gorge.) De faire la paix, disais-je donc, et de relire Le lys dans la vallée. Il faut dire que cette idée a germé dans mon esprit en voyant fleurir ici ou là des chroniques hyper élogieuses au sujet de ce roman. Ok, me suis-je dit. A l'époque, tu étais jeune et peu aguerrie aux classiques ; tu n'as rien compris. Il ne faut jamais rester sur un échec. Vas-y et tâte du chef d’œuvre.
Et là, ça part assez mal : page 30, je me fais déjà chier. Il faut dire que Félix de Vandenesse n'a rien pour être particulièrement aimable or, manque de bol, c'est le narrateur du récit - fait suffisamment rare pour être noté chez Balzac qui est plutôt adepte ordinairement de la narration à la 3ème personne - fait crucial, même, puisque toute la compréhension du récit est chevillée au fait que Balzac délègue la narration à ce triste pitre. Le roman s'ouvre sur une lettre qu'il rédige à sa fiancée, Natalie (sans h) de Manerville, et qui éclaire le projet du texte qui suit : lui expliquer les rêveries mélancoliques qui le saisissent parfois. Dont acte. Félix remonte loin (tant qu'à faire) et pleurniche sur son enfance de petit garçon non désiré, non aimé, balloté dans des écoles médiocres de province où il était oublié même pendant les vacances. Dans ce passage, heureusement court, l'égocentrisme n'a d'égal que la sensiblerie et je défie quiconque, même plus empathe que moi, d'avoir une autre réaction que l'envie de gifler Félix. Dites-vous pourtant que ce n'est que le début (vous n'avez lu que 10 pages sur plus de 250 à ce stade) parce que tout va s'enliser dans la guimauve au moment de sa rencontre avec LA femme : Mme de Morsauf. Il a la vingtaine toute fraîche ; elle a huit ans de plus que lui. Il ne connaît rien aux femmes ; elle est mariée à un homme malade, irascible, incompétent et est mère de deux enfants. Il a le coup de foudre pour elle lors d'une soirée, la retrouve dans le château voisin de celui d'un ami de la famille chez qui il passe des vacances et c'est parti pour la plus célèbre histoire d'amour platonique de la littérature française - que Félix va tout de même pimenter au bout de quelques années avec une maîtresse anglaise, Lady Arabelle Dudley, parce que le baise-main et les bouquets de fleurs enflammés, ça va bien cinq minutes (men have needs).
Alors si je m'ennuyais déjà page 30, pourquoi ai-je continué, me direz-vous ? La clé se trouve dans ce simple mot : ironie. Je disais tout à l'heure que Balzac délègue la narration à Félix. Aussi, ce récit à la première personne, au cours duquel notre narrateur personnage commet perpétuellement la bévue d'estimer les pensées d'autrui en tombant toujours à côté de la plaque, est-il d'une subjectivité tellement extrême, eu égard à son égocentrisme, qu'il n'y a de recul sur rien ni sur personne. A travers lui, Balzac s'en donne à cœur joie, mais alors vraiment, pour lyncher le lyrisme à coup de tournures stupides et ampoulées. Que dire, par exemple, de cette première vision de Mme de Mortsauf :
Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d'une gaze, mais dont les globes azurés et d'une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle. Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des jouissances infinies: le brillant des cheveux lissés au-dessus d'un cou velouté comme celui d'une petite fille, les lignes blanches que le peigne y avait dessinées et où mon imagination courut comme en de frais sentiers, tout me fit perdre l'esprit. Après m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeai dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère, et je baisai toutes ces épaules en y roulant ma tête.
Si donc on peut vanter l'écriture de ce roman, c'est pour son traitement ironique sans concession, quoi que peu fin du coup, vous l'aurez compris, dont il use pour fustiger et tourner en ridicule la prose romantique sentimentale de son époque. La prendre au premier degré me semble difficile puisque ce serait considérer Balzac comme le pire écrivain de son temps, ce qu'il n'était tout de même pas, quand bien même il avait ses propres lourdeurs à l'occasion. Clairement, je ne qualifierais pas la langue de belle dans ce récit. Elle est aussi légère et subtile que Carlos en string. MAIS elle a indéniablement quelque chose de jouissif et de piquant tant elle se moque sans déguisement avec une outrance telle qu'on est parfois tenté de rire (je confesse néanmoins que j'ai souvent lu en diagonale malgré tout, histoire de ne pas mourir d'overdose. Ironie ou pas, c'est quand même furieusement écœurant sur la durée)(Vous reprendrez bien un peu de guimauve ?).
Avoir mis le doigt sur cet élément déterminant de l’œuvre a miraculeusement tout éclairé et m'a permis d'apprécier, en outre, ces personnages souvent complexes qui gravitent autour de Félix de Vandenesse. A commencer par Mme de Mortsauf, évidemment. Une sorte de Mme de Rênal qui ne cède jamais, à la fois corsetée par la morale chrétienne, les devoirs qu'elle a envers ses enfants et envers son domaine - bien que présentée comme une chose fragile par Félix, elle est en fait d'une incroyable force de caractère, gestionnaire impeccable et suffisamment subtile pour ne pas montrer à son mari son impuissance à diriger lui-même les affaires - et surtout, emberlificotée dans l'image hiératique que son jeune ami à former d'elle. Elle est tour à tour une sainte, un ange, une martyre, bref la figure par excellence de la chaste intouchable que l'on adore à défaut d'aimer. Félix aime d'elle une image et ne la connait pas. Mieux : il ne cherche pas à la connaître. Elle est circonscrite à la tour d'ivoire de Clochegourde (et ce nom, mes amis !). Or, Mme de Mortsauf est bien autrement que cela, mais cette intériorité ne sera jamais décelée par un Félix trop aveuglé par ses propres idées. La sainteté dont il nimbe Mme Mortsauf n'a d'égale que la diabolisation de Lady Dudley, la femme séductrice et sensuelle par excellence, qui devient sous la plume de Félix, à peine mieux qu'une courtisane. Or, elle aussi, on le comprend très vite, est plus complexe et passionnante, en plus d'être passionnée, que ce que Félix voit d'elle. Mme de Mortsauf et Lady Dudley ne diffèrent pas tant que ça, finalement. Elles sont, incarnés en deux personnages distincts, l'avant et l'après de la Présidente Tourvel dans Les Liaisons dangereuses. (Je pourrais en parler encore longtemps mais je vais m'arrêter là : c'est déjà beaucoup trop long) Et Félix, lui, est ce bouffon très infatué qui se prend pour un roi malheureux parce qu'il ne comprend rien.
Tout cela s'achève comme ça a commencé : par une lettre. En l'occurrence, la réponse de Natalie de Manerville qui ne laisse plus aucun doute sur la lecture nécessairement ironique à faire de l’œuvre. Alors, j'ai beaucoup entendu et lu que cette lettre était savoureuse à souhait. Je dirais pour ma part que j'en ai fait une lecture qui prête autant à discussion que le reste car tout ne me semble pas non plus de très bon goût. Mais ce qui est sûr, c'est que ça remet joliment ce crétin de Félix à sa place et rien que ça, c'est pas dommage !
C'était donc super mal parti et aussi fou que ça puisse paraître - j'en suis vraiment la première étonnée - je crois que j'ai beaucoup aimé. C'est dingue parce que je me rends compte que je n'ai saisi l'ironie de quasiment aucune de mes lectures classiques d'adolescence. J'avais eu le même problème avec Madame Bovary par exemple. Ce qui est assez logique d'ailleurs : Ne pas tout prendre au premier degré s'apprend (pour moi). A fortiori, comprendre l'ironie d'un texte lorsque celle-ci est subtile et intrinsèquement liée à la compréhension d'un courant littéraire, du style littéraire d'un auteur, d'une époque, de ses mœurs et de sa politique, ça se travaille doublement. Ce qui revient au poncif absolument vrai qui consiste à dire qu'aimer ou pas un livre, finalement, c'est une affaire de rencontre et donc une affaire de timing (oui, parfois, les poncifs disent vrai).
J'en tire trois conclusions :
1/ Ne jamais hésiter à relire ces lectures qu'on a détestées plus jeune. Le faire dès qu'on le sent parce qu'il y a de grandes chances qu'elles ne soient plus du tout les mêmes.
2/ Ne plus jamais se forcer à aller au bout d'un livre qui saoule. Alors quand je dis "ne plus se forcer"... Évidemment, un livre un peu costaud peut résister quelques dizaines de pages au début et c'est normal. Faire l'effort de sortir de sa zone de confort pour se frotter à un nouveau style, plus exigeant, ne fait pas de mal à l'occasion. Non, là, je parle du bouquin dont tu as déjà lu plusieurs dizaines de pages et qui persistent à te raser. Alors là, tant pis pour lui ou tant pis pour toi. Mais en attendant, le moment de la rencontre n'est pas là et te forcer ne sert à rien (Spéciale dédicace aux Frères Karamazov de Dostoievski et à Nord et Sud d'Elizabeth Gaskell qui m'ennuyaient toujours autant au bout de deux cents pages).
3/ Balzac est un auteur que j'aime de plus en plus et que j'ai de plus en plus envie de lire. Dingue ! Mon moi d'il y a vingt ans est en PLS sur le carrelage de la cuisine et la prof de Lettres en moi le regarde en souriant. On évolue et c'est heureux. J'ai des grosses envies d'Illusions perdues pour cet été. La suite au prochain numéro, donc !
Précédemment chroniqués de Balzac : Le Colonel Chabert, Le père Goriot et Le Chef d’œuvre inconnu.
18:05 Publié dans Classiques, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : balzac, le lys dans la vallée, la comédie humaine; amour, lyrisme, ironie, romantisme, lettre, confession, critique
09/04/2020
Oreiller d'herbe ou Le Voyage poétique de Natsume Sôseki
 Avant toute chose, je vous invite quelques secondes dans les coulisses de ce blog pour vous avouer ceci : je ne parviens pas à débuter mon billet à propos de ce livre magnifique (et donc, conséquemment, je le débute. Merci). Il faut dire qu'il ne raconte pas grand chose à proprement parler. Il y a bien un point de départ, assez éculé par la littérature depuis, d'ailleurs :
Avant toute chose, je vous invite quelques secondes dans les coulisses de ce blog pour vous avouer ceci : je ne parviens pas à débuter mon billet à propos de ce livre magnifique (et donc, conséquemment, je le débute. Merci). Il faut dire qu'il ne raconte pas grand chose à proprement parler. Il y a bien un point de départ, assez éculé par la littérature depuis, d'ailleurs :
Un jeune trentenaire, qui partage pas mal de points communs avec l'auteur notamment sa grande connaissance de la culture anglaise, décide de se retirer de Tōkyō vers les montagnes. Il entame une marche, seul, jusqu'à une auberge vide - la guerre sino-japonaise débutée en 1904 apparaît à demi-mots pour expliquer cette désertion - non sans dénicher tout de même quelques personnages fantomatiques, improbables, drôles ou mystérieux que ce conflit n'a pas (encore) délogés. Il ambitionne de peindre surtout - ce qu'il ne parvient jamais à faire - et d'écrire des haïkus - et de ce point de vue, nous sommes servis. Voilà, rien de plus. Il observe, rêve, pense : Il y a là l'essentiel de son quotidien en quête d'impassibilité et de création.
On estompe la couleur de la nature jusqu'au seuil du rêve et on avance d'un cran l'univers tel qu'il existe vers le pays des brumes. A la force magique du démon du sommeil, on arrondit les angles du réel et sur la surface ainsi ramollie on imprime une pulsation légère et lente.
Alors, cela ne raconte pas grand chose, certes, mais cela dit beaucoup - et c'est ce qui fait de ce texte un manifeste esthétique qui aura créé une cohorte d'autres voyages méditatifs (beaucoup moins bons) après lui. Sôseki ampute la fiction romanesque de ces scories artificielles autrement appelées péripéties. Laissons-là ces actions infinies qui n'en finissent pas, alimentées par une tentative de saisir le monde de façon superficielle, semble-t-il nous dire. Il en revient à l'essence du haïku : l'observation aiguisée, la sensibilité, la concision du saisissement, la légèreté, la beauté du geste réfléchit dans celle de l’œuvre - et l'adapte au format aéré, beaucoup plus opulent, du roman1 . L'entreprise est ambitieuse et donne de petites perles suspendues telles celle du chapitre du bain. L'obscurité y suggère une sensualité d'autant plus puissante que rien ne se découvre jamais vraiment. Pour mieux saisir, il faut éviter, contourner, ébaucher, être furtif et précis à la fois. C'est tout l'art du peintre qui, d'un seul trait, peut dessiner un oiseau à l'instant de l'envol.
Le vent agita les cerisiers sauvages dont les feuilles touffues laissèrent s’écouler toute l’eau tombée du ciel qu’elles avaient provisoirement retenue en leur demeure.
L'entreprise est ambitieuse et serait probablement ratée sans un ingrédient essentiel - celui qu'ont oublié bon nombre de successeurs de cette littérature : l'ironie - et ici encore, c'est une question de légèreté essentielle. Personne, nul paysage même, n'est saisi sans un recul salvateur. Les artistes européens trop infatués de leur égo, si l'on en croit le narrateur, tombent facilement dans l'écueil de la lourdeur. Or, une œuvre à la fois charmante et audacieuse, et tel est ce roman de Sôseki, est celle capable de défier la pesanteur.
Au cours d'un banquet, le peintre Turner s'exclama devant son assiette de salade : "C'est une couleur rafraîchissante, je l'utiliserai ! ".
Finalement, tout cela nous mène au fameux tableau que le narrateur ne peint à aucun moment du récit. Ce roman est son cheminement, ces interrogations vers la légèreté et, pour l'atteindre vraiment, il est temps de se taire. A la toute fin du roman, il a enfin l'inspiration d'un portrait et, par la même occasion, l'ingrédient nécessaire à la vie dans l'art. Jusque là, il n'avait fait qu'y penser. A présent que l’œuvre est là, il cesse d'écrire.
Avant d'en terminer tout à fait avec ce billet, je voudrais souligner la beauté de cette édition Picquier poche. Le texte est jalonné de très nombreuses reproductions de qualité d’œuvres picturales japonaises qui font de la lecture de ce roman un plaisir des sens. Le coût du livre est un poil plus onéreux que les autres éditions poche (10€) mais honnêtement, je ne saurais trop vous conseiller de préférer cette édition à toute autre tant elle permet de découvrir une esthétique qui nous est bien souvent étrangère.
Ainsi, puisque le monde dans lequel nous vivons est difficile à vivre et que nous ne pouvons pas pour autant le quitter, la question est de savoir dans quelle mesure nous pouvons le rendre habitable, ne fût-ce que la brève durée de notre vie éphémère. C'est alors que naît la vocation du poète, la mission du peintre.
1 D'ailleurs, sans du tout pousser plus avant une comparaison qui finirait par être tirée par les cheveux, vous aussi vous voyez un écho woolfien dans cette déconstruction du romanesque vers un saisissement poétique de la vie elle-même ?
11:33 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Littérature asiatique, Nature Writing/Récit de voyage, Poésie | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : oreiller d'herbe, le voyage poétique, natsume sôseki, philippe picquier, roman, haiku, peinture, poésie, méditation, impassibilité, ironie, marche, printemps, un mois au japon





