24/04/2019
Le pèlerin de Shikoku de Thierry Pacquier
 Sous-titré "Un chemin d'éveil au Japon", ce récit de voyage retrace le pèlerinage (vous ne l'aviez pas vu venir hein?) de Thierry Pacquier sur Shikoku, l'île des 88 temples.
Sous-titré "Un chemin d'éveil au Japon", ce récit de voyage retrace le pèlerinage (vous ne l'aviez pas vu venir hein?) de Thierry Pacquier sur Shikoku, l'île des 88 temples.
Taneda Santoka* disait : "Je ne suis rien d'autre qu'un moine mendiant, on ne peut pas dire grand-chose de moi, sinon que je suis un pèlerin fou qui passe sa vie entière à déambuler, comme ces plantes aquatiques qui dérivent de berge en berge. Cela peut paraître pitoyable, pourtant je trouve la paix dans cette vie dépouillée et misérable."
Pour resituer dans le contexte si, comme moi, vous n'êtes pas incollable en géographie, Shikoku est la plus petite des quatre îles de l'archipel japonais et se situe au sud de Honshū (la grande île) et à l'est de Kyūshū (merci Google) (Pour les curieux, l'île la plus au nord est Hokkaido). Shikoku est particulièrement célèbre pour ce pèlerinage bouddhiste qui parcourt les 1200 km de sa circonférence en hommage à Kūkai dit Kōbō-Daishi, fondateur de l'école bouddhiste ésotérique Shingon.
Après avoir testé une portion du trajet quelques temps auparavant, Thierry Pacquier décide d'entreprendre l'intégralité du pèlerinage d'un seul coup, ce qu'on appelle toshiushi, durant une quarantaine de jours. Il en divise présentement le récit en quatre étapes, rythmées par les différentes préfectures de l'île et leur symbolique spirituelle. Ainsi, la préfecture de Tokushima par laquelle le voyage commence incarne-t-elle le chemin de l'éveil et ainsi de suite jusqu'au Nirvana. La cinquième partie est la fin du voyage, ce moment où Thierry Pacquier dépose son bâton de pèlerin, le kongozue, pour de nouvelles aventures - qui le ramèneront toutefois à Shikoku plus tard avec sa femme (et la boucle est bouclée) - mais ceci est une autre histoire.
Un certain matin, on se met en marche. Au sens propre.
Exactement comme Thierry Pacquier, en abordant ce livre, je me suis mise en mouvement - dans ma tête seulement - mais c'est l'intention qui compte. Je lis peu de récits de voyage, honnêtement. Je ne sais même pas combien j'en ai déjà chroniqués (verdict : peu. Vous pouvez aller voir ça en cliquant sur la catégorie dévolue) et, de toutes façons, le dernier date de plusieurs années. J'aborde cette littérature lorsque je suis dans un état d'esprit particulier et lorsque j'ai besoin, au contact du narrateur, de cheminer moi aussi. Les premières pages du texte de Pacquier m'ont donc enchantée et apporté exactement ce qu'il me fallait à l'instant T : cette philosophie simple qui consiste à aller pas à pas. Ce fut également l'occasion pour moi de découvrir succinctement cette frange ésotérique du bouddhisme japonais fondée par Kūkai qu'il me tarde de creuser à présent.
Néanmoins, à part cela et quelques autres réflexions qui, sans être follement novatrices, sont pertinentes et énoncées avec un humour de bon aloi, l'ensemble n'est pas d'une consistance littéraire suffisante pour m'enthousiasmer complètement. C'est d'ailleurs symptomatique que la plus longue citation que je vous livre dans ce billet soit, non de Pacquier, mais de Taneda Santoka qu'il cite à plusieurs reprises. On n'est clairement pas chez Nicolas Bouvier, soyons francs là-dessus. En gros et pour résumer, c'est quand même assez souvent anecdotique et pas toujours très passionnant. Il faut donc le prendre pour ce que c'est : le récit d'une expérience honnête qui rend compte de bien des aspects du pèlerinage de Shikoku, de la fatigue du chemin au plaisir des onsen, bains japonais dont raffole le pèlerin éreinté, en passant par la réservation des nuitées au fil des jours. L'aspect spirituel est assez peu présent finalement, et assez basique. N'attendez pas un livre de fou.
Par conséquent, si j'ai apprécié la sincérité et la simplicité de Thierry Pacquier, je reste clairement sur ma faim. Reste à voir ce que je vais trouver d'autre à présent, de plus consistant et de plus qualitatif à tous points de vue. Peut-être bien Nicolas Bouvier, tiens. Ces magnifiques carnets japonais me font des œillades indécentes.
Le présent, rien que le présent, le reste n'est qu'hypothèse et élucubrations.
*Thierry Pacquier remercie en fin d'ouvrage Hubert Haddad pour son sublime Mā qui lui a fait découvrir l'oeuvre de Santoka. Ça l'a tellement inspiré qu'il jalonne son récit des haïkus du poète errant. Comme j'ai adoré également ce roman de Haddad, je ne résiste pas à vous renvoyer à mon billet pour vous le faire découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà.
16:28 Publié dans Challenge, Littérature française et francophone, Nature Writing/Récit de voyage | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : thierry pacquier, le pèlerin de shikoku, japon, pèlerinage, récit de voyage, transboréal, mois japonais
01/04/2019
Ali si on veut de Ben Arès et Antoine Wauters
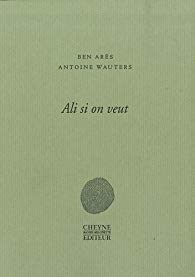 Je ne suis pas sans savoir qu'une journée sera consacrée à Antoine Wauters en cet auguste nouveau mois belge - le 9, pour les curieux de ce rendez-vous qui promet - mais j'ai tout de même décidé de prendre un peu d'avance et d'ouvrir le bal avec lui - entre autres - aujourd'hui.
Je ne suis pas sans savoir qu'une journée sera consacrée à Antoine Wauters en cet auguste nouveau mois belge - le 9, pour les curieux de ce rendez-vous qui promet - mais j'ai tout de même décidé de prendre un peu d'avance et d'ouvrir le bal avec lui - entre autres - aujourd'hui.
Ali si on veut, paru en 2010 chez Cheyne, est coécrit avec Ben Arès - également poète et également belge (hop, coup double) - et force est de constater que ça passe tout seul. La cohérence stylistique est impeccable et préserve en même temps la patte poétique des deux auteurs. Sacré tour de force. Bravo, messieurs.
Ne sait plus qui, ni quoi, ne scrute, ne cherche plus. De babil à babil, en toute cécité. Sans propriétés fixes, Ali, sans valeurs de soi fichées en terre, figées en dur mais les cycles; les mouvances en son sein, qui affleurent, les fondations de l'obscur, du poème.
Où l'on plonge dans un récit d'apprentissage - parti pris si audacieux en poésie que je me demande si je n'ai pas fumé la moquette. Toi, lecteur d'Ali si on veut, si tu passes par là : donne m'en ton avis. On suit ce jeune garçon, Ali donc, dans une région qui pourrait être chaude, territoire à part : jardin d'Eden, luxuriance originelle du fleurissement de l'être où grouillent mouches, fourmis et poissons (d'avril) ; on évolue avec lui dans la découverte et l'apprentissage des sens et de la sensualité, des éléments et de la femme ; et, doucement, il passe de l'enfance à la chair.
Le texte est incroyablement concis. En bonne gourmande, j'aurais sans doute aimé en lire plus - et pourtant j'aime d'ordinaire la forme courte, surtout lorsqu'elle est poétique. L'extrême brièveté - cinquante-sept pages - rend l'ensemble un poil trop nébuleux. Entendons-nous bien, je chipote ici car c'est, en tant que tel, un texte poétique d'une grande richesse et d'un intérêt plus que certain. Il est néanmoins jeune dans la production poétique de Wauters et c'est assez sensible. Il y aura, dans Césarine de nuit ou Sylvia, une direction beaucoup plus aboutie qui peine encore ici à se trouver - associée, sans doute, à la difficulté de l'écriture à quatre mains. Du bon, donc - je n'ai décidément jamais été déçue par Wauters dans ce genre-là - mais pas le meilleur texte poétique de sa production. Je me garderais bien d'en dire quoique ce soit au regard de l'oeuvre de Ben Arès, n'en étant pas grande connaisseuse (mais j'espère bien remédier à cela - ça m'a donné le goût d'en lire plus).
Sur ce, j'attends vos billets du 9 avril pour m'inciter enfin à découvrir la production romanesque de Wauters. Il serait plus que temps que je m'y frotte !
À la recherche de tout ce lait perdu, le ventre battu par les sentiers, au cuir la terre brûlée, aux lézards, makis entre les lunes, à celle qui porte, se décarcasse, aux progénitures dévouée, secrets qu’on n’ébruite pas, à l’aplomb, fêlures gardées, Ali si on veut.
*
Sensible aux pouls, aux chocs, ressorts des salives. Et ses mains, ses longs doigts fouisseurs, et sa chemise à pans pour taillader la terre, pleurer des pourpres et de petites lamelles de chaux. Et ses yeux, des insectes, deux jeunes taons de voltige, deux mouches pour perdre pied.
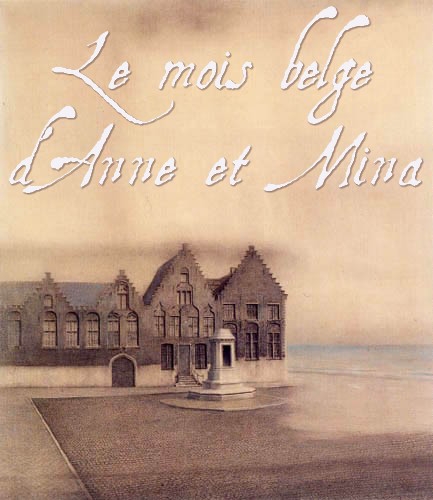
Le rendez-vous poétique de Marilyne
09:14 Publié dans Challenge, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : ali si on veut, ben arès, antoine wauters, mois belge, mois belge 2019, poésie, rendez-vous poétique, récit d'apprentissage, poésie en prose
15/03/2019
Les voyageurs de l'impériale de Louis Aragon
 Avec Aragon et son cycle du Monde Réel, les romans se suivent et ne se ressemblent pas. Non : ils se bonifient comme le bon vin. Pour moi, tout a commencé l'an dernier avec les très politiques Cloches de Bâle qui m'ont fait patiner copieusement sur une bonne centaine de pages avant de prendre leur élan grâce à Catherine Simonidzé et une direction un peu plus claire. C'était compliqué mais tellement riche qu'évidemment, j'ai enchaîné avec Les beaux quartiers en septembre, plus limpide, où le politique flirte avec le roman d'apprentissage parisien - Nathalie rappelle à ce sujet la parenté balzacienne de ce roman et elle a bien raison - et où la langue follement libre d'Aragon m'a enchantée.
Avec Aragon et son cycle du Monde Réel, les romans se suivent et ne se ressemblent pas. Non : ils se bonifient comme le bon vin. Pour moi, tout a commencé l'an dernier avec les très politiques Cloches de Bâle qui m'ont fait patiner copieusement sur une bonne centaine de pages avant de prendre leur élan grâce à Catherine Simonidzé et une direction un peu plus claire. C'était compliqué mais tellement riche qu'évidemment, j'ai enchaîné avec Les beaux quartiers en septembre, plus limpide, où le politique flirte avec le roman d'apprentissage parisien - Nathalie rappelle à ce sujet la parenté balzacienne de ce roman et elle a bien raison - et où la langue follement libre d'Aragon m'a enchantée.
"Et puis, pourquoi se casser la tête ? Qu'attend-on de la vie sinon un peu de musique ? N'est-ce pas, Meyer ?"
Alors à quelle sauce est-on mangé dans Les voyageurs de l'impériale ? De 1889 à 1918, Aragon livre la trentaine d'années (ou presque) d'un seul homme, Pierre Mercadier, soleil d'un système qui flanche - cette fin de siècle où tout bascule, à commencer par les certitudes de notre antihéros. Pierre est issu d'une famille bourgeoise tout à fait aisée. Élevé dans la nécessité de la sécurité, et un peu par goût de participer à l'éducation de sa patrie aussi, il se fait professeur d'Histoire au lycée. Mariée à une nobliaute désargentée mais très imbue de cette condition d'un autre temps - là encore, le pouvoir de l'éducation, il s'ennuie : Paulette est superficielle, frivole et pétrie d'idées arrêtées. Il ne faut pas très longtemps à Pierre pour s'en désintéresser cordialement, puis pour haïr la prison que ce mariage représente. Cette décrépitude du couple, entamée sous le regard monstrueux de la Tour Eiffel qui sonne le glas d'un siècle grandiose, devient une complète Béréniza à l'été 1897 lors d'un séjour familial à Sainteville chez l'oncle de Paulette. Pierre y vit une brève liaison qui réveille le démon de midi tandis que son fils Pascal s'ouvre à la nature et à l'amour. L'un s'enflamme, non d'amour mais d'aigreur, et étouffe tandis que l'autre, le rejeton, découvre tout l'univers des sens. Ils font, l'un et l'autre, l'apprentissage d'une liberté très différente, de plus en plus rageuse et cynique chez notre protagoniste.
Il y a ruine si on regarde derrière soi. Toujours, quoi qu'on fasse. Il y a ruine dans le substance des choses, dans ce qu'on n'a pas osé détruire. Il y a ruine dans le décor de carton-pâte derrière lequel rien ne se cache, rien. Et auquel il aurait fallu foutre le feu. Ah, que ça flambe !
Il eut tout d'un coup conscience de lui-même dans l'avenir, menant une vie médiocre, une vie dérisoire. Mais seul. Si admirablement seul.
*
- Ça fait Baudelaire ce que vous me racontez là : Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent... Je ne suis pas voyageur, je suis un type qui ne veut pas faire semblant de penser blanc quand il a la tête au noir... C'est tout. Partir pour partir, entre nous, c'est parler pour ne rien dire... Il y a aussi un autre poète qui a dit : ... Fuir là-bas, fuir ! / Je sais que des oiseaux sont ivres / D'être parmi l'écume inconnue et les cieux... Seulement celui-ci, il est professeur d'anglais, et il continue à faire sa classe. Tenez, j'ai un ami... enfin une relation... un peintre... Il faisait des tableaux bretons, et puis il a eu des désillusions... Ça ne marchait pas très bien matériellement... Il est parti pour Tahiti. Loin de la civilisation, de l'époque et de ses laideurs ! Bon. Il m'a écrit. Il ne parle que du gendarme. Il ne fait plus de tableaux bretons, mais il fait des tableaux tahitiens... C'est comme les ministères : on les renverse, puis on reprend les mêmes et on recommence...
*
Ainsi, tout était fini, tout allait se détacher, se libérer, le monde allait partir à la dérive.
Cet été-là change radicalement Pierre Mercadier. Jusqu'ici, précautionneux, organisé, raisonné, son seul travers était de jouer en Bourse, ce qu'il appelait tromper Paulette - et encore, ne s'autorisait-il à miser qu'en accord avec les intérêts du pays. Plus rien de tout ça n'a cours chez lui après 1897. Evidemment, cela couvait depuis longtemps mais voilà que la cocotte explose pour de bon. Il n'y a plus que deux réalités tangibles : l'individu et l'argent. En accord avec ses nouvelles prises de conscience, et de façon éhontément égoïste, Pierre prend ses clics et ses clacs et abandonne tout le monde sans l'ombre d'un remord - comme l'a fait le grand-père de l'auteur dont il s'inspire fort pour ce personnage. S'en suit une parenthèse oisive et pathétique à Venise, à Vérone puis à Monte-Carlo où il rencontre Reine de Brécy qu'il quitte elle aussi, encore. Pierre ne croit plus en la nature humaine. Il est profondément désabusé.
Accoudé au mur crénelé de Vérone, il pense qu si le héros véritable de l'ancienne liberté était le condottiere, le héros d'aujourd'hui, dans le monde de l'industrie, du crédit et du papier-monnaie, c'est après tout l'homme à l'identité fuyante, qui glisse entre les mailles de la loi, ne s'embarrasse d'aucune des sottises de convention, sans place assignée ici ou là, maître de son destin, défiant les limites fixées à son existence, et dont l'histoire est faite de cent romans, de cent désastres...
*
On liquidait le vieux siècle et ses luttes périmées, on ouvrait le nouveau sur une parade publicitaire, l'Exposition Universelle qui nécessitait la confiance, on relançait la République avec ses filiales à chicotes, comme une affaire où l'assassin et la victime se pardonnaient mutuellement dans l'idylle des temps nouveaux, où ne comptait plus, enfin, que le profit, la grande loi de l'histoire.
A cet instant précis - on a dépassé la moitié du roman, on a compris deux choses importantes : Ce roman est d'une noirceur implacable et refuser la politique, comme le clame haut et fort Mercadier, c'est en faire encore un peu quand même, en contrastes et ombres chinoises. Ici, il est question d'une tentative de s'évincer de la société. De ne plus prendre part à cette marche dérisoire qui avale les individus pour en faire une masse informe régie par l'argent. Pierre Mercadier a tenté de sauter de l'impériale - sauf que c'est impossible. L'entreprise de Mercadier, peut-être par trop d'égoïsme, de froideur, de cynisme et de mépris de tout, est vouée à l'échec. Pierre Mercadier n'est pas l'idéaliste d'une société nouvelle. Il est celui qui fiche tout par terre pour ne rien recréer. Sa démarche, tôt ou tard, aboutira au néant parce qu'elle est stérile. Et de fait, quinze ans après sa fuite, tandis qu'on a forgé de lui une légende grotesque qui n'est pas sans rappeler celle de Rimbaud avec une ironie bien mordante, il réapparaît à Paris, vieilli prématurément et sans le sou. En bout de course. Il n'a pas d'autres choix que de reprendre une vie de professeur, aux crochets de son ancien collègue Meyer qu'il prend en horreur pour cela, et devient habitué d'un bordel où il ne fait que papoter avec le maquerelle. Elle, Dora Tavernier, développe un amour pur et passionnel pour ce M. Pierre qu'elle idéalise tandis qu'il n'est là que pour faire barrage à sa peur de la mort - c'est dans le même esprit qu'il va, le dimanche, observer son petit-fils Jeannot au parc. Evidemment, ça ne saurait durer. On est au seuil de la Première Guerre Mondiale et bientôt la politique va rattraper tout le monde, y compris ceux qui se pensaient en marge, pour tout engloutir sans distinction.
- Croyez-vous ? la grande majorité des hommes se fichent de l'histoire comme de leur première culotte. La frousse passée, on joue à la manille et tout est comme toujours, à la va-comme-je-te-pousse...
Lire ce roman aujourd'hui, c'est se faire doublement fouetter le museau. D'abord parce qu'on sait qu'il a été écrit en pleine Seconde Guerre Mondiale, et sachant cela, l'entièreté du roman est une forme de procès de l'individualisme de Mercadier et les dernières pages apparaissent d'une ironie cinglante. En même temps, Aragon n'apporte aucune solution. Ici, il n'y a pas de porte de sortie politique comme pour Catherine ou Victor dans Les cloches de Bâle ou pour Armand dans Les beaux quartiers. Là, rien. C'est noir. Aucune foi en rien ne se dessine. Mais ensuite, on réalise qu'on est présentement cent ans après et que ce n'est pas beaucoup plus joli. On oscille perpétuellement encore entre le communautarisme le plus sectaire et l'individualisme le plus chevronné. Voilà. Statu quo. On aimerait croire qu'un repli à la Mercadier est possible pour se soustraire à tout ça mais voilà qu'Aragon nous en démontre la stérilité. Bref : on est dans de beaux draps.
Outre cet aspect extrêmement sombre et, disons-le, lucide de l'existence, Aragon, comme toujours, se surpasse littérairement. Sans tomber jamais dans un genre littéraire ou un autre, il délivre, à coup de discours variés, et quel génie lorsqu'il s'agit de manier l'indirect libre d'ailleurs, un roman multifacettes de fifou grâce aux nombreux satellites de la planète Mercadier. Son fils Pascal vit un véritable apprentissage bucolique à Sainteville qui occasionne des pages sublimes sur la nature, les jeux et l'enfance. Plus tardivement, dans la dernière partie, alors qu'il est patron d'une pension de famille, on le retrouve en petit Don Juan sans envergure, à l'affût des femmes qui veulent de lui et on s'aperçoit qu'il a finalement quelque chose de la froideur et de l'égoïsme de son père. Quant aux femmes, les trois figures qui accompagnent Pierre sur son parcours révèlent tour à tour un monde à bout de souffle : Paulette incarne la bourgeoise qui ne se résout pas à la mort de sa caste et qui s'échine à garder des convenances obsolètes ; Reine veut être libre quoiqu'il en coûte, quitte à s'engager sur des terrains glissants ; et Dora est l'espoir ridicule, tragique, qui se transforme en fantasme impossible. Que Dora est pathétique et touchante ! Les pages qui lui sont consacrées sont d'une infinie beauté, parmi les plus vibrantes du roman.
Ce roman est une tragédie finalement. On sait très exactement comment tout va se dérouler. On le voit venir et la 4ème de couverture ne nous cache rien - ce qui explique que je ne vous ai rien caché non plus. Il n'y a rien à attendre en terme de dénouement : toute l'existence de la planète Mercadier et de son système solaire est vouée à s'abîmer dans le trou noir du vingtième siècle. Exactement comme dans les tragédies antiques, tout l'intérêt de ce roman ne réside donc pas dans le suspens haletant de connaître la fin mais dans le plaisir lucide de décortiquer tous les rouages qui mènent à l'acmé fatale. J'ai beaucoup parlé de noirceur, j'en conviens, et ce n'est peut-être pas très engageant pour beaucoup mais c'est pourtant un des gros points forts du roman au contraire : son absence de concession et son absence d'idéalisme. Chaque page est une gifle assénée au lecteur. C'est sûr, il faut avoir envie de ça lorsqu'on attaque le roman - je vous rassure, les découvertes de Pascal à Sainteville offrent tout de même une jolie parenthèse enchantée - mais si la littérature ne nous fouette pas un peu à l'occasion, qui aura le cran de le faire ? Finalement, je me plaignais en début de mois d'une lecture feel good un peu trop fade à mon goût ; je crois que j'ai déniché là son parfait contraire. J'ai bien fait de les enchaîner : j'ai ainsi vécu l'équivalent littéraire du bain nordique. Ça ravigote les neurones !
Nous nous attristons du malheur des grands hommes comme de l'effet injuste d'une fatalité à leur taille. Est-ce qu'il y a dans la vie un seul roman heureux? Est-ce que chaque vie humaine, la plus humble, ne se termine pas de façon tragique? Le rocher de Napoléon n'est rien d'autre que l'alcôve où se termine toute aventure, et tous les lits des maisons de Paris ont été les témoins d'agonies qui valent Ugolin, le Chevalier de la Barre ou Maximilien.
C'est vers cette issue horrible de la vie que nous sommes tous portés, inconscients du mouvement qui l'anime, du mécanisme de la locomotion, par un immense omnibus lui-même destiné aux catastrophes. Je me souviens d'avoir un soir traversé Paris aux premières lumières sur l'un de ces véhicules cahotants, pareil à une baleine qui glisse sur les ombres naissantes. C'était un soir que je me sentais inquiet et triste, la tête bourrée des chiffres dont dépendait ma liberté, des cours de la Bourse et des noms d'actions et de titres, comme une pauvre cervelle dépossédée qu'habitent les monstres du calcul. Tout d'un coup tout me sembla étrange, les cafés, les boulevards, les pharmacies. Je me mis à regarder mes voisins de l'impériale non plus comme des compagnons de hasard, qui s'égailleraient aux stations successives, mais comme les voyageurs mystérieusement choisis pour traverser avec moi l'existence. Je me mis à remarquer que déjà, sur un parcours bref, des liens s'étaient formés entre nous, le sourire d'une femme, le regard appuyé d'un homme, deux vieillards qui avaient lié conversation: une ébauche ds société. Et je pensais avec une espèce d'horreur que nous étions, nous à l'instant encore des étrangers, également menacés par un accident possible. De telle sorte que ce qui se passait en bas, entre les chevaux et la rue, et dont nous n'étions pas informés, risquait de créer entre nous une solidarité mortelle, et une intimité pire que l'intimité de l'amour, celle de la fosse commune. J'étais d'humeur à philosopher, parce que tout m'était amer. Je pensais que cette impériale était une bonne image de l'existence, ou plutôt l'omnibus tout entier. Car il y a deux sortes d'hommes dans le monde, ceux qui pareils aux gens de l'impériale sont emportés sans rien savoir de la machine qu'ils habitent, et les autres qui connaissent le mécanisme du monstre, qui jouent à y tripoter... Et jamais les premiers ne peuvent rien comprendre de ce que sont les seconds, parce que de l'impériale on ne peut que regarder les cafés, les réverbères et les étoiles; et je suis inguérissablement l'un d'eux, c'est pourquoi John Law qui inventa une façon d'affoler la machine restera toujours pour moi , malgré cette curiosité que je lui ai portée, un homme que je ne pourrai jamais me représenter dans les simples choses de la vie, flânant par exemple ou s'achetant des fruits chez l'épicier, ou jouant avec de petits enfants. Comme il est de toute vraisemblance qu'il fit, et ce n'est pas moins important à connaître de lui, que les opérations par lesquelles il créa la Compagnie des Indes. Voilà quarante années et plus que les miens et moi-même nous faisons vers une fin qui sera sans doute sinistre un chemin que je n'ai pas tracé, que personne n'a tracé. Peut-être pourrais-je m'expliquer l'étrange intérêt que j'ai porté à Law par cette croyance que j'ai qu'il a été l'un des rares hommes qui firent dévier le monde. Il n'était pas, lui, un voyageur de l'impériale...
Pour cette LC aragonaise, Nathalie a lu Les beaux quartiers
Et si toi aussi, tu as lu Aragon avec nous, manifeste-toi en commentaires pour que je recense ici ton billet !
11:19 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Histoire, Lecture commune, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : louis aragon, les voyageurs de l'impériale, cycle du monde réel, lecture commune, pierre mercadier, individualisme, politique, argent, famille, mariage, société, fin de siècle, début de siècle, guerre, amour, cynisme, liberté, lucidité





