27/09/2020
Little de David Treuer
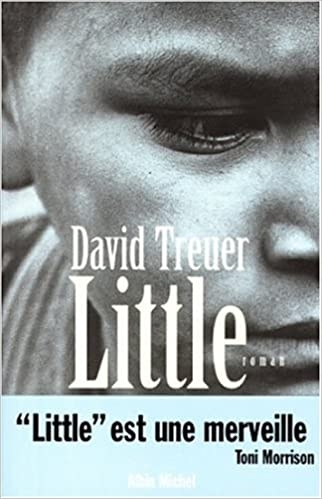 Ce roman choral, premier roman de David Treuer, développe la vie de plusieurs personnages entre le début du XXème siècle et 1980 dans une réserve indienne du Minnesota et plus précisément dans le lotissement bien nommé de Pauvreté. Le point de départ du récit est l'enterrement de Little dont on n'a pas retrouvé le corps, un garçon de huit ans qui ne parlait pas ou à peine - ce Toi jeté de façon brutale était son seul mot. Cette tombe vide résonne comme une absurdité douloureuse à l'esprit de tous. Chaque personnage tour à tour, en découvrant son passé et son présent, va tenter de redonner sens et corps à Little - non pas vie, car ce qui est mort ne peut être ressuscité mais ce sens et ce corps nécessaires pour que le deuil se fasse et pour que la vie de ceux qui restent continue. Ainsi, le roman se termine sur une éclosion - comme la métaphore d'un cycle éternel jusqu'ici enrayé de souffrances et que le pouvoir créatif de la langue, entre autres, permet de relancer parce qu'il aide à se rappeler, à comprendre, à transmettre, à aimer, à pardonner, à construire et à inventer aussi.
Ce roman choral, premier roman de David Treuer, développe la vie de plusieurs personnages entre le début du XXème siècle et 1980 dans une réserve indienne du Minnesota et plus précisément dans le lotissement bien nommé de Pauvreté. Le point de départ du récit est l'enterrement de Little dont on n'a pas retrouvé le corps, un garçon de huit ans qui ne parlait pas ou à peine - ce Toi jeté de façon brutale était son seul mot. Cette tombe vide résonne comme une absurdité douloureuse à l'esprit de tous. Chaque personnage tour à tour, en découvrant son passé et son présent, va tenter de redonner sens et corps à Little - non pas vie, car ce qui est mort ne peut être ressuscité mais ce sens et ce corps nécessaires pour que le deuil se fasse et pour que la vie de ceux qui restent continue. Ainsi, le roman se termine sur une éclosion - comme la métaphore d'un cycle éternel jusqu'ici enrayé de souffrances et que le pouvoir créatif de la langue, entre autres, permet de relancer parce qu'il aide à se rappeler, à comprendre, à transmettre, à aimer, à pardonner, à construire et à inventer aussi.
Dans les années qui ont suivi, nous avons tous, à Pauvreté, embelli nos histoires sur Little, nous leur avons donné des ailes et nous les avons laissées s'envoler. Et comme il y avait si peu à raconter, elles ont pris le départ, elles sont parties tout là-haut, en décrivant des cercles et, comme les pissenlits, elles n'ont jamais plus jamais touché terre.
Non seulement l'histoire mais plus largement le propos soutenu par une construction métaphorique intelligente et subtile sont très intéressants. Néanmoins, je me dois de reconnaître que je m'y suis fréquemment ennuyée. La langue en tant que telle ne m'a pas follement emballée et je pense malheureusement que ma lecture de ce texte, pourtant clairement précurseur dans son genre puisqu'il est paru en 1995 aux États-Unis intervient dans ma vie de lectrice après de nombreux autres textes construits peu ou prou de la même façon et sur le même sujet. Du coup, je n'ai pas eu le saisissement des découvertes et tout m'a semblé au contraire très transparent. Il n'en reste pas moins que c'est vraiment un très bon premier roman et que je continuerai évidemment à lire David Treuer. A ce sujet, si vous n'avez jamais lu Le manuscrit du docteur Apelle, je vous encourage à vous pencher dessus : il avait été, pour le coup, un vrai coup de cœur !

Le mois américain chez Titine
20:27 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : little, david treuer, mort, deuil, histoire, langue, guérison, réserve indienne, minnesota, pauvreté
16/02/2018
LaRose de Louise Erdrich
Une bombe vous faisait sauter en un instant ; recoller vos morceaux prenait le restant de vos jours.
A la toute fin des années 90, la partie de chasse qui marque l'arrivée de l'automne chez les Ojibwés tourne mal pour Landreaux Iron : Au lieu du cerf qu'il visait, c'est Dusty, le jeune fils d'un ami et de la demi-sœur de sa femme, qu'il tue. L'incompréhension fait place à la stupeur puis à la dévastation chez tous. Le vide d'une telle mort semble impossible à porter, impensable à combler. Lors d'une cérémonie, Landreaux choisit de respecter une tradition ancestrale : celle de donner son plus jeune fils aux parents en deuil. Ainsi, LaRose, ce petit bonhomme de cinq ans, ancien copain de jeu du défunt, se voit confier la mission tacite de guider chacun sur le chemin de la guérison.
Avant d'emmener LaRose chez les Ravich, l'automne précédent, Landreaux et Emmaline avaient prononcé son nom. Mirage. Ombanitemagad. C'était le nom que recevait chaque LaRose. Le premier nom de la fille de Vison. Il le protégerait de l'inconnnu, de ce que l'accident avait libéré. Il arrive que ce genre d'énergie - le chaos, la malchance - s'échappe dans le monde et ne cesse d'enfanter encore. La poisse s'arrête rarement après un seul événement. Tous les Indiens le savent. Y mettre fin rapidement exige de grands efforts, ce pourquoi LaRose avait été envoyé.
Il faut dire que LaRose s'inscrit dans une longue lignée de passeurs de mémoire animés d'un souffle de vie incroyable. Plus d'un siècle et demi plus tôt, la première LaRose avait déjà développé mille trésors de force et de résilience pour survivre d'abord, puis pour vivre tout à fait en harmonie avec ses ancêtres, ses racines Ojibwés et les arcanes d'un monde nouveau. De cette lutte-là naquit doucement l'amour et s'y tressèrent les fils puissants du métissage comme un élan vers l'avenir.
La nuit, elle s'envolait, traversait le plafond et s'élançait vers le ciel comme on le lui avait appris. Elle entreposa des parties de son être au sommet des arbres. Elle reviendrait les chercher plus tard, quand les cloches s'arrêteraient de sonner.
A travers la voix de LaRose, fils de Landreaux et Emmaline, ce sont ainsi tous les LaRose qui chantent et résonnent entre les lignes. Cette plongée nécessaire dans le passé et ses multiples échos au présent, projetés vers l'avenir comme une ramure de cerf, une sève millénaire ou une poussière d'étoiles impriment à la structure narrative cette circularité si caractéristique de l'écriture d'Erdrich - ce que d'aucuns pourraient trouver éclaté, décousu ou erratique mais ne l'est que pour notre esprit formaté à la linéarité.
Elle était archaïque et avait surgi de la terre en ébullition. Elle avait sommeillé, mené une vie latente dans la poussière, s'était élevé en fin brouillard.
Il y a, indéniablement, dans ce dernier roman de l'auteure, un équilibre précaire c'est-à-dire parfait entre la profonde noirceur du drame et du poids des ans, impeccable de douleur sourde et une lumière incroyable, miroitante, ténue mais persistante. Louise Erdrich, comme toujours, délivre subtilement par la fiction la réalité d'une blessure jamais refermée, qui envenime toutes les autres, et son nécessaire mouvement de guérison : tisser la toile des résonances multiples entre tous les âges. Puis récréer.
Le cerf savait, songea Landreaux. Evidemment qu'il savait. Landreaux l'avait observé, parfois armé de son fusil, parfois non. Très souvent, il avait vu qu'à son tour le cerf l'observait. Il s'arrêtait, sentant le regard de l'animal posé à l'arrière de son crâne, et lorsqu'il se retournait il était là, immobile, les yeux profonds et liquides. S'il avait écouté, ou compris, ou encore s'il s'était soucié de savoir ce qu'il comprenait, jamais il ne l'aurait chassé. Jamais. il aurait su que le cerf cherchait à lui communiquer une information de la plus haute importance. Ce n'était pas un être ordinaire, mais un pont vers un autre monde.
Bien que je n'aie pas goûté ce titre-là avec le même plaisir délicieux que beaucoup des précédents - je lui reproche notamment des facilités de style qui m'ont déplu et quelques longueurs trop anecdotiques à mon goût, je dois pourtant reconnaître que j'en garde un éclat particulier quelque part dans la mémoire. LaRose, ce personnage protéiforme aux cinq visages, incarnation de bien des excès, de la douceur, de l'ingéniosité, de la candeur et de la vitalité tout à la fois, est de ceux qui marquent, qui trottinent encore longtemps dans la tête, et dont on se dit "Que ferait-il à ma place ?" pour trouver la juste voie. Alors, malgré les défauts, je dois bien avouer que c'est là le signe indéniable qu'on a à faire à un bon cru.
Romans précédemment lus et chroniqués de l'auteure :
Le pique-nique des orphelins, Dans le silence du vent, Ce qui a dévoré nos coeurs (dont j'ai honteusement méjugé alors la première partie qui est, en fait, une mine d'or), Derniers rapports sur les miracles à Little No Horse, Love medicine.
10:46 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : larose, louise erdrich, littérature amérindienne, rentrée littéraire 2018, rentrée hiver 2018, meurtre, décès, deuil, passé, avenir, résilience, guérison, dakota du nord, amérindiens, ojibwés
11/11/2017
Cris de Laurent Gaudé
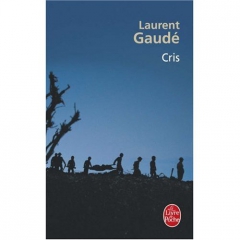
Cris de Laurent Gaudé, Le livre de poche, 2005[2001], 181p.
Je me demande bien quel visage a le monstre qui est là-haut qui se fait appeler Dieu, et combien de doigts il a à chaque main pour pouvoir compter autant de morts.
Quelques soldats au quotidien dans l'enfer des tranchées, un gazé qui agonise déjà oublié de tous, un sauvageon mi-homme mi-bête qui terrorise les vivants et les morts, un jeune homme en permission en partance pour Paris: en somme, rien que de très attendu pour un roman sur la Première Guerre Mondiale.
Il faut pourtant ajouter à cela, qui est évidemment vrai et vous résume - de manière bien superficielle - le propos de Cris, qu'il s'agit du premier roman de Laurent Gaudé. Par conséquent, au-delà d'un récit factuel, d'une peinture plus vraie que nature, il serait plus juste de dire qu'il donne voix, qu'il donne cris à ses personnages qui prennent la parole en de fulgurants monologues comme autant de chants païens poussés à la face d'un monde en déliquescence. Enfermés dans leur corps presque-déjà-mort, s'attachant sauvagement à ce qu'il leur reste de vie, de souffle, de hargne, ils forment tous une communauté étonnamment soudée au-delà des mots impossibles. Ils se rejoignent tous d'une manière ou d'une autre. La plongée que propose Gaudé dans ces intériorités coupées de tous, profondément torturées, démentes, humaines, est sans doute une des plus intéressantes manières de nous donner à ressentir une expérience aussi limite et indicible que celle de la guerre. Il faut accepter du coup, d'aller d'un personnage à l'autre en des phrases courtes, lapidaires, parfois averbales. Bien que le style puisse dérouter, il participe à la nécessaire aridité du propos.
Et puis, sorti des tranchées, il y a Jules, qui ouvre et ferme systématiquement les cinq parties de ce roman comme autant d'actes tragiques. Jules, celui qui s'en va pour mieux revenir, qui connaît l’ambiguïté de sentiments qu'implique une permission : joie, angoisse, dégoût, plaisir, indifférence, rejet. Jules, à mesure du récit, se sent habité d'un devoir de transmission. Cette permission doit permettre de dire, de faire comprendre la guerre. Il tentera le discours frontal et essuiera un cuisant échec. Puis il tentera la voie de l'art. Dans tout ce cauchemar, c'est l'art qui purge, lave, apprend, transcende. Mine de rien, on en revient au théâtre cathartique. Ou, plus justement, on atteint ici le talent de Laurent Gaudé, qui ne s'est pas démenti depuis, de créer un pont subtil et passionnant entre l'art du roman et celui du théâtre.
Je cours maintenant. Je sais où je vais. J’ai compris ce que voulait le gazé. Je voudrais lui dire qu’il peut se rassurer. J’ai enfin compris ce qu’ils veulent, tous ceux qui me parlent à voix basse. Je vais me mettre à l’œuvre. [...]
Tous les carrefours. Toutes les places. Le long des routes. À l’entrée des villages. Partout. Je ferai naître des statues immobiles. Elles montreront leurs silhouettes décharnées. Le dos voûté. Les mains nouées. Ouvrant de grands yeux sur le monde qu’elles quittent. Pleurant de toute leur bouche leurs années de vie et leurs souvenirs passés. Je ne parlerai plus. La pluie de pierres m’a fait taire à jamais. Mais un à un, je vais modeler cette colonne d’ombres. Je les disperse dans les campagnes. C’est mon armée. L’armée qui revient du front et demande où est la vie passée. Je ne parlerai plus. Je vais travailler. J’ai des routes entières à peupler. À chaque statue que je finis, la voix qui me hante se tait. Ils savent maintenant que je suis les mains de la terre et qu’ils ne mourront pas sans que je leur donne un visage. Ils savent maintenant qu’ils n’ont pas besoin de cri pour être entendus. Une à une les voix s’apaisent. Mais il en revient toujours. C’est une vague immense que rien ne peut endiguer. Je leur ferai à tous une stèle vagabonde. Je donne vie, un par un, à un peuple pétrifié. J’offre aux regards ces visages de cratère et ces corps tailladés. Les hommes découvrent au coin des rues ces grands amas venus d’une terre où l’on meurt. Ils déposent à leur pied des couronnes de fleurs ou des larmes de pitié. Et mes frères des tranchées savent qu’il est ici des statues qui fixent le monde de toute leur douleur. Bouche bée.
19:56 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : première guerre mondiale, tranchées, voix, cris, laurent gaudé, roman, théâtre, monologue, transmission, guérison, art





