06/05/2019
Les femmes de Heart Spring Mountain de Robin MacArthur
"Combien d'années on peut tenir sans joie, avant que tout ce bordel se casse la figure ?" demandait Bonnie des années plus tôt [...].
Lorsqu'Irene s'abat sur le Vermont le 28 août 2011, Bonnie se fait un shoot d'héroïne et part déambuler dans les rues de sa ville ravagée par l'ouragan. Elle est en plein trip, s'avance vers les eaux en crue de la Silver Creek et disparaît. Sa fille Vale, à plusieurs kilomètres de là depuis huit ans pour mettre à distance cette relation douloureuse à la mère, prend immédiatement le chemin de Heart Spring Mountain, le fief familial, cette montagne où naît la Silver Creek et où ses ancêtres se sont installés depuis des générations. S'y retrouvent à présent trois existences de femmes pleines de failles et d'étincelles : Hazel, la grande tante antédiluvienne qui commence doucement à perdre la tête et à mélanger les époques ; Deb, la tante par alliance qui a autant aimé ce coin de montagne que Stephen, le fils d'Hazel ; et Vale, en plein tourment. A travers elles, et à travers chaque parcelle de cette nature puissante, résonne aussi la voix de Lena, la grand-mère de Vale, la tante de Stephen et la sœur d'Hazel, morte en couches peu après la naissance de Bonnie. En recherchant sa mère, Vale part en même temps à la recherche d'elle-même, de ses racines longtemps mises à l'écart et qui sont pourtant, souvent, le remède pour aller de l'avant.
C'est le leitmotiv de la souffrance qui les réunit. Et pourtant, Vale : Deb voit des lueurs d'espoir dans sa présence. Vale qui éclaircit les mystères du passé, qui détricote une histoire révisionniste où l'amour existait là aussi.
Franchement, je n'avais formulé aucune attente à propos de ce roman malgré -ou peut-être à cause - de son matraquage sur les réseaux sociaux. C'aurait même eu tendance à me refroidir - mais voilà qu'il m'a appelée un beau jour tandis que je passais dans une librairie et je n'ai pas tergiversé. Ça m'arrive extrêmement rarement de céder ainsi à l'appel d'un grand format et encore plus rarement de l'entamer immédiatement dans la foulée, ça méritait donc d'être souligné. Et j'ai furieusement bien fait.
Objectivement, ces existences de femmes n'ont rien de follement extraordinaires : elles se débattent, chacune, avec un passé tortueux, des doutes présents et un avenir incertain, des sentiments souvent mêlés et ce feu intérieur qui réchauffe autant qu'il brûle. Autour d'elles gravitent nombres d'hommes aux mêmes mille facettes compliquées mais toujours bienveillants. Robin MacArthur crée ici des personnages banals c'est-à-dire vibrants, des monsieur-et madame-tout-le-monde qui ont cette force et cette épaisseur furieuse de vivre quoiqu'il en coûte. Et c'est là que le pari de ce premier roman réussit : on est complètement embarqué dans ces voix et ces époques qui se croisent pour remettre en ordre le puzzle familial parce qu'elles sonnent vraies et sont très attachantes - à défaut d'être extrêmement fouillées ou étonnamment originales.
Il y a d'autres empreintes, qu'elle n'identifie pas. De martre ? De renard ? Celles d'animaux qui s'éveillent avec le jour et viennent s'abreuver. Dans ce proche avenir apocalyptique, se dit-elle, je serai comme eux : regard aux aguets, oreilles dressées, tournant la tête en tous sens. Réfugiée près de ces marécages fertiles ; réapprenant toutes ces choses oubliées.
Le récit se lit d'un souffle, aimantés que nous sommes à ces personnages amis et ce n'est pas sans regret que je les ai quittés, un peu plus apaisés sans doute ou du moins sur le chemin de l'être. C'est ce qui me console d'avoir tourné la dernière page, sans vraiment leur avoir dit au revoir car ils m'accompagnent encore un peu en rédigeant cette chronique. Je pourrais aussi souligner, pour être tout à fait franche, qu'il m'a semblé sentir dans le style de Robin MacArthur la jeunesse de son entreprise romanesque. Certains tics d'écriture sont presque palpables tant ils se retrouvent souvent (les phrases nominales, les subordonnées relatives, l'usage des deux points...). Mais enfin, il faut que jeunesse se fasse et je crois que, de plus en plus, j'apprécie lire que la verve romanesque, cette capacité à donner vie à des êtres et des existences de mots et de papier, est décidément aussi vivace. Tant qu'il y aura de la fiction, il y aura de l'espoir.
"Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir", récite la jeune femme, les larmes aux yeux. Puis elle s'adresse à eux : "Et vous, mes salauds, quelle sera votre mission ?"
Par ici, les billets de Marie-Claude et d'Electra que j'ai découverts après avoir commencé la lecture du roman et qui sont en parfaite résonance avec mon sentiment.
07:39 Publié dans Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : les femmes de heart spring mountain, robin macarthur, albin michel, roman américain, usa, états-unis, voix, destins, passé, famille, racines, amour, filiation, réconciliation, vermont, ouragan, mère, fille, premier roman
11/11/2017
Cris de Laurent Gaudé
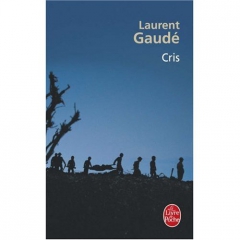
Cris de Laurent Gaudé, Le livre de poche, 2005[2001], 181p.
Je me demande bien quel visage a le monstre qui est là-haut qui se fait appeler Dieu, et combien de doigts il a à chaque main pour pouvoir compter autant de morts.
Quelques soldats au quotidien dans l'enfer des tranchées, un gazé qui agonise déjà oublié de tous, un sauvageon mi-homme mi-bête qui terrorise les vivants et les morts, un jeune homme en permission en partance pour Paris: en somme, rien que de très attendu pour un roman sur la Première Guerre Mondiale.
Il faut pourtant ajouter à cela, qui est évidemment vrai et vous résume - de manière bien superficielle - le propos de Cris, qu'il s'agit du premier roman de Laurent Gaudé. Par conséquent, au-delà d'un récit factuel, d'une peinture plus vraie que nature, il serait plus juste de dire qu'il donne voix, qu'il donne cris à ses personnages qui prennent la parole en de fulgurants monologues comme autant de chants païens poussés à la face d'un monde en déliquescence. Enfermés dans leur corps presque-déjà-mort, s'attachant sauvagement à ce qu'il leur reste de vie, de souffle, de hargne, ils forment tous une communauté étonnamment soudée au-delà des mots impossibles. Ils se rejoignent tous d'une manière ou d'une autre. La plongée que propose Gaudé dans ces intériorités coupées de tous, profondément torturées, démentes, humaines, est sans doute une des plus intéressantes manières de nous donner à ressentir une expérience aussi limite et indicible que celle de la guerre. Il faut accepter du coup, d'aller d'un personnage à l'autre en des phrases courtes, lapidaires, parfois averbales. Bien que le style puisse dérouter, il participe à la nécessaire aridité du propos.
Et puis, sorti des tranchées, il y a Jules, qui ouvre et ferme systématiquement les cinq parties de ce roman comme autant d'actes tragiques. Jules, celui qui s'en va pour mieux revenir, qui connaît l’ambiguïté de sentiments qu'implique une permission : joie, angoisse, dégoût, plaisir, indifférence, rejet. Jules, à mesure du récit, se sent habité d'un devoir de transmission. Cette permission doit permettre de dire, de faire comprendre la guerre. Il tentera le discours frontal et essuiera un cuisant échec. Puis il tentera la voie de l'art. Dans tout ce cauchemar, c'est l'art qui purge, lave, apprend, transcende. Mine de rien, on en revient au théâtre cathartique. Ou, plus justement, on atteint ici le talent de Laurent Gaudé, qui ne s'est pas démenti depuis, de créer un pont subtil et passionnant entre l'art du roman et celui du théâtre.
Je cours maintenant. Je sais où je vais. J’ai compris ce que voulait le gazé. Je voudrais lui dire qu’il peut se rassurer. J’ai enfin compris ce qu’ils veulent, tous ceux qui me parlent à voix basse. Je vais me mettre à l’œuvre. [...]
Tous les carrefours. Toutes les places. Le long des routes. À l’entrée des villages. Partout. Je ferai naître des statues immobiles. Elles montreront leurs silhouettes décharnées. Le dos voûté. Les mains nouées. Ouvrant de grands yeux sur le monde qu’elles quittent. Pleurant de toute leur bouche leurs années de vie et leurs souvenirs passés. Je ne parlerai plus. La pluie de pierres m’a fait taire à jamais. Mais un à un, je vais modeler cette colonne d’ombres. Je les disperse dans les campagnes. C’est mon armée. L’armée qui revient du front et demande où est la vie passée. Je ne parlerai plus. Je vais travailler. J’ai des routes entières à peupler. À chaque statue que je finis, la voix qui me hante se tait. Ils savent maintenant que je suis les mains de la terre et qu’ils ne mourront pas sans que je leur donne un visage. Ils savent maintenant qu’ils n’ont pas besoin de cri pour être entendus. Une à une les voix s’apaisent. Mais il en revient toujours. C’est une vague immense que rien ne peut endiguer. Je leur ferai à tous une stèle vagabonde. Je donne vie, un par un, à un peuple pétrifié. J’offre aux regards ces visages de cratère et ces corps tailladés. Les hommes découvrent au coin des rues ces grands amas venus d’une terre où l’on meurt. Ils déposent à leur pied des couronnes de fleurs ou des larmes de pitié. Et mes frères des tranchées savent qu’il est ici des statues qui fixent le monde de toute leur douleur. Bouche bée.
19:56 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : première guerre mondiale, tranchées, voix, cris, laurent gaudé, roman, théâtre, monologue, transmission, guérison, art
13/04/2012
Body Art de Don Delillo

Body Art de Don Delillo, traduit de l'américain par Marianne Véron, Actes Sud, 2001/Babel, 2003, 126p.
Ce très court roman s'ouvre sur une longue scène d'un petit déjeuner banal entre Lauren Hartke, 36 ans et son mari Rey Robbles, 64 ans. Pas de quoi fouetter un chat, c'est même un peu long. Elle est artiste de body art, lui est cinéaste.
Puis apparait la notice nécrologique de Rey qui a choisi de mettre fin à ses jours ; Lauren se retrouve seule dans une grande maison vide, retirée et nue. Dans l'expérience à la fois cinglante et douce du deuil, elle découvre un être étrange, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs, dont la voix est celle de Rey, puis la sienne également mêlée. A travers cet homme semblent se rejouer les derniers mots du couple avant la mort et Lauren y puise une sorte de fascination libératrice.
Voilà un livre bien étonnant, difficilement descriptible, malgré une relecture. Plus qu'une histoire, il s'agit d'une expérience à laquelle j'associerais des mots comme nudité, dépouillement, étreinte, temps, corporalité, voix, lâcher-prise. Don Delillo expérimente la conscience de soi et du monde à travers la plongée dans un monde à la limite de l'absurde servi de mots tantôt fièvreux, tantôt secs et désenchantés. Loin d'apporter des éléments de réponses, ce livre, bien au contraire, pose question. Autant le dire très clairement, il pourra aussi prodigieusement ennuyer. Moi-même, je ne parviens pas à m'en faire une idée en terme de "plaisir" de lecture. Tout comme la première fois où je l'ai lu, j'ai simplement envie de fermer les yeux et de méditer - c'est signe, sans doute, qu'au-delà de la superficialité de l'agrément, il a fait résonner des cordes sensiblement plus profondes.
Pour conclure, quelques mots de l'auteur merveilleusement adaptés à son art - attribués dans l'ouvrage à une performance de Lauren Hartke :
"Son art, dans ce spectacle, est obscur, lent, difficile et parfois insoutenable Mais il ne s'agit jamais de l'agonie grandiose d'images et de décors imposants. Il s'agit de vous et de moi. Ce qui commence dans une altérité solitaire devient familier et même personnel. Il s'agit de qui nous sommes vraiment quand nous ne somme pas affairés à être qui nous sommes."
*
09:00 Publié dans Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : body art, art, corps, mort, deuil, présence, voix, nudité, dépouillement, oiseaux




