13/03/2015
L'Appât de José Carlos Somoza

L'Appât de José Carlos Somoza, Babel, 2014, 531p.
Dans un Madrid presque semblable au nôtre mais qui aurait subi un terrible attentat quelques années plus tôt, un fameux 9 novembre (vas-y lecteur, lis le jour et le mois à l'envers), la Police a maintenant recours à une arme révolutionnaire : les appâts. Il n'est plus question d'attendre que les criminels se manifestent pour les épingler, au risque de faire de nombreuses victimes au passage. Non. Maintenant, on va les chercher. Et quand je dis "on", je veux dire les appâts. Des hommes, des femmes et même des enfants, tous entraînés et conditionnés à chaque minute de leur vie pour percer à jour le plaisir des êtres et ainsi les manipuler. Cette méthode se base sur la découverte révolutionnaire des psynomes par Victor Gens. Tout comme nos caractéristiques physiques sont inscrites dans le génome, nos caractéristiques psychologiques, toutes déterminées par le désir, s'énoncent clairement par le psynome. Chacun vit, agit, réagit en fonction de son désir. Le libre-arbitre dans tout ça, et les sentiments ? Une expression du désir, tout simplement. Il existe évidemment autant de psynomes que d'êtres vivants. Néanmoins, beaucoup se recoupent par des caractéristiques communes, que l'on peut classer en grands groupes : les philias. Et c'est là qu'entrent en scène les appâts. Ces derniers sont capables d'identifier la philia de tout un chacun et d'agir en fonction pour posséder et soumettre. Voire pour tuer - d'un excès de plaisir qui confère à la folie. Au fond, les appâts sont des acteurs professionnels qui feignent tout et charment tous grâce au plus grand des dramaturges : William Shakespeare. En chacune de ses pièces, les ingrédients pour envoûter une philia, appelés "masques". Bienvenue dans la dystopie de Somoza où la vie est un théâtre.
Rentrons à présent dans le vif de l'intrigue. Diana Blanco est un des appâts les plus doués de la capitale espagnole. En bonne philique de Travail, elle fait preuve d'une pugnacité sans pareille lorsqu'il s'agit de traquer un psycho. Justement, Diana est assignée à celle du Spectateur, un des plus dangereux serial killer depuis des lustres - depuis Jack L’éventreur, en gros. Tandis qu'elle envisageait un temps un retrait de la profession par amour (mais encore une fois, cela existe-t-il vraiment dans ce monde étrange régit par le désir?), l'enlèvement de sa sœur par le Spectateur vient chambouler tous les plans et la pousse à tout tenter pour sauver sa seule famille.
Et bien, on ne va pas se mentir : ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un Somoza aussi malsain. Les univers de l'auteur sont toujours alambiqués et à la limite du tordu, soit, je commence à en avoir l'habitude, mais ce qui les caractérisent le plus, à mon sens, est leur complexité et l'érudition qui les sous-tend. Si cela est toujours vrai dans L'Appât, on ne peut nier qu'une noirceur glauque et gluante colle en outre à chaque page et crée une atmosphère dérangeante à souhait. Ce n'est pas tant la monstruosité des serial killers (oui, des. Mais je ne vous en dis pas plus car comme dirait River Song : Spoileeeeeers) qui l'installe - bien qu'ils y participent de tout leur soûl - mais cette idée du psynome, des philias et des appâts. Que sommes-nous, si tout est désir ? Que deviennent la Raison, la volonté, la capacité de choisir et d'aimer ? L'homme n'est pas même un animal ; il est un pantin. Un pantin, qui plus est, répertoriable comme un bon dossier. Tel pantin est philique d'Holocauste, tel autre d'Aura ou de Demande. Et dès lors, vous n'être plus seulement un pantin aux mains de votre désir mais aussi aux mains des appâts qui se serviront de vous comme d'un vulgaire accessoire de théâtre. Absolument tout est factice et manipulable. Franchement, quand on fait le point sur la question, il y a de quoi frissonner. Le plus délicieux étant la manière dont ceux qui usent ou chapeautent toute cette entreprise de domination par le désir parviennent à justifier leurs actes. On est en droit de se demander qui est véritablement le psycho dans l'histoire.
Et pourtant, tout cela est malsain mais je le trouve aussi délicieux, disais-je. Je dois être philique de Somoza. A chaque roman, j'ai beau soulever tel ou tel défaut, telle ou telle faiblesse, tel ou tel point qui me déplaît ou me chatouille, je dévore quand même le pavé comme une affamée. Ici, l'auteur renoue en plus avec les ressors du thriller qui ajoutent clairement un zeste de plus à des qualités déjà avérées de cuistot du page turner. J'ai commencé par être dérangée, puis par m'interroger, pour enfin être accrochée sans restriction. De l'accrochage à la séduction qui réjouit le désir d'un bon roman, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi sans bouder mon plaisir et, comme toujours, sans voir les pages et les heures défiler.
 Challenge Un pavé par mois chez Bianca
Challenge Un pavé par mois chez Bianca
Participation de mars
19:45 Publié dans Challenge, Littérature hispanique, Polar | Lien permanent | Commentaires (8)
03/03/2015
Le chat qui parlait aux fantômes de Lilian Jackson Braun
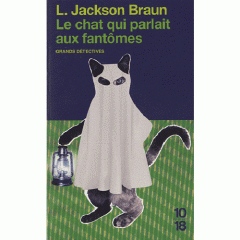
Le chat qui parlait aux fantômes de Lilian Jackson Braun, 10/18, 2011 [1990], 285p.
Dans ce dixième volume de la célèbre série avec chats de Lilian Jackson Braun, Jim Qwilleran - dit Qwill - habite à présent le comté de Moose, à six cents kilomètres au nord de partout (oui, oui) et a hérité de la fortune colossale Klingenschoen qui fait de lui l'homme le plus riche du pays (héritage dont j'ignore tout puisque je suis passée directement du premier tome de la série au dixième par la magie de "je pique ce qu'il y a dans ma PAL hein"). Il habite néanmoins toujours dans un logement modeste, chronique toujours dans le journal local et vit toujours en compagnie de ses chats siamois : le fidèle Koko et la femelle Yom-Yom (spéciale dédicace aux noms improbables et, accessoirement, tout pourris dont on peut affubler, à l'occasion, nos félins compagnons).
Dans ce dixième volume, Qwill était tranquille, était pénard, un dimanche soir vers minuit, à écouter un enregistrement d'Otello de Verdi. Manque de bol, son ancienne gouvernante, Iris Cobb l'appelle paniquée car elle croit entendre des signes d'une présence fantomatique dans le musée qu'elle habite. Ni une ni deux, Qwill déboule à demeure pour la rassurer et l'embarquer en lieu sûr quand il la découvre morte sur le sol de la cuisine. Une crise cardiaque à n'en pas douter. Mais il se pourrait bien que cette crise cardiaque ne soit pas passée par hasard... (Ahaaaaa suspeeeeens)
Vous ne rêvez pas : je suis bien en train de chroniquer la lecture d'une série dont j'avais dit du premier tome qu'il ne cassait pas trois pattes à un canard. La question logique est donc évidemment de se demander ce que je suis allée refaire dans cette galère. Le pire étant que je n'ai aucune réponse valable. Je n'espérais même pas trouver mieux qu'avec Le chat qui lisait à l'envers si tel pourrait pourtant être l'évidence. Non, j'ai simplement empoigné ce titre avec l'assurance - confirmée en l'occurrence - de trouver une lecture dite "détente maximale du neurone fatigué". Ah ça oui, ça détend comme il se doit.
Concrètement, le principal défaut cette fois-ci (car, tout comme la première fois, il y a encore d'indéniables défauts) est la mauvaise gestion du souffle policier. Je m'explique : il faut attendre très précisément la page 98 pour lire Qwill déclarer : "J'ai pour théorie que la mort d'Iris Cobb est une affaire de meurtre." Ah ben enfin, mon canaillou ! Je me demandais quand t'allais cracher le morceau parce qu'autant être clairs : c'est un peu pour ça qu'on est venu !
Les 97 pages précédentes sont donc logiquement à mi-chemin entre l'ennui et le bavardage insipide. Heureusement que Qwill et ses chats sont suffisamment attachants et que j'étais suffisamment fatiguée pour supporter ça.
A partir de la page 97, le rythme monte façon diesel encrassé et ce n'est que dans les 30 dernières pages qu'on se sent ENFIN dans un roman policier sauf que c'est un peu tard et comme il faut boucler l'affaire (il ne saurait être question de pondre un pavé : mieux vaut s'atteler rapidement à un onzième tome de cette série gargantuesque), et bien on la bâcle en bonne et due forme. Résultat : différentes pistes restent inexplorées et en suspens ; la résolution tombe quasiment comme un cheveu sur la soupe avec une précipitation mal venue. Zut ! On s'est tapé la vie du comté de Moose et le menu quotidien des chats en détails depuis le départ et on a même pas eu droit en contrepartie à une intrigue consistante.
Bref, encore une chronique qui donnera très très envie à ceux qui ne connaissent pas la série de la tester, j'en suis certaine ! Ne me remerciez pas : c'est avec plaisir :D
3ème lecture
18:15 Publié dans Challenge, Littérature anglophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (12)
28/02/2015
Pietra Viva de Léonor de Récondo

Pietra Viva de Léonor de Récondo, Points, 2015, 182p.

En 1505, Michel Ange est déjà un artiste renommé. Il est aussi un être secret et silencieux, qui observe avec l'admiration de la plus parfaite beauté le moine Andrea tandis qu'il étudie l'anatomie. Lorsque ce dernier décède brutalement, Michel Ange décide, à son tour, de s'en aller : ce sera Carrare, la ville aux splendides carrières de marbre, afin d'ébaucher le tombeau de Jules II.
Décidément, Michel Ange inspire bien des auteurs ces dernières années. Toute cette personnalité à la fois torturée et prétentieuse, pleine d'un génie qui n'a d'égal que son arrogance insupportable semble fasciner les écrivains qui vont tantôt y chercher les failles, tantôt y polir les idées reçues. A l'énigme d'un artiste répond alors l'imagination d'un autre. Dans Pietra Viva, Léonor de Récondo propose un Michel Ange humain, éminemment complexe dans sa simplicité ; un Michel Ange embourbé dans une solitude de longue date qui l'a blessé puis qu'il a apprivoisé au point de la réclamer avec ardeur et virulence. Ce que Michel Ange a sculpté, c'est d'abord sa propre forteresse pour se protéger des souvenirs douloureux et des blessures du présent. Aussi, la pierre vive de ce roman, c'est peut-être autant le marbre que déniche le sculpteur que la chair même de l'homme qu'il doit creuser pour se comprendre, qu'il doit rouvrir à la lumière pour être libre dans sa création.
On a beaucoup mis en avant dans ce court roman le parti pris de Léonor de Récondo de privilégier l'homme à l'artiste. Pour ma part, il ne me semble pas que cette dichotomie soit pertinente. L'un existe-t-il décemment sans l'autre ? Parler de l'homme, de ce qu'il vit et a vécu et de la manière dont tout cela l'a façonné, n'est-ce pas, exactement, parler de l'artiste ? Il me semble que la plus grande intelligence de l'auteur est précisément de relier ce qu'on a tendance à diviser avec une belle langue, à la fois incisive et poétique, qui trace un grand cercle lumineux entre passé et présent, entre homme et art, entre pierre et peau. J'ai apprécié, en outre, la modestie avec laquelle elle observe le maître ; modestie qui a, fréquemment, inspirée une distance désagréable à certaines lectrices. Pour ma part, cette impression de lire à travers un écran cristallin m'a bercée d'une douce intemporalité qui participe de la séduction de l'ensemble. Après tout, Michel Ange fait homme n'en reste pas moins Michel Ange : un être à part, un éclat de divinité dans un corps inspiré.
Merci à Mina pour cette jolie découverte grâce à notre récent swap !

 Challenge L'art dans tous ses états chez Shelbylee
Challenge L'art dans tous ses états chez Shelbylee
7eme lecture
10:40 Publié dans Art, Challenge, Littérature française et francophone, Swap | Lien permanent | Commentaires (14)





