03/06/2016
La fascination de l'étang de Virginia Woolf
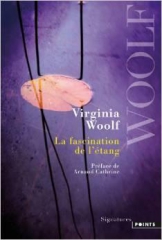
La fascination de l'étang de Virginia Woolf, Points, 2013, 290p.
 Femme indigne, peut-être, à sa manière et en son temps : Virginia Woolf a vécu plusieurs années en célibataire avec ses frères dans une maison qui rassemblait ce fameux cercle de Bloomsbury rempli d'hommes. D'une extrême sensibilité aux humeurs, perméable aux sensations et soumise aux aléas de la dépression, Virginia Woolf dénotait à plus d'un titre dans l'atmosphère encore bienséante du début du XXème siècle, sans parler de son génie hors norme et de son ironie aiguisée. Indignée, assurément, du sort des femmes, et de cette culture qui autorise à l'homme et non à la femme une chambre à soi. Tout cela, on le sait déjà : Virginia Woolf n'est plus à présenter, à tous points de vue. Pourtant, de ses œuvres romanesques magistrales nous manque peut-être une vue d'ensemble - à moins d'avoir déjà tout lu.
Femme indigne, peut-être, à sa manière et en son temps : Virginia Woolf a vécu plusieurs années en célibataire avec ses frères dans une maison qui rassemblait ce fameux cercle de Bloomsbury rempli d'hommes. D'une extrême sensibilité aux humeurs, perméable aux sensations et soumise aux aléas de la dépression, Virginia Woolf dénotait à plus d'un titre dans l'atmosphère encore bienséante du début du XXème siècle, sans parler de son génie hors norme et de son ironie aiguisée. Indignée, assurément, du sort des femmes, et de cette culture qui autorise à l'homme et non à la femme une chambre à soi. Tout cela, on le sait déjà : Virginia Woolf n'est plus à présenter, à tous points de vue. Pourtant, de ses œuvres romanesques magistrales nous manque peut-être une vue d'ensemble - à moins d'avoir déjà tout lu.
La fascination de l'étang nous offre cette possibilité d'un voyage à travers toutes ses années de création littéraire - en somme, le voyage express vers l'aperçu génial d'un devenir écrivain, d'une voix qui se cherche, d'un style qui s'affirme. Au tout début, en 1906, les marottes de Virginia Woolf sont déjà là : la féminité, la recherche d'une indépendance de l'être, la solitude au sein du bourdonnement des villes. "Phyllis et Rosamund" questionne déjà tout cela autour du mariage et de l'affirmation de ses propres décisions, mais dans un style encore emprunt d'une certaine neutralité. On est encore, en 1906, dans un récit à la troisième personne. C'était déjà très bon, évidemment, puisque c'est déjà Woolf, mais ce n'était pas encore la Woolf de Mrs Dalloway ou de La promenade au phare ; plutôt une Woolf en gestation, au sein du cocon des Lettres, mâchouillant déjà propos et idées qui ne la quitteront plus mais cherchant le bon mot, le bon angle, le bon flux. A cette époque, nous sommes quelques neuf ans avant la parution de son premier roman, The Voyage Out.
- Fuyons ! La lune est noire sur la lande. Partons à l'assaut de ces vagues d'obscurité, couronnées par les arbres, qui se soulèvent à jamais, solitaires et noires. Les lumières montent et chutent. L'eau est légère comme de l'air ; la lune luit derrière. Sombrer ? Rouler ? voir les îles ? Seul avec moi. p. 114 (in "La soirée")
Et puis, "La soirée". Génial tournant, claque magistrale : 1919, époque de Night and Day, ce deuxième roman dont on s'accorde à dire qu'il ne marque pas encore l'éclosion totale du style de Woolf, et pourtant, tout était déjà dans cette nouvelle ; il n'attendait plus que quelques années avant de s'épanouir sous la forme romanesque. Le flux de conscience fait son entrée délicate en l'esprit d'une jeune femme invitée à une réception et les pensées fusent entre les paroles au point de ne plus savoir exactement qui est quoi. Plus que de la littérature, la voix de Woolf émerge comme chant, comme incantation de l'instant présent et des êtres évanescents. Une pure merveille que j'ai relue plusieurs fois, presque d'affilée, puis à plus longs intervalles, avec un ravissement renouvelé. Chaque mot est poésie pure.
Progressivement, les nouvelles deviennent ainsi, à l'image des titres de deux d'entre elles, "Tableaux" et "Portraits". On glisse du factuel au vivant, au saisissement d'impressions et d'instants de vie fugaces. Une certaine fascination pour l'eau, tantôt stagnante de l'étang, tantôt flux et reflux des vagues, s'affirme peu à peu, à l'image du courant qui porte progressivement la vie et l'existence de Woolf. Mrs Dalloway, aussi, est déjà là, dans Bond Street en 1922, année de la parution de Jacob's room et trois ans avant le roman éponyme. A cette époque, ce sont des gants qu'elle s'en va acheter, traversant Londres et s'en laissant traverser. Les nouvelles qui suivent livreront au lecteur certains de ses invités croqués sur le vif, révélant du même coup d'autres visages de Mrs Dalloway.
Il est impossible de mettre des mots là-dessus, et puis c'est superflu. Sous les vibrations vacillantes de ces petites créatures, il y a toujours un réservoir profond, et la mélodie simple, sans le dire, lui fait quelque chose de curieux : elle en ride la surface, elle le liquéfie, elle y crée des remous, le fait rouler et palpiter dans les profondeurs de l'être jusqu'à ce que des idées surgissent de cette nappe d'eau et montent au cerveau faire des bulles. p. 205 (in "Mélodie simple")
Ainsi s'offre au lecteur le cabinet de création d'une des plus grandes auteures anglaises (et malgré le grincement de dents que peut susciter le féminin de cette auguste profession, je crois qu'il sied à Woolf d'affirmer son combat pour la reconnaissance des femmes de Lettres). Nous y voilà donc, au génie, au cheminement de l'alliance inespérée de la prose et de la poésie.
 Le mois anglais 2016 chez Lou et Cryssilda
Le mois anglais 2016 chez Lou et Cryssilda
2ème participation
LC Femmes indignes et indignées
 Challenge Femmes de Lettres chez George
Challenge Femmes de Lettres chez George
1ère participation pour une auteure du XXème siècle
16:21 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone, Nouvelles | Lien permanent | Commentaires (13)
25/05/2016
Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez
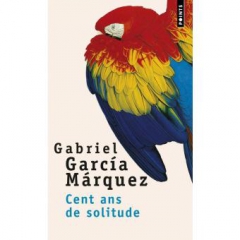
Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, Points, 1997 [1967], 461p.
Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace.
 On dit des grands romans qu'ils se repèrent dès la première phrase. Il en va ainsi Du côté de chez Swann ou de Mrs Dalloway. Il en va de même pour Cent ans de solitude dont le génie éclabousse dès l'incipit - ce génial incipit où le réalisme merveilleux de Garcia Marquez se dévoile éblouissant, drôle, savoureux, parodique et lyrique tout à la fois.
On dit des grands romans qu'ils se repèrent dès la première phrase. Il en va ainsi Du côté de chez Swann ou de Mrs Dalloway. Il en va de même pour Cent ans de solitude dont le génie éclabousse dès l'incipit - ce génial incipit où le réalisme merveilleux de Garcia Marquez se dévoile éblouissant, drôle, savoureux, parodique et lyrique tout à la fois.
Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons en glaise et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et, dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineau, qui répondait au nom de Melquiades, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés, et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melquiades. "Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un accent guttural ; il faut réveiller leur âme, toute la question est là."
Au commencement était Macondo - puisque tout est mythique dans ce roman où chaque phrase contient le monde et toute l'histoire est une prophétie de solitude infligée à la descendance du couple premier José Arcadio et Ursula Buendia pour avoir commis le péché d'inceste puis le meurtre. Descendance ô combien hallucinante et hallucinée, entre le rêve et la cruauté la plus brute, où chacun dessine les contours cent fois vécus et réinvente en même temps le présent d'un village fantasmé. Aux sentiments violents de la passion, de l'orgueil ou de la gourmandise se mêlent les guerre et les fléaux, un déluge impressionnant, la colonisation ou la dictature militaire. Entre les mailles d'une nouvelle Bible gorgée de sang et des fleurs délicieuses d'un style tout en nuances sous les atours de l'hyperbole, Garcia Marquez évoque aussi l'Histoire de son pays et construit le mythe de la Colombie à travers le mythe de l'Homme.
Se succède ainsi une série de vies entrecroisées, tantôt fulgurantes, tantôt étonnamment dilatées, qui se répètent inlassablement, suivant un déclin pré-destiné. Un tel projet enjoint deux réflexions au lecteur au fil de la lecture : la première est relative à l'intelligence de la construction, l'admiration face à l'ampleur d'un univers imaginaire ahurissant ; la deuxième avoue pourtant la difficulté d'en suivre les méandres sur la longueur tant la circularité des destins - les nombreux prénoms identiques - peuvent perdre à force de se répéter. Malgré tout, c'est l'impression d'avoir touché du doigt un chef d'oeuvre comme on en fait peu qui prévaut indéniablement. La certitude que Garcia Marquez est un prix Nobel évident. Je n'ose imaginer quel pouvait être le cerveau d'un tel homme. Etait-ce d'ailleurs encore un homme, à un tel stade du génie ?
Il n'y avait, dans le coeur d'un Buendia, nul mystère qu'elle ne pût pénétrer, dans la mesure où un siècle de cartes et d'expérience lui avait appris que l'histoire de la famille n'était qu'un engrenage d'inévitables répétitions, une roue tournante qui aurait continué à faire des tours jusqu'à l'éternité, n'eût été l'usure progressive et irrémédiable de son axe.
 Challenge des 100 livres à lire chez Bianca
Challenge des 100 livres à lire chez Bianca
24ème participation
15:51 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature hispanique | Lien permanent | Commentaires (10)
07/05/2016
Demian de Hermann Hesse
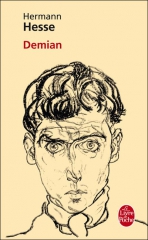
Demian de Hermann Hesse, Le livre de poche, 2001 [1919], 186p.
 Grâce à Demian, Hermann Hesse entre non seulement en littérature mais livre du même coup un des plus brillants roman d’initiation qui soit. Ce n’est pas de l’initiation de Demian dont il est question, en l’occurrence, mais de celle d’Emil Sinclair, un garçonnet naïf, un poil insipide – il faut bien le dire – au début du récit. Le genre de garçonnet adorable et choyé qui se laisse embarquer par la brute du coin dans un chantage sans fin jusqu’au jour où Max Demian, un plus âgé que lui particulièrement charismatique et mystérieux, s’entiche de lui, semblant lui reconnaître une singularité, et met fin au problème. Dès lors, la vie de Sinclair et celle de Demian se trouvent mêlées dans une curieuse alternance de fascination et de répulsion, d’absences puis de retrouvailles fusionnelles. Demian est décidément insaisissable ; il semble avoir déjà atteint des sommets dans la connaissance de son être. Sa seule évocation guide Sinclair dans ce processus : celui de se frayer un chemin vers soi-même.
Grâce à Demian, Hermann Hesse entre non seulement en littérature mais livre du même coup un des plus brillants roman d’initiation qui soit. Ce n’est pas de l’initiation de Demian dont il est question, en l’occurrence, mais de celle d’Emil Sinclair, un garçonnet naïf, un poil insipide – il faut bien le dire – au début du récit. Le genre de garçonnet adorable et choyé qui se laisse embarquer par la brute du coin dans un chantage sans fin jusqu’au jour où Max Demian, un plus âgé que lui particulièrement charismatique et mystérieux, s’entiche de lui, semblant lui reconnaître une singularité, et met fin au problème. Dès lors, la vie de Sinclair et celle de Demian se trouvent mêlées dans une curieuse alternance de fascination et de répulsion, d’absences puis de retrouvailles fusionnelles. Demian est décidément insaisissable ; il semble avoir déjà atteint des sommets dans la connaissance de son être. Sa seule évocation guide Sinclair dans ce processus : celui de se frayer un chemin vers soi-même.
Prétendre synthétiser toute la richesse de ce roman, pourtant court, me semble une gageure, comme cela l’était déjà pour Le jeu des perles de verre. Hermann Hesse a, en plus du talent du style, le don de tresser intimement à la littérature la psychanalyse et la philosophie à un point tel qu’il faudrait être expert en ces trois domaines pour travailler convenablement toute la matière de son texte. Puisque ce n’est pas mon cas, je me bornerai modestement à vous appâter en agitant l’intérêt passionnant du cheminement de Sinclair, pétri initialement d’une vision binaire, et donc caricaturale, de l’existence vers l’éveil à soi. Vivre, exister, n’est plus seulement être heureux, encore moins être dans la norme – ce qui, d’ailleurs, est synonyme pour beaucoup – mais être soi, penser chaque acte, chaque seconde en accord avec soi. Il s’agit de chercher une forme d’accomplissement dans la pleine réalisation dynamique de ses aspirations. Sinclair, comme Demian, s’affirment d’emblée en opposition avec la plupart de leurs contemporains passéistes, soucieux de maintenir un ordre et des apparences. Il y a dans ce Demian retenu mais cinglant, parfois furieux, quelque chose de profondément nietzschéen dans ce mouvement qui réclame de briser les codes, de faire fi des conventions pour trouver un état d’être puissant, imaginatif, gorgé d’une éternelle sève de vie.
Le cheminement vers soi ne se fait pas sans heurts. Sinclair peine furieusement à bien des étapes et le monde lui-même s’avance dangereusement vers un écroulement sans lequel aucun nouveau départ n’est possible. Celui qui accepte de considérer un plein éveil au monde comme une absolue nécessité doit, du même coup, accepter l’imminence tout aussi nécessaire de la destruction d’un ordre ancien, obsolète. L’avenir doit se construire sur une table rase comme le phénix renaît de ses cendres. La proximité évidente de la Première Guerre Mondiale pour expliquer cette chape violente qui plane sur l’espoir d’un monde nouveau chez Hesse ne voile pour autant pas la criante actualité du propos de nos jours. C’est sans doute ce qui achève de le placer comme un chef d’œuvre : ce caractère intemporel et le message brûlant d’être avant d’avoir, avant de se conformer, avant de courber l’échine. Cette insoumission à ce qui n’est pas en accord avec soi. Cette urgence qu’il y a à tous suivre les pas de Demian et Sinclair.
12:03 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Littérature germanique, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (6)




