06/03/2015
Les Vagues de Virginia Woolf
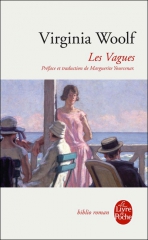
Les Vagues de Virginia Woolf, traduction de Marguerite Yourcenar, Le Livre de Poche, 2004 [1931], 286p.
 A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
Tandis que Mrs Dalloway dilatait le temps au point de faire d'un seul jour l'histoire de tout un roman, Les Vagues resserre les mouvements de l'horloge humaine - et la course du soleil - jusqu'à raconter l'histoire universelle de six consciences éclatées, bercées par le quotidien et pris dans la houle de l'univers entier. Ils sont Bernard, Louis, Neville, Suzanne, Rhoda et Jinny. Nous ne saurons jamais rien d'eux que ce qu'ils veulent bien penser et ressentir à différents âges de la vie. Entre chaque, les vagues éclaboussent le rivage ; le soleil monte et descend au gré d'une jeunesse qui s'épanouit et d'une vieillesse qui se creuse tout doucement.
Souvent, j'aime des romans. Parfois, j'ai même un coup de cœur pour l'un d'eux. Toujours, j'ai conscience d'avoir affaire au produit, bien que talentueux, d'un être aussi humain que moi. Pourtant, tout cela s'efface lorsque je lis Virginia Woolf et, plus particulièrement, lorsque je lis ses romans de la maturité. Je me rappelais avoir été subjuguée il y a quelques sept ans par Les Vagues mais, pour une raison inconnue, Mrs Dalloway restait pour moi son titre phare, son titre le plus abouti en terme l'alchimie entre un projet littéraire périlleux et la nécessité d'embarquer le lecteur. Je crois à présent pouvoir dire que Les Vagues lui est encore bien supérieur à tous points de vue. Pour cela, il m'aura fallu attendre un paquet d'années, il m'aura fallu lire et relire d'autres Woolf, et il m'aura fallu dénicher le moment propice pour revenir à ce titre-ci.
Rien ne se perd, un éclat se crée et tout se transforme. Tel pourrait être l'adage des Vagues. A l'image de chaque jour, la fin n'existe que pour être un nouveau départ : la mort est une transition ; une partie du mouvement perpétuel. Tout ce qui émerge dans l'éclat d'un rayon, le battement d'un cil ou l'éclair d'une conscience est source de création. L'être y apporte sa touche particulière et forme le grand ballet de la vie au sein duquel chaque parcelle d'herbe et de joie a l'importance particulière de révéler l'instant présent.
Je vois très distinctement chaque brin d'herbe. Mais mon pouls retentit contre mes tempes, contre les yeux, avec le bruit d'un tambour. C'est pourquoi tout danse, le filet, l'herbe. Vos visages voltigent comme des papillons ; les arbres ont l'air de bondir. Il n'y a rien d'assuré, rien de définitif dans cet univers. Tout est mouvement, tout est danse ; tout est triomphe et rapidité. p. 53
La vie vient ; la vie s'en va. Nous créons la vie. p. 174
Et Bernard d'ajouter à la toute fin du roman, comme l'ultime saut de ce qui ne connait jamais de point final :
Oui, c'est bien l'éternel renouveau, l'incessante montée qui suit une retombée sans fin.
Et en moi aussi, la marée monte. La vague se gonfle, elle se recourbe. Une fois de plus, je sens renaître en moi un nouveau désir ; sous moi quelque chose de redresse comme le cheval fier que son cavalier éperonne et retient tour à tour. p. 286

La vague de Pierre-Auguste Renoir, 1879
Ce mouvement éternel et perpétuel, c'est aussi celui de l'écriture romanesque. Car nous évoquions le dépouillement progressif de la narration woolfienne ; à tel point qu'on pourrait même se demander pourquoi elle n'en vient pas tout naturellement à la poésie. Pourquoi continuer de recourir à ce qu'on effiloche ? Mais regardons de plus près ces Vagues étonnantes : C'est vrai, nous n'avons plus d'histoire, nous n'avons plus de décor, nous n'avons même plus de personnages. Les consciences narratives ne sont plus que silhouettes incertaines. Woolf a éliminé tout ce qui fait du roman une vaste fumisterie. La construction minutieuse d'une supercherie consentie entre l'auteur et le lecteur. Woolf lève le voile. Vois-tu, semble-t-elle nous dire, il n'y a rien de tout cela. Tout cela est faux et ne sert à rien ; ne dis rien de l'essentiel. Woolf ne garde que le temps précieux du roman : sa capacité à tenir une note sur laquelle tresser les mots merveilleux. Et puis, sur cette note, elle va ajouter quelques autres perles piquées ici ou là - car dépouiller ne veut pas forcément dire laisser nu ensuite : cette succession de monologues intérieurs comme autant de monologues théâtraux et ces réflexions tantôt aériennes tantôt pesantes comme autant de poèmes en prose. Les romans de Woolf ont ce quelque chose de magique qui fait de chaque page le lieu d'une potion où se rencontrent tous les genres.
Partout où il est question de la vie et du temps dans Les Vagues, il est question de l'écriture. Deux consciences ont des velléités littéraires : Neville, le poète byronien qui savoure l'ordre et se languit de l'amour et Bernard, le raconteur d'histoires. Bernard qui compile dans un carnet chaque phrase qui lui vient un beau matin pour s'en resservir plus tard. Bernard qui est le seul des six consciences à devenir narrateur à l'occasion. Bernard, enfin, à qui reviendra la lourde tâche de boucler la boucle du jour/de la vie/du roman, de "faire l'addition" et d'en rouvrir une nouvelle. Mais Bernard qui n'écrit jamais rien en définitive, ne finit jamais aucune histoire :
J'ai inventé des milliers d'histoires ; j'ai rempli d'innombrables carnets de phrases dont je me servirai lorsque j'aurai rencontré l'histoire qu'il faudrait écrire, celle où s'inséreraient toutes les phrases. Mais je n'ai pas encore trouvé cette histoire. Et je commence à me demander si ça existe, l'histoire de quelqu'un. p. 185
Mais les histoires n'existent pas, pas plus que Perceval n'existe. Perceval qui attire et subjugue, qui fait le lien entre tous par une aura que nous ne parvenons pas à saisir, mais qui ne pense pas, ne parle pas. Qui apparait aussi fantomatique qu'un rêve. Perceval, le bien-nommé, est ce héros des romans de jadis, pleins d'héroïsme, d'aventures et de consistance factice. On se raconte des péripéties fabuleuses qui aident à s'endormir et à continuer à vivre. Ainsi Perceval est-il le meneur d'une amitié branlante entre six esprits aux quatre vents. Et puis Perceval meurt brutalement : c'est la mort du grand roman médiéval. A la suite de Bernard, nous sommes invités à remettre en cause l'épopée mystérieuse des histoires romanesques.
Perceval est mort. (Il est mort en Égypte, il est mort en Grèce : toutes les morts ne sont qu'une seule mort.) p. 169

Nymphéas de Claude Monet, 1914-1926
Les Vagues est un roman impossible. Le pari totalement fou de dire ce qui ne peut être dit ou plutôt le pari de le dire d'une manière totalement inédite et si épurée que tout autre écrivain en aurait fait une peau de chagrin à mi-chemin entre l'insipide et l'informe. Mais Virginia Woolf a réussi à en faire LE roman, tenu étroitement et en équilibre, centré très précisément autour de peu de consciences et qui, pourtant, touche à une universalité géniale et absolue. Dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman me semble presque ridicule. Le coup de cœur concerne les bons romans qui m'ont tenue en haleine ou m'ont séduite. Les Vagues m'a fait entrevoir quelque chose de l'ordre du transcendant et du divin. C'est ce qu'on appelle un coup de grâce !
18:06 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (14)
14/02/2015
Orgueil et préjugés de Jane Austen

Orgueil et préjugés de Jane Austen, Le livre de poche, 2011 [1813], 512p.
Ça y est : je l'ai fait ! J'ai enfin lu l'incontournable, le piquant, que dis-je, le roman le plus célèbre de Jane Austen : j'ai nommé, Pride and prejudice (et quelle délicieuse allitération, n'est-il pas ?). J'ai enfin décidé de ne pas douter qu'un célibataire nanti doit être nécessairement à la recherche d'une femme ; j'ai enfin considéré que les breakfast à l'anglaise étaient savoureux ; et, comme tout un chacun (il serait plus juste de dire chacune), j'ai très sérieusement envisagé de me pâmer devant Darcy. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Mais parce que, très simplement, les pirates m'attirent plus de prime abord que les ambiances anglaises à base de thé et de petits gâteaux. De ce fait, j'ai toujours regardé le P&P dans ma PAL (à moitié déchiqueté d'ailleurs, déniché par hasard à 50cts dans une brocante parce qu'"on sait jamais, c'est quand même un classique") avec un regard suspicieux et hautain. Inutile de dire que je souffrais donc moi-même d'orgueil et de préjugés.

Et puis, paf, dès la première page, l'ironie d'Austen me saute au yeux et me fait sourire instantanément. (A propos, je considère que je peux vous faire grâce d'un résumé en bonne et dure forme de l'histoire, hein.) S'il est bien question de mariage à tout bout de champ, c'est sous couvert d'un filtre que le lecteur averti peut aisément déceler pour mieux se délecter de la subtilité des divers niveaux de lecture. Quelle acuité et quelle modernité de Jane Austen dans l'appréciation de mœurs de son époque ! D'autant que cette fameuse ironie se dessine selon toutes les gammes possibles : On frise la caricature à travers les personnages de Mrs Bennett ou de M. Collins, la comédie sociale dans les scènes collectives ou l'analyse psychologique et caustique - souvent déléguée au merveilleux personnage d'Elizabeth.
Parlons, d'ailleurs d'Elizabeth. Je comprends à présent mieux pourquoi ce personnage a tant marqué des générations de lectrices. A travers elle aussi, Austen affiche une décoiffante modernité. Qu'il soit envisageable qu'une jeune femme célibataire puisse à ce point affirmer sa pensée et faire preuve de liberté et de franchise - dans le respect des mœurs évidemment, Elizabeth est un personnage féminin moderne, pas une rebelle écervelée - et que ce personnage ait été créé par une femme également célibataire, tout cela apparaît particulièrement subversif et d'un féminisme avant l'heure éclairé et rafraîchissant. Je n'aurais typiquement pas eu cette lecture d'Elizabeth très jeune , je pense, n'ayant pas alors le recul nécessaire quant à l'histoire littéraire et à l'Histoire tout court. Il est donc heureux que P&P m'ait attendue si longtemps (et hop, on se dédouane comme on peut de découvrir un classique sur le tard).

Quant à Darcy. Ah, Darcy. Sacré Darcy, devenu le parangon du parfait British prince charmant (j'hallucine d'ailleurs passablement du nombre de romance à trois balles qui utilisent sans vergogne la veine Darcy. Jane Austen doit s'en étrangler depuis un paquet d'années). Voyons, voyons. Bien sûr, comment ne pas tomber amoureuse de Darcy ? Mais très franchement, j'ai quand même gardé suffisamment de lucidité pour constater qu'on commence franchement à tomber amoureuse de lui quand il devient peut-être moins passionnant et mystérieux. Globalement, d'un point de vue littéraire, du point de vue de cette ironie austenienne si mordante, c'est sans doute la première partie qui se lit avec le plus de délice. A partir de la deuxième, on en revient doucement à une lecture premier degré - ou il serait plus juste de dire que, chez le lecteur, c'est clairement la lecture premier degré qui prend le dessus sur l'autre - et l'on guette avidement le moindre signe de rapprochement entre Darcy et Elizabeth, non sans s'identifier à Elizabeth (ahahaha). Dans mon cas, la littéraire a adoré la première partie et la gonzesse a dévoré la seconde. Au fond, Darcy est assez typique : Le bel homme fier, plein de mystère et de non-dit, d'une beauté à faire fleurir un artichaut, qui subjugue tout le monde - positivement ou pas - sans décrocher un seul mot. Et paf ! Dans le mille. Même le renversement progressif du type est lui aussi un type : sous le mystère, se cache la perfection (C'est moi où on est presque chez Disney ?). Là où le personnage tire son épingle du jeu, c'est lorsqu'il tombe amoureux d'un audacieux esprit libre comme Elizabeth Bennett. Celle-là, on ne l'attendait et celle-là est vraiment bien bonne. Le fait que les deux personnages masculins les plus éclairés du roman - M. Bennett et Darcy - accordent leur préférence à Elizabeth est une fameuse caution (pour l'époque) que l'audace, l'intelligence et la franchise s'élèvent bien au-dessus de la beauté, de la vanité et de la docilité.

Néanmoins, si Darcy est le parfait prince charmant, il est aussi la parfaite tarte à la crème lorsqu'il s'agit de l'incarner à l'écran. J'espérais être plus indulgente à l'égard de Matthew MacFadyen, en revoyant l'adaptation de Joe Wright après lecture du roman, mais il n'en est malheureusement rien. Je lui trouve le charisme d'un beignet ; or, un Darcy qui ne respire pas l'orgueil n'est pas un bon Darcy. Colin Firth est évidemment la référence en la matière et il faudra se lever tôt pour l'égaler. Mais même si je le trouve supérieur en tout point, je ne le trouve pas impeccable de bout en bout. Ces scènes de silence où Darcy ne parle que par son regard sont décidément bien casse-gueule. Allez, cela dit, j'avoue tout : Colin Firth a quand même fini en fond d'écran de mon ordinateur. C'est officiel : je suis passée du côté fleuri de la force.
Lu en lecture commune avec ma copine blogueuse du royaume de fort fort lointain, Topinambulle. Allons voir sa chronique !

 Doublé gagnant chez Bianca (ça faisait longtemps) pour le pavé du mois de février et le 20eme titre à avoir lu
Doublé gagnant chez Bianca (ça faisait longtemps) pour le pavé du mois de février et le 20eme titre à avoir lu
13eme lecture
 Challenge mélange des genres chez Miss Léo
Challenge mélange des genres chez Miss Léo
Catégorie Classique étranger
09:49 Publié dans Challenge, Classiques, Lecture commune, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (20)
17/01/2015
L'étranger d'Albert Camus

L’étranger d'Albert Camus, Folio, 1972 [1942], 186p.
L'histoire est connue de tous, aussi je serai brève. Je dois faire partie des rares littéraires à avoir louvoyé pendant toute sa scolarité pour passer entre les mailles du filet de ce roman... Il était pourtant temps de s'y frotter ! L'étranger est, après tout, un classique incontournable.
Et l'étranger en question est Meursault. Non pas en son pays mais en sa vie même. Meursault traverse les jours avec une indifférence désarmante. On trouverait plus de vagues sur la Méditerranée un jour sans vent ! Sa mère meurt, tel est le point de départ du roman. Le jour importe peu, c'est surtout du dérangement. Meursault ne sait pas quoi dire ni comment agir. Il semble que la société obéisse à des règles tacites dont il est exclu. Amour, haine, tristesse : tout cela lui est inconnu. Il n'a pas non plus de système de valeurs. Aussi, aider un voisin passablement pourri, violent et misogyne à battre une jeune femme qui l'a quitté ne lui pose aucun problème moral. Sa maîtresse Marie lui demande s'il l'aime et veut l'épouser ? Meursault répond qu'il ne croit pas l'aimer mais il veut bien l'épouser si cela lui fait plaisir. Indifférence, indifférence... La seule chose qui semble pénétrer un peu cet étrange protagoniste, c'est le soleil. Ce dernier va finir par lui jouer un sale tour. A force de traverser sa vie en spectateur, Meursault sera poussé au meurtre. La passivité et le soleil de plomb comme déclencheurs du meurtre : situation absurde par excellence. Et tandis que Meursault ne comprend toujours pas et n'est touché par rien, ceux qui s'occupent de le juger pour ce crime ne le comprennent pas non plus. Et le procès de dériver en une spirale infernale où l'on ne juge plus un meurtre mais une vie toute entière.
On ne va pas se mentir : je me suis terriblement ennuyée. En tout cas, la première partie du roman où il est question de dérouler la vie de Meursault et d'exprimer de manière criante son indifférence à vivre - seul, en société, dans son rapport au temps. L'avantage d'avoir lu tardivement ce roman, c'est que j'en connaissais la trame, de même que la philosophie qui la sous-tend. Ça ne m'a pourtant pas aidée à prendre plaisir à ma lecture. J'ai expérimenté à cet endroit, comme cela m'est arrivé à d'autres, cette dichotomie entre le cerveau de lettreuse qui voit les qualités et mes tripes de lectrice qui végètent à s'en pendre avec une corde à linge.
La deuxième partie est néanmoins mieux passée. Dans celle-ci, il ne s'agit plus seulement de montrer l'absurdité de la vie mais d'agir en toute conscience. Meursault ne cherche pas vraiment à se battre : on ne se bat pas face à l'absurde. C'est simplement un fait, une évidence. Par contre, on peut vivre malgré tout en le sachant. On peut relever le défi d'être heureux dans une existence qui n'a pas vraiment de sens. Ce meurtre, c'est la vie. Et Meursault se découvre une soif de recommencer au contact de son exécution imminente. Lui qui était indifférent à la mort de sa mère comprend celle-ci dans ces derniers instants.
En outre, le procès de la société est éloquent. Meursault n'est pas jugé pour son crime mais pour ce qu'il est, pour ne pas réagir comme tout le monde, pour avoir une conscience aiguë de l'absurdité de la vie. Il est jugé pour ne pas chercher, comme la plupart des gens, à s'oublier dans une cause, dans une croyance ou dans un groupe.
S'il fallait synthétiser L'étranger, je dirais qu'il offre une vision romanesque de la philosophie camusienne exprimée dans Le mythe de Sisyphe. De ce point de vue théorique et réflexif, il est effectivement un classique à avoir lu. A cet égard, je vous renvoie à une excellente étude du roman en ce sens ici. Mais puisque je ne suis pas ici pour faire une dissertation en trois parties, bien plutôt pour laisser s'épancher ma subjectivité de lectrice, je ne m'étendrai pas là-dessus. J'ai lu le roman, je ne mourrai donc pas stupide. Mais franchement, si je n'en avais pas eu la quasi obligation professionnelle, je n'aurais pas dépasser la cinquième page comme cela avait déjà été le cas lors de mes deux précédentes tentatives. Ce style dépouillé, d'une blancheur extrême... L'impossibilité radicale de saisir quoi que ce soit, d'accrocher quoi ce soit... Tout cela est évidemment à dessein, j'entends bien. Mais cela a aussi pour conséquence d'avoir été, pour moi, d'un ennui absolument décapant. Les seuls romans à m'avoir autant ennuyée doivent être L'éducation sentimentale et Le lys dans la vallée, c'est pour dire. Heureusement pour moi, Camus a joué la brièveté, j'ai donc pu sortir de ce traquenard avant la Saint Glinglin.
Bon ben, une expérience plutôt ratée pour moi, donc, même si j'ai plus apprécié la seconde partie. Comme on dit, on ne peut pas tout aimer !
PS : Au début de la chronique, je mentionnai que j'allais être brève. Bon ben, c'est raté hein. Désolée, l'ami.
 Challenge les 100 livres à avoir lus chez Bianca
Challenge les 100 livres à avoir lus chez Bianca
19eme lecture
 Challenge Mélange des genres chez Miss Léo
Challenge Mélange des genres chez Miss Léo
Et hop un classique français du XXeme siècle !
19:44 Publié dans Challenge, Classiques, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12)





