07/04/2015
Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach

Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach, Espace Nord, 2012 [1892], 208p.
 Hugues Viane souffre d'un veuvage qui n'en finit pas. Tout est sanctuaire de la morte dans son intérieur feutré et profondément solitaire ; la ville même de Bruges révèle sans cesse sa peine et sa soumission à la douleur. Bruges qui, elle-même, ne vit plus tellement. Grise, monotone et baignée des eaux d'une Ophélie fantasmée ; dont les bâtiments découpent sur le ciel leurs dentelles mélancoliques : Bruges est l'affirmation consolatrice du deuil de Viane et la présence caressante de la morte.
Hugues Viane souffre d'un veuvage qui n'en finit pas. Tout est sanctuaire de la morte dans son intérieur feutré et profondément solitaire ; la ville même de Bruges révèle sans cesse sa peine et sa soumission à la douleur. Bruges qui, elle-même, ne vit plus tellement. Grise, monotone et baignée des eaux d'une Ophélie fantasmée ; dont les bâtiments découpent sur le ciel leurs dentelles mélancoliques : Bruges est l'affirmation consolatrice du deuil de Viane et la présence caressante de la morte.
"Dans l'atmosphère muette des eaux et des rues inanimées, Hugues avait moins senti la souffrance de son cœur, il avait pensé plus doucement à la morte. Il l'avait mieux revue, mieux entendue, retrouvant au fil des canaux son visage d'Ophélie en allée, écoutant sa voix dans la chanson grêle et lointaine des carillons.
La ville, elle aussi, aimée et belle jadis, incarnait de la sorte ses regrets(1). Bruges était sa morte. Et sa morte était Bruges. Tout s'unifiait en une destinée pareille. C'était Bruges-la-Morte, elle-même mise au tombeau de ses quais de pierre, avec les artères froidies de ses canaux, quand avait cessé d'y battre la grande pulsation de la mer." (Chap. 2)
Un beau jour, sur l'un des quais de cette Bruges-la-Morte, le regard de Viane croise la morte revenue : c'est un étourdissement d'abord, une sorte de possession qui le fait suivre ce corps tant aimé, fantomatique, jusque dans un théâtre où il ne mettait plus les pieds depuis dix ans. Puis cela devient une passion illusoire. Il entretient progressivement ce sosie tant chéri sans l'ombre d'une mauvaise pensée puisque, dans son esprit, c'est sa femme défunte qu'il continue d'aimer. Mais le vernis de l'adoration craquelle peu à peu, à mesure que sous le corps semblable émerge le caractère bien différent de la danseuse vivante pleine de verve, d'ironie et d'indélicatesse.
"Hugues se sentait un malaise d'âme grandissant ; il eut l'impression d'assister à une douloureuse mascarade. Pour la première fois, le prestige de la conformité physique n'avait pas suffi. Il avait opéré encore, mais à rebours. Sans la ressemblance, Jane ne lui eût apparu que vulgaire. A cause de la ressemblance, elle lui donna, durant un instant, cette atroce impression de revoir la morte, mais avilie, malgré le même visage et la même robe - l'impression qu'on éprouve, les jours de procession, quand le soir on rencontre celles ayant figuré la Vierge ou les Saintes Femmes, encore affublées du manteau, des pieuses tuniques, mais un peu ivres, tombées à un carnaval mystique, sous les réverbères dont les plaies saignent dans l'ombre." (Chap. 7)
A mesure que Viane s'englue dans cette passion avilissante et destructrice, à mesure qu'il devient un "défroqué de la douleur", Viane entend la ville lui souffler son mensonge et sa faute. Qu'il est dur de vouloir croire tandis que tout crie l'illusion et éclabousse le péché ! Que peut répondre le pécheur à l'abîme qu'il a creusé et comment rétablir l'ordre éternel ?

Illustration de Marin Baldo (1910)
Quelle merveilleuse découverte ! Je ne me rappelle pas avoir jamais lu de roman symboliste - mouvement plus connu pour sa poésie érudite et virtuose que pour sa prose - mais celui-ci restera sans aucun doute longtemps dans ma mémoire. Il est extrêmement court : une centaine de pages à tout prendre (les autres, dans toutes les éditions, étant des notes, préface et postface à tout va pour éclairer le lecteur ravi) mais condense avec une intelligence profonde les liens entre toutes choses du monde.
Tout semble être jeux de miroirs et de dissemblances ; regards projetés et renvoyés avec un étrange éclat terne et mélancolique. Viane et la ville compose un deuil idéalisé - la permanence de l'amour par-delà la mort - et morbide - tout cet entretien de la morte en chaque chose, ce musée macabre dans chaque pièce de la maison frise la pathologie psychiatrique - à tel point que la ville est un certain visage de Viane. La défunte, quant à elle, jamais nommée et toujours idéalisée elle-aussi, joue une nouvelle vie en le corps de Jane la danseuse. Jane, la presque morte mais avilie ; transgression suprême du souvenir parfait ! Toutes les images disséminée dans le romans jouent sur le contrepoint de l'idéal et de la perdition ; de la perfection et de l'opprobre : sur la délicieuse esthétique fin de siècle, en somme !
J'ai gouté cette esthétique avec une joie totale, dans une sorte de lenteur extatique que me semblaient réclamer le style et le décor d'une Bruges dont je me demande, à présent, à quoi elle peut bien ressembler vraiment. Qui sait, j'irai peut-être un jour voir de mes propres yeux ses fameux quais orphelins de la pulsation de la mer et penserai à Viane !

Souvenir de Bruges de Fernand Khnopff (1904)
 Le mois belge d'Anne et Mina, édition 2015
Le mois belge d'Anne et Mina, édition 2015
Rendez-vous autour d'un classique
08:03 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (12)
01/04/2015
Ouverture poétique du mois belge !
 Aujourd'hui 1er avril s'ouvre tout un mois consacré à la littérature belge à l'invitation de deux blogueuses amies Anne et Mina. A cette occasion, je publierai quelques billets divers (dont je n'ai pas encore décidé le nombre : tout dépendra de ma motivation). En attendant, j'ai choisi d'ouvrir le bal avec un texte poétique (et je le fermerai sans doute de même) qui n'est pas sans annoncer l'un de mes billets à venir pour le 7 avril. Un grand classique de la poésie belge, c'est certain ! Je ne fais pas ici dans l'originalité. Mais les classiques ont ceci d'agréable qu'on ne s'en lasse jamais et qu'à chaque lecture on est plongé dans mille souvenirs en même temps qu'on découvre quelque chose de nouveau.
Aujourd'hui 1er avril s'ouvre tout un mois consacré à la littérature belge à l'invitation de deux blogueuses amies Anne et Mina. A cette occasion, je publierai quelques billets divers (dont je n'ai pas encore décidé le nombre : tout dépendra de ma motivation). En attendant, j'ai choisi d'ouvrir le bal avec un texte poétique (et je le fermerai sans doute de même) qui n'est pas sans annoncer l'un de mes billets à venir pour le 7 avril. Un grand classique de la poésie belge, c'est certain ! Je ne fais pas ici dans l'originalité. Mais les classiques ont ceci d'agréable qu'on ne s'en lasse jamais et qu'à chaque lecture on est plongé dans mille souvenirs en même temps qu'on découvre quelque chose de nouveau.
Je vous souhaite à tous un bon début de mois belge !
 BRUGES
BRUGES
Les bras des longs canaux que le couchant fait d'or
Serrent près du beffroi, comme autour d'un refuge,
Toute la gloire ancienne et dolente de Bruges,
La ville est fière, et douce, et grande par la mort.
Mais néanmoins, toujours, monte vers la lumière
Le rectiligne élan de sa beauté guerrière,
Et son bourdon réveille un trop vivant écho
Pour éternellement pleurer sur son tombeau.
Émile Verhaeren (Toute la Flandre, t. I., «La guirlande des dunes», Paris, 1907.)
Tableau : Mon coeur pleure d'autrefois de Fernand Khnopff (1889)
07:19 Publié dans Art, Classiques, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (8)
27/03/2015
Une saison à Longbourn de Jo Baker
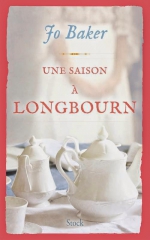
Une saison à Longbourn de Jo Baker, Stock, 2014, 394p.
Après un dépucelage tardif mais hautement apprécié de Jane Austen dernièrement, j'ai décidé de goûter dans la foulée à ma première austenerie. C'est Alice du site Jane Austen is my wonderland (et aussi du blog Books are my wonderland car, quand on aime, on ne compte pas!) qui m'a offert cette opportunité grâce au concours pour fêter les cinq ans de sa plateforme austenienne. Merci Alice !
Une saison à Longbourn de Jo Baker se saisit de la résidence des Bennet d'Orgueil et préjugés (comme le titre l'indique, n'est-ce pas) et invite le lecteur à descendre d'un étage. Ce ne sont plus Lizzy, Jane ou Lydia dont il est abondamment question dans ce roman mais de ces autres personnages de l'ombre à peine ébauchés dans l’œuvre source : les domestiques. On se rappelle bien avoir lu régulièrement chez Austen Mrs Bennett crier "Hiiiiills" à tous bouts de champ (ou plutôt l'entendons-nous dans la série de la BBC ? Je m'y perds) mais jamais on ne la voit longuement, jamais elle ne parle ni n'est décrite. Qu'à cela ne tienne ! C'est là que Jo Baker entre en action. Aux côtés de la respectable et travailleuse intendante évoluent Sarah, une jeune femme pleine de passion et de révolte d'avoir connu un bonheur dont elle est aujourd'hui privée ; la petite Polly encore enfant et déjà corvéable dès l'aube ; et enfin James Smith, le nouvel arrivant au titre de valet dont la caractéristique principale est d'attiser les interrogations de Sarah et de raviver quelques souvenirs de Mrs Hills. Ainsi, en parallèle des idylles et autres péripéties des maîtres, vont se nouer - non à l'identique mais toujours avec une forte inspiration en forme de gentil hommage - les idylles et péripéties des serviteurs

A travers le quotidien de ces personnages, Jo Baker découvre en outre les coulisses de la plus célèbre histoire de la littérature anglaise du XIXème siècle. Tout cela n'est plus si poli, si lisse et si délicat dans Une saison à Longbourn ! Exemple au hasard : les balades dans la boue de Lizzy, expression si éclatante de son indépendance dans O&P deviennent celle d'une forme de mépris des maîtres à l'égard du travail des domestiques : cette fameuse boue est la hantise de Sarah qui se voit obligée de frotter les jupes pendant des heures avant d'en rendre le moindre éclat. Si Lizzy est parfaite et parfaitement moderne, elle est surtout une jeune fille de son rang qui ne s'intéresse qu'occasionnellement et quand elle le veut bien au sort de ceux qui gravitent dans son ombre. Et que dire de de tous les à-côtés d'une vie sans confort ni hygiène à cette époque ? Entre les jours de lessives, la corvée des pots de chambre le matin ou celle des couches des petits Gardiner, on a droit à un vrai florilège de délices entre la cour et la cuisine des Bennet !
Globalement, j'ai plutôt apprécié tout cet envers du décor : on en apprend souvent autant qu'en admirant la surface ! Le roman de Jo Baker se lit très facilement et avec plaisir. Je n'ai pas été gênée par d'éventuelles longueurs sur les différentes tâches - parfois répétitives - de Sarah ou de James car, précisément, c'est ce quotidien que je trouve le plus intéressant dans l'exercice de cette austenerie. Les histoires personnelles plus ou moins cousues de fil blanc (soyons francs) qui se nouent entre eux m'ont beaucoup moins touchée. A cet égard, c'est là qu'on voit l'exercice périlleux de l'austenerie : se confronter, de près ou de loin, à un monstre de la littérature, c'est tout de même prendre le risque que la comparaison ne soit pas en sa faveur. Et de loin. (Oui, j'enfonce des portes ouvertes mais rappelons que c'est ma première lecture du genre) En l'occurrence, là où Jane Austen contournait voire enfonçait les poncifs de la romance à l'eau de rose grâce à une ironie à tous niveaux extraordinaire, Jo Baker en manque cruellement. Du coup, les personnages comme leurs histoires manquent de relief et de véritable intérêt. D'un côté, nous avons donc un chef d'oeuvre, de l'autre, un roman de plage. Ce n'est pas un mal cela dit, il en faut pour tous les moments de lecture et, cette semaine, j'ai grandement apprécié ma lecture de plage (qui s'est transformée en lecture de plaid). Il faut simplement savoir ce qu'on lit, voilà tout !
Mille mercis à Alice et aux éditions Stock pour cette découverte !
17:11 Publié dans Classiques, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (12)




