21/08/2018
Anna Karénine de Léon Tolstoï
 Je termine à l'instant Anna Karénine qui m'aura tenu un bon mois - quasiment tout l'été. Ce roman-là, cet été-là, était autant une envie qu'un défi et ce ne fut pas sans difficultés.
Je termine à l'instant Anna Karénine qui m'aura tenu un bon mois - quasiment tout l'été. Ce roman-là, cet été-là, était autant une envie qu'un défi et ce ne fut pas sans difficultés.
Dans un cas comme celui-ci, je laisse souvent maturer un peu mes idées avant de rédiger un billet, ne serait-ce que quelques jours : on ne chronique pas un grand classique comme le premier roman venu, n'est-ce pas ? Mais présentement, il me semble avoir déjà vécu si longtemps dans la compagnie de ce livre tentaculaire qu'il est temps que sorte ce qu'il m'inspire. Ça vaudra ce que ça vaudra.
On a coutume de résumer Anna Karénine, et le titre n'est pas pour rien dans cette méprise, au roman d'un adultère passionné. C'est certes cela, mais pas seulement. Anna Karénine, beauté magnétique, sobre et envoûtante, n'apparaît qu'après une première centaine de pages (le roman en compte pas loin de 1000). Son rôle, à ce moment-là, se résume à rappeler sa belle-soeur Dolly à la raison lorsqu'elle menace de quitter son mari infidèle, le frère d'Anna - et ce n'est que le premier clin d’œil de l'auteur à la suite des événements. A cette occasion, Anna subjugue tout le monde par son naturel, sa simplicité et son charisme. Elle n'est pas de ces héroïnes coquettes et superficielles. Elle a conscience de son charme et de son pouvoir de séduction, indéniablement, car elle n'est pas non plus de ces héroïnes naïves et éthérées, mais elle se caractérise surtout par une incroyable profondeur. Anna Karénine est toute de chair et d'intelligence. Elle incarne, dès le début du roman une personnalité extrêmement intense et intègre. En un mot : dense. C'est ce qui électrise tout le monde, homme comme femme. Ainsi séduit-elle Kitty, la jeune soeur de Dolly, amoureuse de Vronskï, puis Vronskï lui-même lors d'un bal. Vous connaissez la suite : c'est le coup de foudre. Voulant fuir le danger d'une telle flamme, Anna se précipite à la gare pour rentrer à Pétersbourg mais y rencontre à nouveau Vronskï en une circonstance effroyable qui sonne déjà le glas de leurs futures relations.
"Non, ils veulent nous apprendre à vivre et ils n'ont pas même l'idée de ce que c'est que le bonheur. ils ne savent pas qu'en dehors de cet amour il n'y a pour nous ni bonheur ni malheur : la vie n'existe pas !"
Longtemps Anna résiste mais lorsqu'elle se donne, c'est entièrement, sans compromission ni faux-semblant. Un personnage dit d'elle à cet égard à la fin du roman qu'"[e]lle a fait ce que toutes les femmes [...] font en se cachant ; elle n'a pas voulu mentir, et elle a bien fait." Concrètement, aux yeux de la société, sa décision n'est pas du meilleur effet. Dès lors qu'elle fuit avec Vronskï, Anna est persona non grata. Il n'est plus question qu'elle sorte - sa seule tentative à l'opéra est d'une violence psychologique assez inouïe - et il n'est plus question non plus pour la plupart des gens, surtout pour les femmes, de la visiter (des fois que l'adultère serait contagieux). Anna s'enferre dans une solitude qui vire à l'aigre un peu plus chaque jour. Vronskï, évidemment, est toujours libre comme l'air. Il sort, on le reçoit, il s'occupe d'administrer ses domaines, se lance dans divers projets et ne comprend pas l'attitude d'Anna qui, comme un fauve en cage, commence sérieusement à devenir oppressive et jalouse. Cette passion, comme toute passion qui se respecte, vécue qui plus est dans un contexte aussi confiné, se meut peu à peu en poison au quotidien. Ni l'un ni l'autre ne comprend le sacrifice de l'aimé et se rabâche la servitude de sa propre condition. Anna, n'y voyant aucun issue sinon d'être laissée pour compte tôt ou tard, saisit la tragique échappatoire qu'on connaît.
Durant ma lecture, il m'a semblé souvent que j'étais déjà trop vieille pour ce roman. Les prémisses de la passion amoureuse ne m'ont pas emballée comme cela aurait pu être le cas il y a quelques années. Aussi suis-je restée très froide aux passages concernant Anna et Vronskï pendant près de 500 pages - et je peux vous dire que c'est long. Mais à partir de la rupture d'Anna avec son mari et la fuite avec l'amant, la finesse psychologique et sociale m'a captivée. Anna Karénine est décidément un roman ancré dans son époque et dans la culture slave. Nombreuses sont les tergiversations relatives au divorce par tous les personnages concernés, les interrogations sur les conséquences d'une telle décision, l'autopsie des sentiments amoureux et maternels ; les questions de la société, de l'honneur, de la carrière et de l'argent sont aussi lancées sur le tapis. Durant ces passages, Anna m'est apparu extrêmement moderne dans son besoin d'affirmer sa liberté et son amour et, conséquemment, extrêmement courageuse. J'ai alors éprouvé pour elle une compassion profonde dans l'agonie morale qui accompagne ses derniers mois. Seule avec son courage, emprisonnée par sa passion comme une condamnée recluse, elle ne pouvait que flancher tôt ou tard. Peut-on, pour autant, tenir Vronskï responsable de son attitude de plus en plus distante et agacée face à une Anna hystérique et malheureuse ? Il a fait comme on aurait tous fait : à un moment donné, l'instinct de survie reprend le dessus et les sentiments qu'on a éprouvés jadis ne sont plus suffisants quand le quotidien vire à l'enfer. Anna aurait voulu que Vronskï s'impose lui-même les privations que la société imposait à Anna mais le pouvait-il seulement ? Aurait-ce vraiment été profitable ?
Il ne savait pas que Lévine se sentait pousser des ailes. Lévine savait que Kitty l'écoutait, qu'elle prenait plaisir à l'écouter ; et rien en dehors de cela ne l'intéressait. Dans cette pièce, et même dans le monde entier, il n'y avait que lui et elle. Il avait la sensation de se trouver à une hauteur vertigineuse tandis qu'en bas, très loin, se trouvaient ce bon et charmant Karénine, Oblonskï et tout le reste de la société.
En parallèle de cette passion, Tolstoï relate la naissance - qu'on pense initialement avortée - d'un amour beaucoup moins flamboyant, bien qu'aussi passionné du côté de l'un des protagonistes, entre Lévine et Kitty. Celle-ci, après avoir été délaissée par un Vronskï qu'elle pensait proche de la demande en mariage, ne se remet finalement pas d'avoir refusé Lévine. Les deux personnages durant de longs mois vivent, réfléchissent, évoluent. Lévine incarne l'aristocrate propriétaire terrien qui administre son domaine avec sérieux et intérêt. Il est réservé en société mais habité d'une flamme particulière pour tout ce qui touche à la terre - en cela, le frère d'Anna, Stepan Oblonskï est son parfait opposé, parangon de l'aristocrate mondain, noceur, et superficiel. Lévine n'hésite pas à travailler avec les paysans aux champs, malgré les moqueries d'une telle attitude. Le servage a été aboli peu de temps avant le début du roman. Tolstoï y glisse de nombreuses réflexions quant au devenir de la classe paysanne et à l'amélioration des conditions de travail. La question du peuple, de manière plus large, est également très présente par l'entremise du frère aîné de Lévine : "Chaque membre de la société est appelé à accomplir une certaine besogne, suivant ses moyens. Les hommes de la pensées remplissent leur tâche en exprimant l'opinion publique. L'expression unanime et complète de l'opinion publique fait le mérite de la presse ; et cela, de nos jours, constitue un phénomène très heureux. Il y a vingt ans, nous nous haïssions ; mais maintenant on entend la voix du peuple russe. Il est prêt à se lever comme un seul homme, à se sacrifier pour ses frères opprimés. C'est un grand pas et un signe de force." (On est en 1877 hein... C'est quand même sacrément prémonitoire.)
L'amour entre Lévine et Kitty grandit progressivement, se nourrit de joies simples et n'échappe pas aux tracas et aux brouilles du quotidien. Leur mariage n'est pas un long fleuve tranquille mais, tandis que la passion entre Anna et Vronskï se détériore, l'amour de Kitty et Lévine se renforce par la naissance d'un enfant qui perpétuera le nom. C'est le déclencheur, chez Lévine, d'une crise métaphysique dont l'ultime partie du roman, tandis qu'Anna est déjà morte, est l'acmé. Celui qui a toujours été athée s'interroge sans cesse sur le sens de la vie et sur cette terreur ontologique que cristallisent la naissance et la mort : la finitude humaine. La philosophie qu'il compulse longtemps ne lui apporte nul réconfort ; et c'est dans la foi qu'il finit par le trouver. Ces pérégrinations spirituelles qui tomberont sûrement des mains de beaucoup, m'ont beaucoup intéressée. Elles reflètent une problématique très présente dans la littérature russe de cette époque et, de manière générale, très présente chez l'homme : la quête du sens. Quelle que soit la réponse qu'on lui apporte, si toutefois on finit par lui en apporter une, ce me semble être, finalement, la question fondamentale de toute existence. Où cours-je, où vais-je, dans quel état j'erre ?
"Ce nouveau sentiment, de même que le sentiment paternel, ne m'a pas changé, ne m'a pas rendu heureux, ne m'a pas éclairé d'un coup, ainsi que je l'avais cru ; il n'y eut aussi aucune surprise. La foi, le manque de foi, je ne sais ce que c'est ; mais ce sentiment est entré imperceptiblement dans mon âme, par la souffrance, et s'y est installé solidement."
Franchement, lire ce livre ne fut pas de tout repos. Contrairement à beaucoup de consœurs blogueuses, je n'ai pas trouvé qu'il se lisait facilement malgré les longueurs ; je n'ai pas non plus éprouvé de passion dévorante, telle Anna, qui m'aurait donné envie de le lire d'une traite. J'ai même ressenti un mal de chien à arriver au bout de certains passages, intéressants dans l'absolu mais longs, terriblement longs, tentaculaires, digressifs, qui m'emmenaient à mille lieux d'un rivage que j'espérais atteindre la page suivante. Le découragement m'a souvent saisie et je bénis le dieu de la lecture en diagonale de m'avoir dotée d'une aptitude suffisante en la matière pour ne pas abdiquer définitivement. Et entre ces affres-là, que les grands classiques russes ont souvent la vertu de provoquer (spéciale dédicace aux Frères Karamazov que je n'ai jamais réussi à finir malgré tout mon acharnement), j'ai aussi découvert des passages et des réflexions d'une finesse, d'une justesse et d'une sensibilité lumineuses. Anna Karénine est le roman total par excellence. Toute la gamme des sentiments autant que la société, la politique et la spiritualité s'y mêlent avec brio ; tant, en somme, il brasse toute la comédie humaine avec une créativité et une exhaustivité impressionnantes.
Alors, c'est vrai, j'en ai chié mais je ressors malgré tout soufflée par le génie d'une telle entreprise.
Par ici, le billet de Lilly qui a sensiblement fait la même lecture que moi.
17:58 Publié dans Classiques, Littérature slave, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : anna karénine, léon tolstoï, pavé, pavé de l'été, russie, histoire, xixème, amour, passion, jalousie, mort, suicide, réflexion, spiritualité, métaphysique, politique, moscou, pétersbourg, train
01/06/2018
Testament à l'anglaise de Jonathan Coe
"Laissez-moi vous donner un avertissement sur ma famille, au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, dit-il enfin. C'est la pire bande de salauds, de rapaces, de voleurs, d'escrocs, de traîtres, de criminels, qui ait jamais rampé sur le sol terrestre. Et j'y inclus mes propres rejetons."
L'événement fondateur de ce roman est le suivant : Godfrey est mort. C'était en 1942 lors d'une mission secrète au-dessus de Berlin. Alors qu'il volait, son avion fut abattu par un tir allemand - et ç'aurait pu être la fin de l'histoire ou, éventuellement, le début d'un roman de guerre comme on en connaît beaucoup si l'auteur n'était pas Jonathan Coe. Rien de tout cela ici car entre à son tour en jeu le personnage qui va tout chambouler : la soeur de Godfrey, Tabitha. Celle-ci refuse de voir dans cette tragédie un événement banal de la guerre et accuse son frère aîné Lawrence du meurtre de son cadet. Vous imaginez le tollé. Entre stupéfaction générale, dénégations méprisantes de Lawrence et théories conspirationnistes, Tabitha est internée dans un établissement psychiatrique duquel elle ne sortira qu'épisodiquement. Cela ne l'empêche pas de ruminer âprement la situation et n'entache en rien sa certitude de la culpabilité de son frère. Une démonstration flagrante en est d'ailleurs faite quelques dizaines d'années plus tard, tandis qu'elle bénéficie d'une sortie exceptionnelle pour les cinquante ans du benjamin de la fratrie, Mortimer.
Entre parallèlement en scène Michael Owen, écrivain blasé et inactif bien peu séduisant. L'époque a changé : nous sommes en 1990. Il a la quarantaine solitaire et négligée, ne sort plus de chez lui et n'interagit plus avec ses semblables. Quelques années auparavant, en 1982 exactement, il avait été débauché par la Peacock Press sur injonction d'une Tabitha vieillissante mais toujours obnubilée, pour raconter l'histoire de la tonitruante famille Winshaw. La fratrie d'origine n'était déjà pas géniale mais alors les rejetons, une tripotée de cousins arrivistes et cyniques, décrochent la timbale. Alors que Michael avait totalement lâché le projet, l'intervention inopinée d'une voisine va le motiver à se plonger à nouveau dans ses premiers travaux de recherche. En alternance avec la vie passée, présente et future de ce quadra auquel on s'attache finalement, le lecteur découvre tour à tour chacun des cousins Winshaw, exploitant tous un filon lamentable de notre société contemporaine capitaliste. Qui la télévision, l'art contemporain, la politique ou l'agriculture : tout y passe avec une acuité aiguë et une ironie cinglante de haute volée.
J'ai également pris une ferme décision pour le mot "hôpital". Ce mot est exclu de nos discussions : nous parlons désormais d'"unités pourvoyeuses". Car leur seul but, dans le futur, sera de pourvoir à des services qui leur seront achetés par les autorités et par les médecins en vertu de contrats négociés. L'hôpital devient un magasin, les soins deviennent une marchandise, tout fonctionne selon les règles des affaires : produire beaucoup, vendre bon marché. La magnifique simplicité de cette idée m'émerveille.
J'ai adoré ce roman mais c'est presque délicat de l'avouer. Une part de moi, indéniablement, a savouré cette tendance typiquement anglaise d'appuyer là où ça fait mal avec le sourire. Testament à l'anglaise est un exemple de situations parfois absurdes, souvent inattendues, convergeant toutes vers une des plus grosses gifles littéraires désinvoltes de la fin du XXème siècle. Une autre part de moi, pourtant, a beaucoup de mal à se réjouir de cette satire quand tout, absolument tout, ce qui est dévoilé est vrai et, surtout, quand tout cela se poursuit dans la même direction vingt-cinq ans après la première parution du roman. C'est véritablement terrifiant. Aussi, mes scrupules ne tiennent pas à la qualité du roman, qui est excellente, mais plutôt au propos qui fait froid dans le dos. Jonathan Coe lève le voile sur l'époque Thatcher avec tellement de pertinence, de légèreté et d'originalité que cela relève du sacré tour de force (j'allais écrire génie, hésitant sur le mot, le trouvant peut-être trop fort ? N'empêche que si ce n'est pas le cas, on n'en est vraiment pas loin).
En parlant de tour de force, je ne vous ai encore pas dit grand chose de la forme. J'évoquais tout à l'heure l'alternance des récits. Lorsqu'on entame le roman, on commence par se perdre un peu dans toute la galerie des personnages Winshaw (merci à l'éditeur de fournir gracieusement un arbre généalogique, d'ailleurs!) puis on attaque franchement dubitatif l'existence de Michael Owen. On se dit pendant un bon paquet de pages qu'on a un roman bien écrit sur ce principe assez classique de récits parallèles. C'est évidemment une erreur. Le roman est un puzzle. Peu importe à quel point cette métaphore est éculée ; elle convient trop bien à la construction narrative brillante de l'intrigue. Les récits alternés sont des leurres simplistes à l'intérieur desquels se cache en fait une myriade d'indices - a priori anecdotiques - qui se répercutent au fil du récit sous forme d'échos et dévoilent tous, progressivement, une part du mystère. On ne prête pas forcément attention à la première résonance, puis la deuxième interpelle, enfin la troisième rend le lecteur attentif aux moindres détails. Lorsqu'on en arrive à cet instant de la lecture, on est irrémédiablement scotché à la suite de l'histoire qui se referme comme un piège sur tous et tout.
"Poignardé dans le dos, hein ? dit sèchement Hilary. C'est bien approprié. Est-ce que cela veut dire que Mrs Thatcher est quelque part dans la maison ?"

 Le mois anglais chez Lou et Cryssilda + Lecture commune du Blogoclub
Le mois anglais chez Lou et Cryssilda + Lecture commune du Blogoclub
15:50 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Lecture commune, Littérature anglophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (28) | Tags : jonathan coe, testament à l'anglaise, what a carve up, politique, thatcher, agriculture, presse, édition, art, satire, ironie, critique, angleterre, écriture, écrivain, création, mois anglais, lecture commune, blogoclub
02/05/2018
Les cloches de Bâle de Louis Aragon
Le monde est une machine sanglante à laquelle les êtres se déchirent comme des doigts arrachés.
Lorsque j'étais à la fac (je ne veux pas compter les années), j'ai adoré Aurélien. Je connaissais déjà Aragon comme poète, certes, mais Aurélien fut ma première rencontre saisissante avec le romancier. A l'époque, je me suis promis de continuer à le lire, à m'en délecter... et, comme souvent avec les classiques qui promettent d'être sacrément magiques mais aussi sacrément costauds, je ne l'ai pas fait (ou presque). J'aurais pu continuer à procrastiner longtemps comme ça sans le récent billet de Nathalie sur le dit-roman et la discussion qui a suivi. Et si nous continuions l'oeuvre romanesque de l'auteur ? Et si, pour une fois, on ne s'arrêtait pas à Aurélien ? Le rendez-vous fut pris pour aujourd'hui, sans plus de tergiversations, chacune avec un titre différent. Pour ma part, l'envie était forte d'en revenir aux sources du cycle du Monde réel dont Aurélien est le quatrième tome. Les cloches de Bâle s'est donc imposé de lui-même. Et comme le disent si joliment les mots magiques d'Aragon:
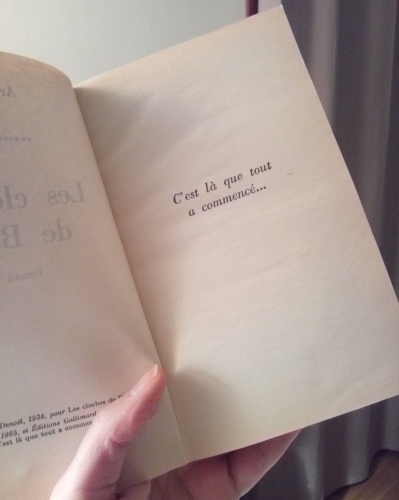
Se dessine d'emblée la dynamique du roman à travers sa construction : quatre parties, de tailles inégales, pour quatre personnages emblématiques de la Belle Epoque.
Diane de Nettecourt est une jeune noble désargentée et divorcée au début du roman. Elle incarne l'ambitieuse sociale, passant d'homme en homme malgré ses engagements dès l'instant que le suivant est plus avantageux que le précédent. Elle finit par se marier avec un certain George Brunel, financièrement très séduisant, grâce à qui elle peut mener à loisir une existence bourgeoise aussi luxueuse que vaine. Quel dommage qu'une sombre histoire de suicide vienne révéler la pathétique nature d'usurier sans scrupule de son époux...
Nous sommes des parasites. Pourquoi ne pas l'avouer ? Il n'y a là rien qui me choque. En quoi est-il mieux d'être la bête qui a des parasites, que le parasite sur le dos du bétail ? Pour moi, je pense tout au contraire que c'est là ce qui s'appelle la civilisation.
Sans transition, on passe à Catherine Simonidzé, fille d'une demi-mondaine de l'acabit de Diane (le remariage et la particule en moins ; le statut d'étrangère en plus). Catherine a vécu une première partie de son enfance dans l'opulence, tant que sa mère était suffisamment belle pour avoir plein d'amants. Et puis, du jour au lendemain, sa beauté s'est défraîchie et les amants sont partis. Puisqu'il n'a jamais été question, ni pour la mère, ni pour Catherine de travailler (faut quand même pas pousser mémé), le quotidien s'est fait plus dur et Catherine en a nourri un ressentiment violent à l'encontre des hommes et de la servitude qu'ils imposent aux femmes. Catherine se veut libre et libérée du joug social qu'on impose à son sexe. Ainsi, elle refuse le mariage, plonge à corps perdu dans les jeux de séduction divers et se lie à l'idéologie anarchiste en ce qu'elle lui semble le mieux servir sa cause. Catherine est cependant un personnage pétri de contradictions, réalisant peu à peu au fur et à mesure des années la fragilité de ses convictions si peu éprouvées à la dureté de la vie (elle n'a jamais travaillé, rappelons-le, parce qu'aussi furibarde qu'elle soit à l'égard de la domination masculine, elle préfère gentiment toucher le chèque de papa tous les mois plutôt que d'aller bosser elle-même. Lalalaaaa).
Catherine ne se faisait aucune idée de ce qu'est la journée de travail. C'est peut-être ce qui sépare avec la plus grande netteté la bourgeoisie du prolétariat. Les bourgeois parlent avec abondance de ceux d'entre eux qui travaillent. Mais le travail au bout duquel la subsistance n'est pas seule assurée, le travail dont on ne sort pas avec juste le temps nécessaire pour récupérer les forces de la journée de travail du lendemain, le travail de celui qui possède, en un mot, de celui qui amasse ne peut être comparé au travail ouvrier que par l'effet d'un abominable jeu de mots.
De cela, elle prend pleinement conscience en rencontrant Victor, le troisième personnage du roman et seul homme à incarner une partie. Victor est chauffeur de taxi et fortement engagé dans la lutte socialiste pour l'amélioration des conditions de travail des ouvriers. Catherine débarque dans sa vie au moment d'une grève des chauffeurs parisiens qui durera plusieurs mois. Il fait pénétrer la jeune féministe anarchiste dans cet univers qu'elle a toujours méprisé.
L'acmé de cette évolution s'incarne en Clara Zetkin, femme politique socialiste majeure du début du XXème siècle et figure tutélaire de la dernière partie, très courte, du roman. Elle est, pour Aragon, la femme des temps modernes. Celle qu'il a choisi de chanter.
Elle est la femme de demain, ou mieux, osons le dire : elle est la femme d'aujourd'hui. L'égale. Celle vers qui tend tout ce livre, celle en qui le problème social de la femme est résolu et dépassé. Celle avec qui tout simplement ce problème ne se pose plus. [...] Maintenant, ici, commence la nouvelle romance. Ici finit le roman de chevalerie. Ici pour la première fois dans le monde la place est faite au véritable amour. Celui qui n'est pas souillé par la hiérarchie de l'homme et de la femme, par la sordide histoire des robes et des baisers, par la domination d'argent de l'homme sur la femme ou de la femme sur l'homme. La femme des temps modernes est née, et c'est elle que je chante.
Et c'est elle que je chanterai.
Honnêtement, j'ai lutté durant toute la première partie du roman. Peut-être la merveilleuse préface des mains de l'auteur, dans laquelle il retrace la genèse du texte commencé comme un jeu surréaliste, m'a-t-elle un brin conditionnée ? En tous les cas, j'ai peiné à comprendre où l'auteur voulait en venir avec cette existence décousue de Diane, pleine de personnages divers et variés, tous plus vains les uns que les autres, et où le style lui-même saute d'un registre à l'autre, d'un discours à l'autre. On ne s'attache à personne, le sens du texte se dérobe sous les mots. C'était franchement fastidieux.
Et puis, les pièces du puzzle se mettent en place avec Catherine. Ce roman, au fond, c'est le grand virage du vingtième siècle vers notre société contemporaine. C'est la mort d'une société et la naissance d'une autre : la remise en question de la place de la femme et, conséquemment, la redéfinition des rapports homme/femme ; l'émergence de nouveaux mouvements politiques majeurs menés par des idéaux sociaux ; la conquête de libertés chéries et les contraintes qu'elles occasionnent ; une réflexion sur la place et les enjeux du travail dans la société. Ce moment où l'ordre ancien est mis à mal et où tout appelle à un nouveau souffle, un nouvel équilibre. Diane, Catherine, Victor, Clara : à eux quatre, ces personnages sont la Belle Epoque ; ils sont les quatre faces du branle du nouveau siècle. Et puis, le roman se clôt en 1912, avant la déflagration ultime : celui de la Première Guerre Mondiale. La suite au prochain numéro, Les beaux quartiers, qui réattaque exactement en 1912. A voir quelle continuation il propose.
Malgré un départ pénible, me voilà ravie d'avoir découvert ce roman sacrément riche. Il me semble avoir perçu avec ce texte, encore plus qu'avec Aurélien (mais sans doute que mes quelques années de plus - je refuse toujours de les compter - m'y aident) le génie de la construction complexe qu'était Aragon. Une foule de personnages se croisent au fil des parties, les décors s'enchaînent et se retrouvent savamment à propos, les dialogues et la narration sont d'une virtuosité assez incroyable sous des abord faussement désinvoltes, et tout, absolument tout, converge dans une perspective précise et affûtée. Les cloches de Bâle, c'est un peu la magie du kaléidoscope, en beaucoup plus politique. C'est ardu, ce n'est pas gagné, mais il impose sans concession Aragon comme un grand romancier. Bref, ce roman gagne à être lu - et, surtout, ne manquez pas de vous délecter en amont de la préface dans laquelle l'éloge qu'il fait du roman est tout simplement merveilleux ♥
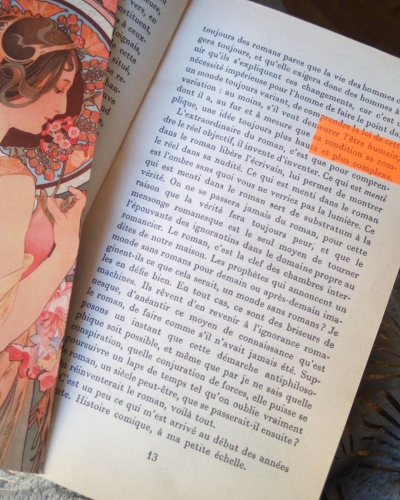
Le billet de Nathalie sur Blanche ou l'oubli est par ici.
10:29 Publié dans Classiques, Histoire, Lecture commune, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : les cloches de bâle, louis aragon, destin de femmes, diane, catherine, victor, clara, anarchisme, communisme, politique, émancipation, début de siècle, xxème siècle, guerre, amour, liberté, travail, socialisme, premier roman, cycle du monde réel




