17/09/2020
Sur un air de navaja ou The Long Goodbye de Raymond Chandler

Philip Marlowe est LE détective privé de roman noir par excellence : chapeauté, solitaire, à moitié alcoolique et toujours dans les plans foireux. L’affaire de ce roman-ci, d’abord titré Sur un air de navaja puis réédité sous son titre original The Long Goodbye, ne déroge pas à la règle.
Philip Marlowe, donc, rencontre un soir Terry Lennox, espèce d’épave complètement avinée, qui vient de se faire éjecter d’une voiture par sa compagne. Ça s’engage à l’évidence assez mal pour ce jeune homme aux cheveux prématurément blancs et Philip Marlowe décide de jouer les bons samaritains en lui portant secours. De fil en aiguille, les deux hommes lient connaissance et prennent régulièrement l’apéro ensemble – c’est-à-dire très régulièrement et quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit - non parce qu’on va quand même se lester de préoccupations d’ordre alcoolémique. Comme c’était prévisible, au bout d’un certain temps, Terry Lennox à moitié dépressif, se colle salement dans le pétrin et appelle Philip Marlowe à l’aide, qui répond encore une fois présent. A partir de là, c’est le début d’un grand n’importe quoi où un suicide puis deux forcent Marlowe, très désabusé – si seulement on pouvait lui foutre la paix, c’est à peu près tout ce qu’il demande - à aller faire ce qu’il fait de mieux : fourrer son nez dans le linge sale d’autrui pour démêler le vrai du faux.
Sans l’ombre d’une ambiguïté, on est jusqu’aux genoux dans le parfait polar noir américain des années 30 à 60 – celui-ci est paru en 1954 : le détective privé coche toutes les attendus du genre, comme je vous le disais un peu plus haut, Los Angeles apparaît à la fois comme la ville de tous les feux et de toutes les bassesses, les flics sont des ordures finies, tout le monde picole et les personnages féminins sont des sosies flamboyants et vénéneux de Veronica Lake. Ce genre-là, définitivement, une de mes friandises littéraires préférées. C’est codifié, cynique et désabusé à souhait, à l’image du détective narrateur qui est au bout de sa vie du début à la fin. Dès la première page, on est projeté par on ne sait quelle autosuggestion magique dans l’atmosphère enfumée d’un bar louche qui joue du jazz et c’est absolument jouissif de lire ainsi les chapitres, rythmés par un solo de saxophone imaginaire qui ne nous quitte plus. C’est purement et simplement la carte postale fantasmée d’une époque qui n’existe que dans un coin de notre imagination et le cinéma. A cet égard, si vous ne le savez pas, Marlowe a été immortalisé sur la toile par le génialissme Humphrey Bogart et, forcément, c’est délicieux comme une larme de tabasco dans un shot de Tequila.
Je ne saurais vous en dire beaucoup plus sans déflorer toute l’intrigue qui est ici particulièrement bien troussée. J’ajouterais tout de même cependant qu’une des grandes qualités qui fait de Raymond Chandler un des maîtres absolus du polar noir est son ironie critique magistrale. Il sait qu’il reprend des poncifs éhontés – Dashiell Hammet, entre autres, est passé bien avant lui – et il n’essaye pas de nous les faire avaler tels quels. Il s’amuse beaucoup de ces clichés qu’il infuse jusqu’à plus soif et cela crée, pour le lecteur averti qui connaît ces codes, une distanciation ironique bienvenue pour s’amuser de sa lecture. Avouez que, pour le coup, c’est quand même la cerise sur le gâteau !
Roman précédemment chroniqué de Raymon Chandler : Le grand sommeil
 Le mois américain chez Titine
Le mois américain chez Titine
Journée polar/roman noir/thriller
07:00 Publié dans Challenge, Classiques, Littérature anglophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : sur un air de navaja, the long goodbye, raymond chandler, roman noir, polar, philip marlowe, enquête, meurtre, suicide, détective privée, le mois américain
12/09/2020
Little women & Good wives de Louisa May Alcott
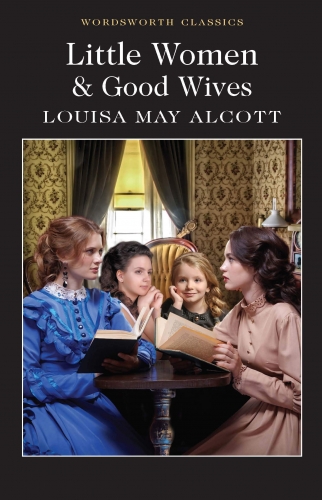 Certains le savent, je me suis lancée cette année avec Fanny le défi de me remettre à la lecture en anglais, pratique que que j'avais complètement jetée aux oubliettes depuis plus de quinze ans. Little women a été le premier roman à essuyer les plâtres de ce projet en janvier et j'ai goûté avec plaisir ce retour à une de mes madeleines de Proust littéraires.
Certains le savent, je me suis lancée cette année avec Fanny le défi de me remettre à la lecture en anglais, pratique que que j'avais complètement jetée aux oubliettes depuis plus de quinze ans. Little women a été le premier roman à essuyer les plâtres de ce projet en janvier et j'ai goûté avec plaisir ce retour à une de mes madeleines de Proust littéraires.
Mon véritable objectif, à dire vrai, en relisant ce roman en début d'année était d'en arriver à Good Wives, le deuxième volume de la saga des soeurs March (j'ai découvert pour l'occasion qu'elle en compte 4 ; Little men et Jo's boys se déroulent quelques années plus tard). Je n'avais jamais eu le plaisir de lire la suite de Little Women puisque je ne l'avais jamais trouvée traduite en français (elle l'est à présent). Et quelle meilleure occasion pour me livrer à cette découverte très enthousiaste que le mois américain de Titine ?
Pour ce qui est du résumé de Little Women et Good Wives, je vous la joue courtissime, puisque ces deux titres ont été abondamment portés à l'écran - spéciale dédicace aux versions cinématographiques de 1994 et de 2019, excellentes toutes deux. Little women, donc, raconte le quotidien de quatre soeurs : Meg, Jo, Beth et Amy, et de leur mère durant la guerre de Sécession, tandis que le père - qui n'est absolument pas docteur mais homme de foi, je ne sais quelle moquette ont fumé les traducteurs sur ce coup-là - est parti prêcher la bonne parole aux soldats. Dans Good wives, nous retrouvons les mêmes personnages trois/quatre ans plus tard grosso modo dans leurs vies de jeunes femmes et nous suivons leurs aspirations et leurs évolutions diverses : l'écriture pour Jo, l'art pour Amy, le mariage et la maternité pour Meg et les questionnements amoureux pour toutes.
Première remarque avant tout, qui m'a marquée lors de ma lecture de Little Women : comme beaucoup de classiques étrangers (une pensée particulière pour Jane Austen), ce roman-là souffre indéniablement de nombreuses sapes dans ses traductions françaises pourtant considérées comme intégrales. Il n'y a qu'à voir la taille des ouvrages : 250 pages pour la VF / 400 pages pour la VO et je juge bien évidemment à l'aune d'éditions de formats similaires, de même pour la taille de police et l'interligne.
Alors, qu'est-ce qui est passé à la trappe, exactement ? Et bien clairement, en priorité, la portée morale de l'ensemble, extrêmement présente dans le texte original, et pas des plus subtile. Il y est bien fait mention dans les éditions soit-disant intégrales des Quatre filles du docteur March mais c'est tellement édulcoré que ça passe crème sans qu'on s'en aperçoive vraiment, or, c'est tout de même un bon morceau du récit. Honnêtement, malgré tout, dans Little women, je l'ai plutôt bien vécu et l'ai intégré au fil des pages comme un élément historique. Aussi indépendante que fût Louisa May Alcott, elle était indéniablement une femme de son temps et de sa culture. Par contre, certains passages de Good wives m'ont complètement atterrée, malgré une remise dans le contexte. On est à des kilomètres de ce qu'on pourrait imaginer d'une auteure qui s'est battue pour l'émancipation des femmes, entre autres. Tout au contraire, dans ce roman, les chapitres consacrés à Meg sont effroyablement conformistes, même pour l'époque, et écrits sans l'once d'un second degré - c'est bien là tout le problème et ce qui fait que ces passages périmés ne passent pas du tout aux yeux du lecteur contemporain. Qu'on soit clairs : Louisa May Alcott ne dénonce rien quand elle explique le rôle de l'épouse et mère à travers le personnage de Meg et franchement, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi indigeste. Notez que cela dit, cela constitue un très bon exemple littéraire pour illustrer la société conservatrice et puritaine américaine du milieu du XIXème siècle...
Cela mis à part, j'ai beaucoup aimé découvrir les quatre soeurs plus amplement, et notamment Amy qui tient une place presqu'aussi importante que celle de Jo sous la plume de Louisa May Alcott - autre élément qui a joliment été sapé dans les versions françaises. Merci, au passage, à Greta Gerwig de lui avoir redonné sa vraie place dans son film. Jo et Amy, bien que très différentes du point de vue du caractère, sont également passionnantes par leurs envies d'amour, d'art et d'indépendance à la fois. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le coeur de Laurie balancera de l'une à l'autre au fil des deux romans. Ce triangle amicalo-amoureux, de même que les relations sororales sont crédibles et extrêmement touchantes. Dans Good wives, la problématique de la création littéraire sera particulièrement développée et l'on voit Jo évoluer dans sa pratique, dans ses relations aux éditeurs - autre détail mis en exergue par Greta Gerwig qui, décidément, je le découvre en refermant Good wives, a sans doute réalisé la version la plus fidèle des deux premiers tomes de la saga - et dans le choix de ses sujets d'écriture. Au cours de ce roman-là, elle commence d'ailleurs à écrire Little women, peu de temps après le décès de Beth. La mise en abyme est charmante et il semble au lecteur qu'entre le premier et le deuxième titre, la boucle est bouclée.
Pour cette raison et pour le bémol évoqué plus haut, je ne suis plus si sûre de lire les titres suivants, contrairement à mes envies initiales de janvier... Nous verrons. En attendant, je ne regrette par ce voyage en VO qui m'aura permis de prendre conscience de bien des éléments que la version française ne laissent pas entrevoir. Pour cela, c'est donc nécessairement une belle aventure - mais quelle aventure littéraire ne l'est pas, de toutes façons ?
 Le mois américain chez Titine
Le mois américain chez Titine
Journée consacrée à la littérature du XIXème siècle
29/07/2020
L'Education sentimentale de Gustave Flaubert
 Depuis quelques années, je redécouvre Flaubert et plus je le lis/plus je vieillis, plus je l'apprécie. Aussi, je me suis dit qu'il était temps de réessayer L'Education sentimentale qui m'avait rasée il y a quelques quinze ans au point d'en abdiquer la lecture aux alentours de la page 140 (mon nombre de pages fatidique à l'époque). Pour me motiver à réitérer l'expérience dans l'année en cours, j'avais inclus ce titre dans ma pile des 20 pour 2020 (challenge initié sur Instagram par Fanny). Honnêtement, dans les faits, je me voyais moyennement atteindre mon objectif mais deux éléments m'ont finalement décidée à en faire le premier livre des grandes vacances :
Depuis quelques années, je redécouvre Flaubert et plus je le lis/plus je vieillis, plus je l'apprécie. Aussi, je me suis dit qu'il était temps de réessayer L'Education sentimentale qui m'avait rasée il y a quelques quinze ans au point d'en abdiquer la lecture aux alentours de la page 140 (mon nombre de pages fatidique à l'époque). Pour me motiver à réitérer l'expérience dans l'année en cours, j'avais inclus ce titre dans ma pile des 20 pour 2020 (challenge initié sur Instagram par Fanny). Honnêtement, dans les faits, je me voyais moyennement atteindre mon objectif mais deux éléments m'ont finalement décidée à en faire le premier livre des grandes vacances :
1/ J'ai passé l'épreuve folle de relire Le lys dans la vallée de Balzac il y a quelques mois et ça s'est finalement plutôt bien passé. A partir de là, toutes les lectures étaient possibles ;
2/ Electra avait prévu de le lire cet été. J'ai profité de l'occasion pour lui proposer une lecture commune histoire de me motiver. Nous y voilà !
L'Education sentimentale couvre grosso modo 12 ans de la vie de Frédéric Moreau, protagoniste velléitaire, avec une ellipse temporelle finale qui nous projette directement en 1867 dans les tous derniers chapitres conclusifs. En parallèle, et peut-être bien principalement, c'est autant d'années d'existence d'une époque que dépeint Flaubert : celle du déclin de la dernière monarchie française, de l'avènement de la 2ème République puis du Second Empire. Bref, le virage du milieu du XIXème siècle.
Mais revenons-en brièvement à Frédéric pour planter le nœud du récit - extrêmement ténu, soyons clairs, attendu que Flaubert ici ne fait pas dans le roman palpitant à tiroirs. En septembre 1840, Frédéric Moreau, jeune homme de 18 ans rentre à Nogent chez sa mère après une visite chez un oncle dont il brigue l'héritage. Il n'a aucune envie de retourner s'enterrer deux mois dans ce trou avant d'attaquer son droit à Paris, aussi rentre-t-il par la voie la plus longue : le bateau. Durant le trajet, il fait la connaissance d'Arnoux, un marchand d'art à la faconde séduisante mais vulgaire, et de sa femme, la belle madame Arnoux dont il tombe instantanément amoureux. Durant toutes les années qui vont suivre, il n'aura de cesse de se rapprocher du cercle des Arnoux pour fréquenter cette femme simple et belle qui lui inspire tant de respect et un amour aussi constant que sincère sans qu'il ne se passe finalement jamais rien. En parallèle de quoi, il nourrit bien des projets sans jamais aller au bout de rien. Contrairement à son ami d'enfance Deslauriers, Frédéric vit dans une aisance financière suffisante, bien que fluctuante au cours de sa vie, pour ne pas nourrir d'ambition forcenée. Il n'a pas besoin de parvenir, il est déjà un bourgeois installé depuis sa naissance. Aussi, même politiquement, contrairement à Sénécal, très extrémiste dans son engagement par exemple, il ne se mouille pas vraiment. Il suit le mouvement en ne voyant que ce qu'il veut voir. Frédéric, en somme, est l'incarnation de la médiocrité bourgeoise, ce juste milieu qui ne crée ni ne construit rien sans être méchant pour autant (en même temps, il ne manquerait plus qu'il morde). Il est exactement le contraire du Rastignac balzacien auquel l'auteur fait référence avec son ironie subtile et délicieuse au tout début du roman, dans la bouche de Deslauriers :
- Rappelle-toi Rastignac dans la Comédie humaine ! Tu réussiras, j'en suis sûr !
Évidemment, ce sera un échec cuisant à tous points de vue.
Cette existence plutôt insipide est finalement l'occasion de brosser une époque, cette charnière décisive du XIXème siècle. L'esprit romantique incarné par Frédéric atteint ses limites : beaucoup de projets et de rêves, de grandes aspirations (j'allais dire de Grandes espérances) mais aucune inscription véritable dans la société. Beaucoup de bruit pour rien dirait Shakespeare. Voilà. A un moment donné, c'est beau de rêver et de s'exalter mais ça n'aboutit à rien si ce n'est pas nourri d'effets concrets. Rapidement, d'ailleurs, Frédéric laissera tomber ses velléités (parmi d'autres) d'écriture poétique et de création picturale. Littérairement, le virage entre le romantisme et le réalisme est ainsi fait.
Il s’était arrêté au milieu du Pont-Neuf, et, tête nue, poitrine ouverte, il aspirait l’air. Cependant, il sentait monter du fond de lui-même quelque chose d’intarissable, un afflux de tendresse qui l’énervait, comme le mouvement des ondes sous ses yeux. À l’horloge d’une église, une heure sonna, lentement, pareille à une voix qui l’eût appelé.
Alors, il fut saisi par un de ces frissons de l’âme où il vous semble qu’on est transporté dans un monde supérieur. Une faculté extraordinaire, dont il ne savait pas l’objet, lui était venue. Il se demanda, sérieusement, s’il serait un grand peintre ou un grand poète ; — et il se décida pour la peinture, car les exigences de ce métier le rapprocheraient de Mme Arnoux. Il avait donc trouvé sa vocation ! Le but de son existence était clair maintenant, et l’avenir infaillible.
Quand il eut refermé sa porte, il entendit quelqu’un qui ronflait, dans le cabinet noir, près de la chambre. C’était l’autre. Il n’y pensait plus.
Flaubert se concentre aussi sur le portrait politique et social de cet entre-deux du siècle. Ainsi, de longs passages (très intéressants intellectuellement mais je dois vous dire avec honnêteté qu'ils ne sont pas toujours très enthousiasmants pour le lecteur néanmoins...) sont consacrés aux discussions politiques lors desquelles Frédéric, fidèle à lui-même, reste très en retrait et l'on observe de façon distanciée et toujours ironique les motivations révolutionnaires (l'ambition, la domination, l'égalité) des insurrections successives (1848, le coup d’État de Napoléon III).
— Est-ce que les journaux sont libres ? est-ce que nous le sommes ? dit Deslauriers avec emportement. Quand on pense qu’il peut y avoir jusqu’à vingt-huit formalités pour établir un batelet sur une rivière, ça me donne envie d’aller vivre chez les anthropophages ! Le Gouvernement nous dévore ! Tout est à lui, la philosophie, le droit, les arts, l’air du ciel ; et la France râle, énervée, sous la botte du gendarme et la soutane du calotin !
L'auteur nous invite également à déambuler dans nombre de soirées mondaines où d'autres ambitions se découvrent, notamment celles des femmes qui n'ont finalement pas cinquante possibilités à leurs dispositions à l'époque : épouser ou se prostituer. Une mention spéciale pour le personnage de Rosanette, la courtisane qui passe entre tous les bras comme moyen de s'extirper de son effroyable condition d'origine. Celle qui apparaît au départ comme une Marie couche-toi-là écervelée - par opposition à Marie Arnoux, sainte entre toutes, sorte de Mme de Tourvel qui ne flanche pas (il faut dire à sa décharge que Frédéric n'a rien de Valmont) - est en fait d'une complexité intéressante. J'ai particulièrement apprécié que les personnages féminins soient d'une heureuse profondeur, à la fois factuelle et symbolique.
L’affranchissement du prolétaire, selon la Vatnaz, n’était possible que par l’affranchissement de la femme. Elle voulait son admissibilité à tous les emplois, la recherche de la paternité, un autre code, l’abolition, ou tout au moins « une réglementation du mariage plus intelligente ». Alors, chaque Française serait tenue d’épouser un Français ou d’adopter un vieillard. Il fallait que les nourrices et les accoucheuses fussent des fonctionnaires salariés par l’État ; qu’il y eût un jury pour examiner les œuvres de femmes, des éditeurs spéciaux pour les femmes, une école polytechnique pour les femmes, une garde nationale pour les femmes, tout pour les femmes ! Et, puisque le Gouvernement méconnaissait leurs droits, elles devaient vaincre la force par la force. Dix mille citoyennes, avec de bons fusils, pouvaient faire trembler l’hôtel de ville !
(Et hop, un joli discours indirect libre flaubertien comme on les aime ♥)
Le bilan de ma lecture est donc plutôt positif dans la mesure où, intellectuellement parlant, Flaubert coche toutes les cases de ce qui me ravit les neurones : une finesse stylistique sans pareille, une musicalité syntaxique impeccable, une ironie aussi subtile que mordante et un propos ô combien maîtrisé qui s'exprime à travers une construction narrative parfaite. Pour autant, comme je l'ai brièvement mentionné précédemment, ce n'est pas une lecture exaltante. Flaubert a voulu signifier les limites du romantisme, en marquer son essoufflement, et sanctionner le passage d'une ère à une autre ; dont acte. Mon professeur de XIXème à l'université avait résumé L'Education sentimentale en disant qu'il s'agissait d'un roman sur l'ennui - ce qui m'avait marquée, évidemment, parce que ce n'est pas la mise en bouche la plus engageante, n'est-ce pas ! Et en effet, c'est tout à fait ça. C'est tellement bien fait, d'ailleurs, qu'on est pas loin de s'ennuyer régulièrement en le lisant, du coup... Autant vous dire que ce qui m'a sauvée, comme avec Le Lys dans la vallée, c'est d'avoir su lire un certain nombre de passages en lecture rapide. Il n'est pas dit, sinon, que j'aurais tenu jusqu'au bout - ce que je suis ravie d'avoir fait au demeurant, car la conclusion de l'histoire d'amour durable bien que platonique entre Frédéric et Mme Arnoux est vraiment touchante et belle. Vous voilà donc prévenus si vous ambitionnez de vous attaquer à ce monument.
Bien qu’il connût Mme Arnoux davantage (à cause de cela, peut-être), il était encore plus lâche qu’autrefois. Chaque matin, il se jurait d’être hardi. Une invincible pudeur l’en empêchait ; et il ne pouvait se guider d’après aucun exemple puisque celle-là différait des autres. Par la force de ses rêves, il l’avait posée en dehors des conditions humaines. Il se sentait, à côté d’elle, moins important sur la terre que les brindilles de soie s’échappant de ses ciseaux.
A présent, allons lire le billet d'Electra !
Textes de Flaubert précédemment lus et chroniqués : Un coeur simple, Madame Bovary et Salammbô, coup de coeur absolu que je vous encourage à lire absolument ♥
07:30 Publié dans Classiques, Histoire, Lecture commune | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : l'éducation sentimentale, gustave flaubert, xixème siècle, amour, ennui, vélleité, politique, monarchie de juillet, restauration, révolution, art, amour platonique, frédéric moreau, madame arnoux, lecture commune, ironie, louis-philippe




