27/03/2015
Une saison à Longbourn de Jo Baker
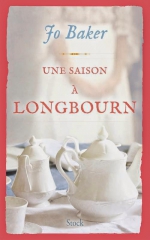
Une saison à Longbourn de Jo Baker, Stock, 2014, 394p.
Après un dépucelage tardif mais hautement apprécié de Jane Austen dernièrement, j'ai décidé de goûter dans la foulée à ma première austenerie. C'est Alice du site Jane Austen is my wonderland (et aussi du blog Books are my wonderland car, quand on aime, on ne compte pas!) qui m'a offert cette opportunité grâce au concours pour fêter les cinq ans de sa plateforme austenienne. Merci Alice !
Une saison à Longbourn de Jo Baker se saisit de la résidence des Bennet d'Orgueil et préjugés (comme le titre l'indique, n'est-ce pas) et invite le lecteur à descendre d'un étage. Ce ne sont plus Lizzy, Jane ou Lydia dont il est abondamment question dans ce roman mais de ces autres personnages de l'ombre à peine ébauchés dans l’œuvre source : les domestiques. On se rappelle bien avoir lu régulièrement chez Austen Mrs Bennett crier "Hiiiiills" à tous bouts de champ (ou plutôt l'entendons-nous dans la série de la BBC ? Je m'y perds) mais jamais on ne la voit longuement, jamais elle ne parle ni n'est décrite. Qu'à cela ne tienne ! C'est là que Jo Baker entre en action. Aux côtés de la respectable et travailleuse intendante évoluent Sarah, une jeune femme pleine de passion et de révolte d'avoir connu un bonheur dont elle est aujourd'hui privée ; la petite Polly encore enfant et déjà corvéable dès l'aube ; et enfin James Smith, le nouvel arrivant au titre de valet dont la caractéristique principale est d'attiser les interrogations de Sarah et de raviver quelques souvenirs de Mrs Hills. Ainsi, en parallèle des idylles et autres péripéties des maîtres, vont se nouer - non à l'identique mais toujours avec une forte inspiration en forme de gentil hommage - les idylles et péripéties des serviteurs

A travers le quotidien de ces personnages, Jo Baker découvre en outre les coulisses de la plus célèbre histoire de la littérature anglaise du XIXème siècle. Tout cela n'est plus si poli, si lisse et si délicat dans Une saison à Longbourn ! Exemple au hasard : les balades dans la boue de Lizzy, expression si éclatante de son indépendance dans O&P deviennent celle d'une forme de mépris des maîtres à l'égard du travail des domestiques : cette fameuse boue est la hantise de Sarah qui se voit obligée de frotter les jupes pendant des heures avant d'en rendre le moindre éclat. Si Lizzy est parfaite et parfaitement moderne, elle est surtout une jeune fille de son rang qui ne s'intéresse qu'occasionnellement et quand elle le veut bien au sort de ceux qui gravitent dans son ombre. Et que dire de de tous les à-côtés d'une vie sans confort ni hygiène à cette époque ? Entre les jours de lessives, la corvée des pots de chambre le matin ou celle des couches des petits Gardiner, on a droit à un vrai florilège de délices entre la cour et la cuisine des Bennet !
Globalement, j'ai plutôt apprécié tout cet envers du décor : on en apprend souvent autant qu'en admirant la surface ! Le roman de Jo Baker se lit très facilement et avec plaisir. Je n'ai pas été gênée par d'éventuelles longueurs sur les différentes tâches - parfois répétitives - de Sarah ou de James car, précisément, c'est ce quotidien que je trouve le plus intéressant dans l'exercice de cette austenerie. Les histoires personnelles plus ou moins cousues de fil blanc (soyons francs) qui se nouent entre eux m'ont beaucoup moins touchée. A cet égard, c'est là qu'on voit l'exercice périlleux de l'austenerie : se confronter, de près ou de loin, à un monstre de la littérature, c'est tout de même prendre le risque que la comparaison ne soit pas en sa faveur. Et de loin. (Oui, j'enfonce des portes ouvertes mais rappelons que c'est ma première lecture du genre) En l'occurrence, là où Jane Austen contournait voire enfonçait les poncifs de la romance à l'eau de rose grâce à une ironie à tous niveaux extraordinaire, Jo Baker en manque cruellement. Du coup, les personnages comme leurs histoires manquent de relief et de véritable intérêt. D'un côté, nous avons donc un chef d'oeuvre, de l'autre, un roman de plage. Ce n'est pas un mal cela dit, il en faut pour tous les moments de lecture et, cette semaine, j'ai grandement apprécié ma lecture de plage (qui s'est transformée en lecture de plaid). Il faut simplement savoir ce qu'on lit, voilà tout !
Mille mercis à Alice et aux éditions Stock pour cette découverte !
17:11 Publié dans Classiques, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (12)
18/03/2015
Bâtons à message - Tshissinuashitakana de Joséphine Bacon

Bâtons à message - Tshissinuashitakana de Joséphine Bacon, Mémoire d'encrier, 2009, 140p.
 Le premier espace de la parole tracée, pour les Innus, fut la nature elle-même. Ainsi, l'épinette blanche se faisait balise pour informer les êtres de leur progression dans les territoires gigantesques et gelés. Ces marques révélaient une alliance primordiale entre l'être et le lieu et entre les êtres eux-mêmes.
Le premier espace de la parole tracée, pour les Innus, fut la nature elle-même. Ainsi, l'épinette blanche se faisait balise pour informer les êtres de leur progression dans les territoires gigantesques et gelés. Ces marques révélaient une alliance primordiale entre l'être et le lieu et entre les êtres eux-mêmes.
Dans son premier recueil poétique, Joséphine Bacon fait de la poésie les nouveaux bâtons à messages : Le poème devient repère nécessaire dans une jungle qui en manque cruellement. Elle retourne aux racines, fouille les légendes, les sons du tambour, les accents de voix ; de même que les peines et les désespoirs. C'est le terreau duquel naissent ses poèmes, comme l'épinette, qu'elle entend nous transmettre avec une simplicité et une grâce désarmante.
Je n'ai, très sincèrement, pas apprécié tous ces textes avec la même force et la même émotion. Certains me sont apparus trop naïfs - même pour une poésie qui se veut simple et claire comme l'eau vive. Il faut néanmoins souligner que le recueil est bilingue et que les poèmes ont été composés premièrement tantôt en français, tantôt en langue innue. Peut-être, donc, faut-il imputer cette apparence naïveté à une traduction difficile de certains textes ? Toujours est-il que d'autres m'ont par contre incroyablement touchée. J'ai trouvé chez Joséphine Bacon une force brute qui dynamise et syncrétise en quelques vers brefs ; j'ai savouré une douceur, une confiance et une lumière intérieure qui valent mieux que de longs discours.
Je retrouve chez Joséphine Bacon ce que j'avais tant apprécié dans la prose de Virginia Pésémapéo Bordeleau et chez d'autres auteur(e)s amérindien(ne)s : le caractère presque performatif de la parole. Écrire, c'est avant tout ne pas oublier et aller de l'avant simultanément. En somme, c'est avant tout guérir.
Tschishikushkueu,
Femme de l'espace,
ce matin, j'ai revêtu
ma plus belle parure
pour te plaire
tu guideras
mes raquettes ornées
de l'unaman de mes ancêtres.
Mes pas feutrés
touchent avec respect
cette neige bleue
colorée par le ciel
l'étoile de midi
me conduit à Papakassik
où m'attend la graisse
qui élève le chant de mon héritage
quand je pile les os.
*
Ma douleur,
devenue remord,
est le long châtiment
qui courbe mon dos.
Mon dos ressemble
à une montagne sacrée,
courbée d'avoir aimé
tant de fois.
*
Ma peine m'est venue
d'une parole,
un soir d'orage,
alors que le tonnerre
réclamait
une tendresse silencieuse,
son sourd
que seule la pluie écouta.
*
Je me suis fait belle
pour qu'on remarque
la moelle de mes os,
survivante d'un récit
qu'on ne raconte pas.
*
13:59 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (6)
13/03/2015
L'Appât de José Carlos Somoza

L'Appât de José Carlos Somoza, Babel, 2014, 531p.
Dans un Madrid presque semblable au nôtre mais qui aurait subi un terrible attentat quelques années plus tôt, un fameux 9 novembre (vas-y lecteur, lis le jour et le mois à l'envers), la Police a maintenant recours à une arme révolutionnaire : les appâts. Il n'est plus question d'attendre que les criminels se manifestent pour les épingler, au risque de faire de nombreuses victimes au passage. Non. Maintenant, on va les chercher. Et quand je dis "on", je veux dire les appâts. Des hommes, des femmes et même des enfants, tous entraînés et conditionnés à chaque minute de leur vie pour percer à jour le plaisir des êtres et ainsi les manipuler. Cette méthode se base sur la découverte révolutionnaire des psynomes par Victor Gens. Tout comme nos caractéristiques physiques sont inscrites dans le génome, nos caractéristiques psychologiques, toutes déterminées par le désir, s'énoncent clairement par le psynome. Chacun vit, agit, réagit en fonction de son désir. Le libre-arbitre dans tout ça, et les sentiments ? Une expression du désir, tout simplement. Il existe évidemment autant de psynomes que d'êtres vivants. Néanmoins, beaucoup se recoupent par des caractéristiques communes, que l'on peut classer en grands groupes : les philias. Et c'est là qu'entrent en scène les appâts. Ces derniers sont capables d'identifier la philia de tout un chacun et d'agir en fonction pour posséder et soumettre. Voire pour tuer - d'un excès de plaisir qui confère à la folie. Au fond, les appâts sont des acteurs professionnels qui feignent tout et charment tous grâce au plus grand des dramaturges : William Shakespeare. En chacune de ses pièces, les ingrédients pour envoûter une philia, appelés "masques". Bienvenue dans la dystopie de Somoza où la vie est un théâtre.
Rentrons à présent dans le vif de l'intrigue. Diana Blanco est un des appâts les plus doués de la capitale espagnole. En bonne philique de Travail, elle fait preuve d'une pugnacité sans pareille lorsqu'il s'agit de traquer un psycho. Justement, Diana est assignée à celle du Spectateur, un des plus dangereux serial killer depuis des lustres - depuis Jack L’éventreur, en gros. Tandis qu'elle envisageait un temps un retrait de la profession par amour (mais encore une fois, cela existe-t-il vraiment dans ce monde étrange régit par le désir?), l'enlèvement de sa sœur par le Spectateur vient chambouler tous les plans et la pousse à tout tenter pour sauver sa seule famille.
Et bien, on ne va pas se mentir : ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un Somoza aussi malsain. Les univers de l'auteur sont toujours alambiqués et à la limite du tordu, soit, je commence à en avoir l'habitude, mais ce qui les caractérisent le plus, à mon sens, est leur complexité et l'érudition qui les sous-tend. Si cela est toujours vrai dans L'Appât, on ne peut nier qu'une noirceur glauque et gluante colle en outre à chaque page et crée une atmosphère dérangeante à souhait. Ce n'est pas tant la monstruosité des serial killers (oui, des. Mais je ne vous en dis pas plus car comme dirait River Song : Spoileeeeeers) qui l'installe - bien qu'ils y participent de tout leur soûl - mais cette idée du psynome, des philias et des appâts. Que sommes-nous, si tout est désir ? Que deviennent la Raison, la volonté, la capacité de choisir et d'aimer ? L'homme n'est pas même un animal ; il est un pantin. Un pantin, qui plus est, répertoriable comme un bon dossier. Tel pantin est philique d'Holocauste, tel autre d'Aura ou de Demande. Et dès lors, vous n'être plus seulement un pantin aux mains de votre désir mais aussi aux mains des appâts qui se serviront de vous comme d'un vulgaire accessoire de théâtre. Absolument tout est factice et manipulable. Franchement, quand on fait le point sur la question, il y a de quoi frissonner. Le plus délicieux étant la manière dont ceux qui usent ou chapeautent toute cette entreprise de domination par le désir parviennent à justifier leurs actes. On est en droit de se demander qui est véritablement le psycho dans l'histoire.
Et pourtant, tout cela est malsain mais je le trouve aussi délicieux, disais-je. Je dois être philique de Somoza. A chaque roman, j'ai beau soulever tel ou tel défaut, telle ou telle faiblesse, tel ou tel point qui me déplaît ou me chatouille, je dévore quand même le pavé comme une affamée. Ici, l'auteur renoue en plus avec les ressors du thriller qui ajoutent clairement un zeste de plus à des qualités déjà avérées de cuistot du page turner. J'ai commencé par être dérangée, puis par m'interroger, pour enfin être accrochée sans restriction. De l'accrochage à la séduction qui réjouit le désir d'un bon roman, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi sans bouder mon plaisir et, comme toujours, sans voir les pages et les heures défiler.
 Challenge Un pavé par mois chez Bianca
Challenge Un pavé par mois chez Bianca
Participation de mars
19:45 Publié dans Challenge, Littérature hispanique, Polar | Lien permanent | Commentaires (8)




