08/04/2013
Mr Doyle et Dr Bell de Howard Engel

Mr Doyle et Dr Bell de Howard Engel, ed. du Masque, Coll. Labyrinthes, 1997 pour l'édition originale ; 2005 pour l'édition française, 314p.
A Edimbourg, en 1879, Arthur Conan Doyle est étudiant en médecine mais aspire à embrasser une carrière littéraire. Aussi, il partage son temps entre la rédaction de quelques nouvelles qu'il soumet ici ou là, refait le monde au pub avec son ami Robert Louis Stevenson et suit avec passion les cours d'anatomie du Professeur Joseph Bell à l'université. Ce dernier est réputé pour ses talents de déduction hors du commun : il est capable de mener un premier diagnostic en quelques minutes grâce à une minutieuse observation du patient. Un soir que tous deux discutent après une journée de consultations au dispensaire, un homme blessé et ahuri fait irruption et demande à Bell de l'aider à innocenter son frère, accusé d'un double meurtre. Dans un premier temps circonspect - après tout, Bell n'est pas détective - il finit par accéder à cette étrange requête. Dès lors, le duo du maître et de l'élève va se heurter aux pressions de la police et, plus largement, d'un système qui ne souhaite surtout pas avouer ses erreurs. Rien, pourtant, ne les arrêtera avant que justice soit faite.
Ce petit policier old school déniché au hasard d'une librairie est agréable à lire et divertissant. Je l'ai emmené le mois dernier lors d'un bref séjour à Lyon et il a pleinement rempli son rôle de détente avant de dormir. Force est de constater, néanmoins, qu'il n'innove pas follement en matière de policier dix-neuviémiste et ne met pas non plus en place un suspens déconcertant.
Pour qui est fan de l'univers de Sherlock Holmes, il propose par contre un éclairage intéressant sur l'oeuvre de Doyle, une sorte de making of fantasmé. En effet, le Professeur Bell a réellement existé et on sait - du moins, cela est majoritairement attesté par les commentateurs holmésiens - qu'il a bien inspiré le personnage du célèbre détective. Doyle lui aurait emprunté ces fameuses qualités déductives et ce charisme particulier qui impressionne et fascine. Il est intéressant, du coup, et même jouissif de se retrouver ici à la genèse de Sherlock Holmes en imaginant les êtres qui l'ont inspiré dans les mêmes situations. On retrouve d'ailleurs également le truculent George Budd dont Doyle récupérera l'énergie frisant parfois le sans-gêne et les tendances cocaïnomanes pour son héros.
Et puis, il faut souligner le personnage de Stevenson ! Même s'il n'a rien à voir avec l'univers holmésien, il est peint avec une faconde et un anti-conformisme si délicieux que cela donne envie de replonger dans son oeuvre !
Je conseille donc cette aventure écossaise à qui aime plonger dans les ruelles sombres du l'ère victorienne, accompagnée de l'ombre de Sherlock Holmes, afin de passer un bon moment avec un plaid, un chat et une tasse de thé - sans en attendre plus.
 Challenge Polar historique chez Samlor
Challenge Polar historique chez Samlor
09:00 Publié dans Challenge, Littérature anglophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (6)
18/03/2013
La Légende de Bloodsmoor de Joyce Carol Oates
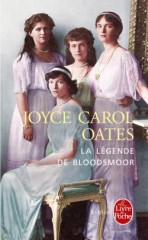
La légende de Bloodsmoor de Joyce Carol Oates, ed. Le livre de poche, 2012, 720p.
Je m'étais attaquée, pleine de temps libre et de courage au premier volume de la trilogie gothique de Oates en juin/juillet dernier. Et comme je l'avais fort apprécié malgré son abord parfaitement étonnant et aussi, avouons-le, parfois fastidieux, nous nous sommes engagées avec ma copine bloggeuse Missycornish à en lire le deuxième volume que voilà en lecture commune, joliment intitulé La légende de Bloodsmoor. Outre ce titre plein de promesses, j'ai aussi été fort attirée par la couverture à l'atmosphère pastel surannée (comme quoi, il en faut parfois peu pour donner l'envie à une lectrice) que l'auteure ne manquerait pas de démonter minutieusement à coup d'ironie, me disais-je, comme elle l'avait si bien initié dans Bellefleur. Et de fait, mes espérances n'ont pas été déçues !
Mais avant de vous parler plus avant de cette ironie qui est le coeur de ce texte, brossons tout d'abord le tableau.
En cette fin de XIXe corseté, une étrange narratrice - dont le lecteur ne connaitra jamais l'idendité - prend la plume et nous conte la déliquescence des Zinn sur les vingts dernières années du siècle. Tout semblait idyllique et poudré comme il sied pour cette auguste famille nombreuse dans la vallée de Bloodsmoor. Le père John Quincy s'adonnait à son passe-temps, si ce n'est sa profession, d'inventeur en tout genre tandis que sa femme Prudence lui donnait quatre filles aux personnalités fortes et distinctes : Constance Philippa, Octavia, Malvinia et enfin Samantha. Non contents de cette communauté sororale déjà conséquente et malgré leurs faibles revenus, ils adoptent ensuite la jeune orpheline Deirdre à l'âge de onze ans. A l'automne 1879, pourtant, tout bascule : Deirdre, alors âgée de seize ans, est enlevée par un mystérieux ballon noir - oui, elle est littéralement soulevée du sol par des mains inconnues et emportée dans les airs sous le regard médusé de sa famille impuissante. Dès lors, suivront vingts années pendant lesquelles les quatre autres soeurs prendront aussi la poudre d'escampette de ce territoire de Bloodsmoor - certaines par passion amoureuse ou du théâtre, d'autres pour échapper à l'obligation conjugale. Seule Octavia suivra la voie rangée qui était destinée à toute jeune fille de bonne famille de l'époque - elle connaitra malgré tout une vie maritale des plus surprenantes. Et le lecteur suit ainsi tour à tour ces vies jusqu'au glas du dernier jour de 1899 où la narratrice cesse son écriture, ne souhaitant pas s'aventurer dans le périlleux XXeme siècle.
Eclaircissons tout de suite un point important : Tout comme dans Bellefleur, Joyce Carol Oates ne met pas en place de narration ni d'intrigue suivies. Nous ne suivons pas, littéralement, les aventures d'une famille et nous ne sommes pas, de fait, tenus en haleine par ce qui est dit. Non. Dans cette trilogie, Oates a pris le parti de peindre plus que de raconter, du moins, c'est l'effet que me fait son écriture très appuyée, ornementée, parfois redondante. Elle a le souci de la petite touche qui fait mouche bien plus que du suspens. Néanmoins, elle nous gratifie dans ce deuxième volume d'une cohérence temporelle, ce qui n'était pas le cas dans le premier, il faut le noter !
Ainsi donc, tout est dans l'écriture. Et en matière d'écriture, je tire mon chapeau à l'auteure qui m'a tout simplement époustouflée. Elle parvient à jouer sur tous les tons surannés de l'écriture dix-neuviémiste et à articuler, comme le dit si bien la quatrième de couverture que je vous cite donc, "le sublime et le grotesque" pour nous asséner sous couvert de mièvrerie et de bien-pensance une ironie mordante. Cette fameuse narratrice anonyme semble être une dame d'âge mûr de la bonne société et met un point d'honneur à juger tout ce qui dépasse du cadre très strict des convenances de l'époque. Pourtant, elle fait preuve d'une omniscience flagrante qui l'inscrit immédiatement comme un double de l'écrivain et le lecteur décode à travers son verbe et ses nombreux italiques le regard acéré d'Oates.
Elle épingle avec une égale minutie et une égale intelligence la vie calibrée des femmes d'alors : une éducation qui apprend le silence, l'effacement, la mièvrerie, le respect de l'homme. Une éducation, en somme, qui n'offre absolument aucune autre perspective respectable que celle d'être épouse et mère sans broncher. Tout en semblant donner raison à Madame Zinn puis à Octavia, les deux seules qui pendant longtemps se conformeront à cette vision de leur sexe, la narratrice se moque pourtant cruellement d'elles lorsqu'elle donne à Prudence des réactions ridicules - même clownesques - à l'égard de John Quincy Zinn avant qu'il ne se déclare ou lorsqu'elle affuble la douce Octavia d'un mari aux moeurs sexuelles perverses exposées de manière également risibles.
Sont également saisis et disséqués le cercle artistique des gens de lettres et de théâtre à travers Malvinia Zinn devenue Morloch dont la vie est une caricature de Nana enrubannée, l'essor fulgurant du spiritisme à travers Deirdre des Ombres dont les séances virent souvent au spectacle de foire à cause d'esprits chafouins et incontrôlables, ou encore la question cruciale et souvent tue de la sexualité à travers l'ambivalence de Constance Philippa.
Toutes ces thèses forment un ouvrage d'une grande richesse que l'ironie cisèle avec une subtilité talentueuse.
Disons seulement que comme toute médaille, même la plus brillante à son revers. Aussi, malgré la pertinence et l'habileté de ce choix littéraire d'une peinture ironique sous forme de chronique familiale, le lecteur peut parfois éprouver quelques difficultés à faire défiler les pages du fait de passages très délayés pour pas grand chose et du fait d'un certain nombre de redondances dans les épisodes relatés : même s'ils ont leur raison littéraire, ce n'est pas toujours le plus agréable à lire. Pour être tout à fait sincère, il m'est arrivé de me mettre en lecture rapide, comme je l'ai fait sur du Balzac ou du gros roman russe - c'est parfois une question de survie pour arriver à bout d'une oeuvre qu'on sait excellente mais qui a aussi, parfois, la vertu de nous épuiser avec des circonvolutions fastidieuses.
C'est pour cette raison que je ne mets pas ce livre en "coup de coeur" mais je le conseille tout de même vivement tant il est excellent à tous points de vue. J'ai du coup déjà acheté le troisième et dernier volume de la saga gothique (qui peut, cela dit, se lire dans n'importe quel ordre), Les mystères de Winterthurn.
Sur ce, allons voir le billet de Missy : Il s'annonce en parfait contre-point du mien ! (j'ai déjà suffisamment blablater - et pourtant j'ai l'impression de n'avoir fait que survoler le livre)
 Challenge Petit Bac 2013 chez Enna
Challenge Petit Bac 2013 chez Enna
Catégorie Lieu
08:50 Publié dans Challenge, Lecture commune, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (12)
11/03/2013
Mrs Dalloway de Virginia Woolf
On le dit souvent durant les années universitaires : "Tu verras, les oeuvres sur lesquelles tu bosses pour ton mémoire, tu n'y retoucheras plus avant un moment, quel que soit l'amour et l'admiration que tu leur portes. Une sorte de deuxième effet kiss cool de les avoir trop lues et décortiquées pendant un ou deux ans." Et je dois dire, malgré la circonspection que cela m'inspirait à l'époque, que je n'ai pas échappé à la règle : je n'avais donc pas retouché depuis plusieurs années à Mrs Dalloway, un des trois romans sur lequel portait mon mémoire de littérature comparée. Dieu sait pourtant que je voue un culte sans borne à l'auteur et à ce livre en particulier mais il faut croire que l'effet mémoire n'épargne rien ni personne. Il finit heureusement par s'estomper avec le temps et c'est donc comme deux vieux amants se retrouvent après une longue absence que j'ai refait connaissance avec Mrs Dalloway.

Mrs Dalloway de Virginia Woolf, ed. Folio Classique, traduction de Marie-Claire Pasquier, 1925, 327p. (dont 58 d'introduction)
L'étape du résumé sera extrêmement courte pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien à résumer. Non pas qu'il ne se passe rien, bien au contraire - il se passe l'essence même de la vie - mais à l'image du refus de Woolf pour le roman réaliste empesé qui recréait une réalité purement factive, elle ne s'intéresse point tant aux actes et aux évènements qu'aux consciences. Ainsi donc, le roman retrace certes une fameuse journée de juin de Mrs Dalloway mais au fond, vous n'en apprendrez pas grand chose. Car ce n'est pas cette réception qu'elle organise qui est intéressante, pas plus que les petits faits qui auraient pu s'y greffer mais le personnage de cette femme mûre aux allures de geai, cette Mrs Dalloway entre deux âges et entre deux périodes de sa vie qui "se sentait très jeune ; et en même temps, incroyablement âgée. Elle tranchait dans le vif, avec une lame acérée ; en même temps elle restait à l'extérieur, en observatrice. Elle avait le sentiment, en regardant passer les taxis, le sentiment d'être loin, loin, quelque part en mer, toute seule ; elle avait perpétuellement le sentiment qu'il était très, très dangereux de vivre, ne fût-ce qu'un seul jour." Et autour de cette femme, de nombreux personnages au gré de son mouvement, que le lecteur suit en un flux ininterrompu de pensées, de réflexions tantôt purement anecdotiques tantôt d'une fulgurante poésie. Parmi eux, le jeune Septimus Warren Smith au nez en bec d'aigle (tous deux des oiseaux, voyez-vous) - héros de guerre aujourd'hui plongé dans une folie mystique. Pour lui aussi, vivre est devenu la plus difficile des épreuves, incompris même par sa propre femme qui aurait préféré qu'il soit mort au front plutôt que de devenir ça.
La première évidence qui me saute au yeux tandis que je relis Mrs Dalloway est qu'il fait partie de ces romans qu'il faut absolument lire dans un état d'esprit favorable, une disposition d'esprit particulière. Rien ne sert de se motiver à sa lecture en se disant qu'il s'agit d'un "classique qu'il faut avoir lu". Je crois vraiment qu'il vaut mieux ne jamais le lire du tout plutôt que de s'y forcer sous peine de s'y ennuyer encore plus que devant un Derrick (et c'est une amoureuse de Woolf qui vous le dit). De la même manière qu'il s'agit d'un roman de sensations, d'émotions, d'impressions fugaces, il faut soi-même être ouvert à tous ces petits éléments silencieux et d'une infime délicatesse et bien comprendre qu'on ne trouvera rien ici qui tient d'une histoire.(Et c'est encore pire si vous lisez Les vagues, d'ailleurs)
Au fond, le phrasé de Virginia Woolf se lit comme on lirait un recueil de poésie, avec cette même attention aux détails sensibles et cette même suprématie de l'intériorité.
Qui est cette Clarissa Dalloway ? Une femme aux mille facettes comme l'est chacun d'entre nous. Est-elle cette femme un peu précieuse, un peu snob, qui organise avec habileté une réception dans la plus pure tradition anglaise - corsetée de petits riens ? Après tout, Peter Walsh ne dit-il pas avec ironie qu'elle a toujours été "la parfaite hôtesse"? Est-elle cette jeune fille de Bourton, qui se protégeait d'un drap d'insensibilité malgré sa fraîcheur adolescente ? Est-elle cette mère incertaine, cette femme mariée à Richard Dalloway, cette amoureuse de Londres, cette femme sereine ou cette femme qui pourrait mourir d'un instant à l'autre ? Mrs Dalloway est tout cela à la fois car elle caractérise la fragilité émouvante du vivre de chaque être humain ; de la vie même de Virginia Woolf aussi, surtout.
Pourtant, au gré des heures frappées par Big Ben et de "ces cercles de plomb qui se dissolvent dans l'air", l'auteur appose en parallèle de cette balade à la fois "initiatique et nostalgique", l'empreinte de spectres plus noirs : ceux de la folie et de la mort. Ce n'est pas Mrs Dalloway qui plonge dans ce gouffre - elle reste toujours en équilibre sur le fil ténu de la vie. Ce qui la retient précisément sur ce fil est exploré douloureusement par son double cathartique, le vétéran Septimus Warren Smith. Et là où Virginia Woolf se révèle d'un génie fulgurant, c'est qu'elle ne se contente pas de creuser avec Septimus les affres de ces noirs continents qu'elle connaissait elle aussi par périodes. Elle en profite pour faire le procès d'une Angleterre pétrifiée par sa gloire et son Histoire qui ne sait pas évoluer au sortir de la première guerre mondiale. On sent bien présente à de nombreuses reprises cette grande guerre dont chacun porte encore le douloureux fardeau : "Entre le début et la fin de la phrase, il s'était passé quelque chose. Quelque chose de si ténu, dans certains cas, qu'aucun instrument de mesure, fût-il capable d'enregistrer un séisme en Chine, n'aurait pu en recueillir les vibrations ; d'une plénitude impressionnante, pourtant, et suscitant une émotion collective ; car chez tous les chapeliers et chez tous les tailleurs, de parfaits inconnus échangèrent un regard et se mirent à penser aux morts ; au drapeau ; à l'Empire. [...] Car, en disparaissant, l'agitation de surface déclenchée par le passage de l'automobile avait effleuré quelque chose de très profond." Malheureusement, loin d'en tirer des leçons d'évolution, l'Empire se drape dans son rôle de vainqueur, se solidifiant ainsi qu'une statue :"Des garçons en uniforme, armés, avançaient au pas en regardant droit devant eux, au pas, les bras raides, avec sur le visage une expression qui rappelait les légendes gravées sur le socle des statues, ces légendes qui vantent le devoir, la gratitude, la fidélité, l'amour de l'Angleterre". Et sous cet apparent hommage, on ne peut que constater que la jeunesse porte en elle les morts de la guerre et la mort même d'une certaine Angleterre au lieu de porter un avenir florissant.
Et puis, Woolf fustige aussi ce pays qui rend hommage à ses héros uniquement s'ils sont morts et qui oublie savamment les autres, allant jusqu'à traiter comme des parias ceux qui ont l'indécence de souffrir de shell shock. Elle en profite évidemment pour faire aussi le procès de la médecine psychiatrique de l'époque qui n'avait rien de salvateur. Ainsi le suicide de Septimus face à ses "médecins" qui n'écoutent pas, clament qu'il n'a rien, qu'il faut simplement "lui changer les idées" sonne comme une condamnation de l'auteur à leur égard.
"Il ne restait que la fenêtre, la fenêtre de la grande pension de Bloomsbury ; et la corvée assommante, pénible et plutôt mélodramatique d'ouvrir la fenêtre et de se jeter dehors. C'est l'idée qu'ils se faisaient de la tragédie, pas lui ou Rezia (car elle était de son côté). Holmes et Bradshaw aimaient ce genre de choses. (Il s'assit sur le rebord). Mais il attendrait jusqu'au dernier instant. Il ne voulait pas mourir. La vie était belle. Le soleil chaud. Mais les êtres humains... Descendant l'escalier d'en face, un vieil homme s'arrêta pour le regarder. Holmes était à la porte. "Vous l'aurez voulu!" s'écria Septimus, et il se jeta avec vigueur et violence, en bas sur les grilles de Mrs Filmer."
Je m'étais promis de ne pas écrire une chronique trop longue faite de réminiscences universitaires mais aussi concise que j'ai tentée d'être, ce roman fourmille de tellement de significations, tellement de mots sous les mots que je me suis laissée emporter. J'espère néanmoins que c'était plus intéressant qu'assommant et que ces quelques phrases vous donneront envie, un jour, de plonger dans un des livres les plus fascinants de la littérature anglaise du XXe siècle. Mais surtout, surtout, ne vous y forcez pas (j'ai lu trop de chroniques ahurissantes et blasphématoires - oui, oui - de lectrices qui ne savaient visiblement pas à quoi elles s'attaquaient et on fait un honteux amalgame entre leur ennui de lecture et l'absence d'intérêt du roman. Sans commentaire hein.)
Et si enfin, l'appel du livre vous prend, entre un rayon de soleil et la brise entre les feuilles d'un coquelicot, je vous souhaite de sentir comme j'ai senti l'éclatante permanence des êtres sous la mouvance des apparences.
 2eme participation au Challenge Virginia Woolf chez Lou
2eme participation au Challenge Virginia Woolf chez Lou
 3eme participation au Challenge "Lire avec Geneviève Brisac" chez Anis (Litterama)
3eme participation au Challenge "Lire avec Geneviève Brisac" chez Anis (Litterama)
 Challenge "Les 100 livres à avoir lus" chez Bianca
Challenge "Les 100 livres à avoir lus" chez Bianca
Billet rétroactif 3
08:32 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (8)




