11/11/2017
Cris de Laurent Gaudé
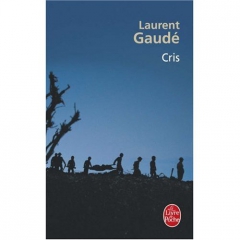
Cris de Laurent Gaudé, Le livre de poche, 2005[2001], 181p.
Je me demande bien quel visage a le monstre qui est là-haut qui se fait appeler Dieu, et combien de doigts il a à chaque main pour pouvoir compter autant de morts.
Quelques soldats au quotidien dans l'enfer des tranchées, un gazé qui agonise déjà oublié de tous, un sauvageon mi-homme mi-bête qui terrorise les vivants et les morts, un jeune homme en permission en partance pour Paris: en somme, rien que de très attendu pour un roman sur la Première Guerre Mondiale.
Il faut pourtant ajouter à cela, qui est évidemment vrai et vous résume - de manière bien superficielle - le propos de Cris, qu'il s'agit du premier roman de Laurent Gaudé. Par conséquent, au-delà d'un récit factuel, d'une peinture plus vraie que nature, il serait plus juste de dire qu'il donne voix, qu'il donne cris à ses personnages qui prennent la parole en de fulgurants monologues comme autant de chants païens poussés à la face d'un monde en déliquescence. Enfermés dans leur corps presque-déjà-mort, s'attachant sauvagement à ce qu'il leur reste de vie, de souffle, de hargne, ils forment tous une communauté étonnamment soudée au-delà des mots impossibles. Ils se rejoignent tous d'une manière ou d'une autre. La plongée que propose Gaudé dans ces intériorités coupées de tous, profondément torturées, démentes, humaines, est sans doute une des plus intéressantes manières de nous donner à ressentir une expérience aussi limite et indicible que celle de la guerre. Il faut accepter du coup, d'aller d'un personnage à l'autre en des phrases courtes, lapidaires, parfois averbales. Bien que le style puisse dérouter, il participe à la nécessaire aridité du propos.
Et puis, sorti des tranchées, il y a Jules, qui ouvre et ferme systématiquement les cinq parties de ce roman comme autant d'actes tragiques. Jules, celui qui s'en va pour mieux revenir, qui connaît l’ambiguïté de sentiments qu'implique une permission : joie, angoisse, dégoût, plaisir, indifférence, rejet. Jules, à mesure du récit, se sent habité d'un devoir de transmission. Cette permission doit permettre de dire, de faire comprendre la guerre. Il tentera le discours frontal et essuiera un cuisant échec. Puis il tentera la voie de l'art. Dans tout ce cauchemar, c'est l'art qui purge, lave, apprend, transcende. Mine de rien, on en revient au théâtre cathartique. Ou, plus justement, on atteint ici le talent de Laurent Gaudé, qui ne s'est pas démenti depuis, de créer un pont subtil et passionnant entre l'art du roman et celui du théâtre.
Je cours maintenant. Je sais où je vais. J’ai compris ce que voulait le gazé. Je voudrais lui dire qu’il peut se rassurer. J’ai enfin compris ce qu’ils veulent, tous ceux qui me parlent à voix basse. Je vais me mettre à l’œuvre. [...]
Tous les carrefours. Toutes les places. Le long des routes. À l’entrée des villages. Partout. Je ferai naître des statues immobiles. Elles montreront leurs silhouettes décharnées. Le dos voûté. Les mains nouées. Ouvrant de grands yeux sur le monde qu’elles quittent. Pleurant de toute leur bouche leurs années de vie et leurs souvenirs passés. Je ne parlerai plus. La pluie de pierres m’a fait taire à jamais. Mais un à un, je vais modeler cette colonne d’ombres. Je les disperse dans les campagnes. C’est mon armée. L’armée qui revient du front et demande où est la vie passée. Je ne parlerai plus. Je vais travailler. J’ai des routes entières à peupler. À chaque statue que je finis, la voix qui me hante se tait. Ils savent maintenant que je suis les mains de la terre et qu’ils ne mourront pas sans que je leur donne un visage. Ils savent maintenant qu’ils n’ont pas besoin de cri pour être entendus. Une à une les voix s’apaisent. Mais il en revient toujours. C’est une vague immense que rien ne peut endiguer. Je leur ferai à tous une stèle vagabonde. Je donne vie, un par un, à un peuple pétrifié. J’offre aux regards ces visages de cratère et ces corps tailladés. Les hommes découvrent au coin des rues ces grands amas venus d’une terre où l’on meurt. Ils déposent à leur pied des couronnes de fleurs ou des larmes de pitié. Et mes frères des tranchées savent qu’il est ici des statues qui fixent le monde de toute leur douleur. Bouche bée.
19:56 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : première guerre mondiale, tranchées, voix, cris, laurent gaudé, roman, théâtre, monologue, transmission, guérison, art
23/10/2017
Légende d'un dormeur éveillé de Gaëlle Nohant #MRL17
 Tradition automnale depuis quelques années : participer aux matchs de la rentrée littéraire de #PriceMinister. J'affectionne particulièrement ce rendez-vous annuel, quand bien même j'ai accumulé les déceptions ces trois dernières années (le pompon revenant au roman de l'an dernier que j'avais galéré à finir).
Tradition automnale depuis quelques années : participer aux matchs de la rentrée littéraire de #PriceMinister. J'affectionne particulièrement ce rendez-vous annuel, quand bien même j'ai accumulé les déceptions ces trois dernières années (le pompon revenant au roman de l'an dernier que j'avais galéré à finir).
Pour cette nouvelle édition, je n'ai aucunement hésité sur le choix à faire. J'avais déjà repéré ce titre à paraître de Gaëlle Nohant à la fin du printemps tant le sujet, c'est à dire ce fameux dormeur éveillé, m'est passionnant : Robert Desnos, poète surréaliste aux yeux si clairs et si myopes qu'on le dirait perpétuellement entre le sommeil et l'éveil. Et en lisant ce roman, très franchement, on rêve nous aussi de cet homme et de son univers flamboyant d'humanité.
Le miracle de l'instant, l'éternité de ce qui va mourir.
Desnos y apparaît truculent, entier dans ses amours passionnées et ses idées, farouchement libre et désireux de vivre sans compromission. C'est l'homme qui ne dort pas de plusieurs jours, allant de fêtes en rédactions de critiques littéraires et musicales, pour mieux plonger ensuite dans un sommeil hypnotique dont émergeront les plus beaux aphorismes de Rrose Sélavy. C'est celui qui préfère se priver de manger décemment et de fumer pour vivre de poésie et d'amour. C'est encore celui qui dit merde à André Breton, au parti communiste ou à la Collaboration, considérant que la liberté vaut cent fois la sécurité et qu'une paix sans liberté n'est jamais que le joli nom de l'asservissement. De toute cette vie faite d'éblouissements et de douleurs, il tire encore, un matin de février 1944, la force d'accepter dignement le sort réservé à la plupart des résistants et de s'inquiéter surtout de sa Sirène. Il mourra un mois jour pour jour après la fin de la guerre, dans une infirmerie russe. Le typhus aura raison de lui.
Pour lui, l'écriture est ce territoire mouvant qui doit se réinventer sans cesse, demeurer une insurrection permanente, une fontaine de lave, des corps joints dans la danse ou l'amour, une voix qui descelle les pierres tombales et proclame que la mort n'existe pas, une expérience sensorielle.
Evidemment, le fantasme tient une part aussi large que la documentation historique dans ce genre de livres, et c'est ostensiblement assumé par Gaëlle Nohant. Ce Robert, c'est le sien, qu'elle a nourri au fil d'années de fréquentation assidue de ses œuvres et d'œuvres des autres - un Robert un brin rêvé et pourtant tellement humain tel qu'il devait voir lui-même chaque objet du monde. Je n'ai pas tout aimé chez lui, loin de là. Je l'ai souvent trouvé imparfait dans ses emportements et ses affections féminines en dépit du bon sens, entre autres. Dire cela, c'est dire que j'ai aimé le personnage rugueux que Gaëlle Nohant a fait de lui, qui restitue à merveille les années troublées qu'il traverse alors. La pondération avec laquelle l'auteure brosse par ailleurs le Paris occupé, sans affirmation tranchée ni péremptoire, m'a semblé un choix judicieux et intelligent. Au final, je n'ai été un brin déçue que par la fin : dès lors, sans doute, que le matériau historique manque pour soutenir un récit qui continuerait à suivre Desnos après son arrestation, Gaëlle Nohant passe le flambeau narratif à Youki, la compagne du poète. Ce long journal, trop anecdotique à mon goût, beaucoup moins gorgé de sève et moins poétique dans sa langue aussi, n'a pas su m'embarquer comme l'avaient fait les quatre-cents pages précédentes.
"De lui se dégageait une grande puissance de refus et d'attaque, en dissonance frappante - il était très brun -, avec le regard étrangement lointain, l'oeil d'un bleu clair voilé de "dormeur éveillé" s'il en fut." (André Breton à propos de Desnos, cité par l'auteure)
Je garde, malgré tout, c'est-à-dire malgré ce micro-bémol très subjectif, une impression encore très vivace, très physique de cette lecture qui m'a passionnée et, surtout, je remercie cent fois l'auteure pour m'avoir fait redécouvrir la poésie de Desnos dont je méconnaissais tellement de textes brûlants, agités et engagés. Quel plaisir de lire des extraits du poète au gré de la prose du roman comme autant d'échos entre l'amoureux des mots d'hier et ceux d'aujourd'hui ; comme autant d'invitations à désobéir, c'est-à-dire à ne jamais abdiquer ce devoir d'être absolument libre.
- On ne peut dompter la nature qu'avec son consentement, répond seghers avec un grand sourire. Tous les poètes le savent.
- Et la nature de l'homme n'est pas de ramper devant les tyrans, murmure robert. Sans quoi nos genoux seraient couverts d'écailles.
19:00 Publié dans Coups de coeur, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : poésie, desnos, robert desnos, résistance, paris, paris est une fête, 30's, 40's, jazz, journalisme, critique, biographie, poète, rêveur, surréaliste, surréalisme, rentrée littéraire, gaëlle nohant, roman, andré breton, jacques prévert, youki foujita, mrl17, priceminister
22/10/2017
Lettre à un otage d'Antoine de Saint Exupéry
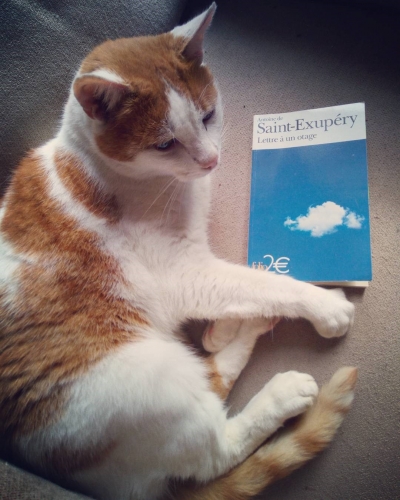 Qui dit texte autobiographique avec la Seconde Guerre Mondiale en toile de fond, dit souvent fête à mémé, tristesse et désespoir. Vu l'ampleur du saccage, comment pourrait-il en être autrement ? Saint-Exupéry ne déroge pas complètement à cette règle dans sa lettre ouverte, initialement prévue comme la préface de 33 jours de Léon Werth, l'otage du titre, avant d'être remaniée et envisagée comme autonome.
Qui dit texte autobiographique avec la Seconde Guerre Mondiale en toile de fond, dit souvent fête à mémé, tristesse et désespoir. Vu l'ampleur du saccage, comment pourrait-il en être autrement ? Saint-Exupéry ne déroge pas complètement à cette règle dans sa lettre ouverte, initialement prévue comme la préface de 33 jours de Léon Werth, l'otage du titre, avant d'être remaniée et envisagée comme autonome.
Le texte s'ouvre sur une première partie d'une mélancolie lancinante où le narrateur apparaît d'autant plus perdu, dans le Lisbonne de 1940, qu'il ne se reconnaît pas en la tripotée de joyeux riches expatriés qu'il rencontre. L'ombre de la guerre, c'est évidemment la peur et la mort, mais aussi le déracinement et le remords de la fuite. Contrairement à ces autres émigrants, Saint Exupéry ne poursuit pas un but pécuniaire - mettre son argent à l'abri - mais politique - convaincre les Etats-Unis d'entrer en guerre. Il n'empêche qu'il porte douloureusement le poids de son départ comme un manquement à ceux qui restent.
Alors commence le vrai voyage, qui est hors de soi-même.
La véritable interrogation de ce récit se dessine alors ici : comment continuer à être soi, comment rebondir, se reconstruire et espérer lorsqu'on est amputé de ses racines, et que la guerre invite à la haine de l'autre et à la suspicion perpétuelle ? Loin de la solitude subie que provoque une foule sans visages, c'est dans une solitude paisible et consentie que l'être se rassérène. Le désert le rappelle au point cardinal de sa géographie intérieure : l'amitié.
Et comme le désert n'offre aucune richesse tangible, comme il n'est rien à voir ni à entendre dans le désert, on est bien contraint de reconnaître, puisque la vie intérieure loin de s'y endormir s'y fortifie, que l'homme est animé d'abord par des sollicitations invisibles. L'homme est gouverné par l'Esprit. Je vaux, dans le désert, ce que valent mes divinités.
La simplicité et la tendresse des relations humaines, développées à travers autant d'anecdotes mettant en scène Léon Werth ou des soldats ennemis, brodent l'espoir profond et ravivé d'une humanité riche de toute sa diversité capable de projeter l'avenir d'une entente universelle.
Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente.
Auprès de toi, je n'ai pas à me disculper, je n'ai pas à plaider, je n'ai pas à prouver ; je trouve la paix.
Certains le liront comme un vœu pieu tant l'Histoire se charge régulièrement de nous décourager ; d'autres comme le souffle vivifiant qui redonne la foi. Une chose est sûre : à lire ce court et beau texte de Saint-Exupéry, ne pas perdre espoir, en certaines périodes particulièrement sombres et troublées, apparaît clairement comme une sacrée preuve de courage.
Cette qualité de la joie n'est-elle pas le fruit le plus précieux de la civilisation qui est la nôtre ? Une tyrannie totalitaire pourrait nous satisfaire, elle aussi, dans nos besoins matériels. Mais nous ne sommes pas un bétail à l'engrais. La prospérité et le confort ne sauraient suffire à nous combler. Pour nous qui fûmes élevés dans le culte du respect de l'homme, pèsent lourd les simples rencontres qui se changent en fêtes merveilleuses.
20:32 Publié dans Ecriture de soi, Histoire, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : lettre, lettre ouverte, histoire, guerre, seconde guerre mondiale, saint exupéry, emigration, exil, isolement, solitude, amitié, humanité, espoir, joie, partage, autobiographie




