04/08/2014
Rivière Mékiskan de Lucie Lachapelle
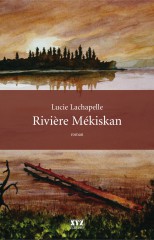
Rivière Mékiskan de Lucie Lachapelle, XYZ éditeur, 2011, 159p.
Alice a 25 ans et vient de perdre son père. Un père absent, un père alcoolique ; un père qui l'attache à des origines qu'elle préfère tenir à distance car elles sont pour elle synonymes de déchéance et de douleur : ses origines cries. Pourtant, elle décide de partir à 12h de train de Montréal pour ramener son père chez lui. C'est au cœur des forêts québécoises, près de la rivière Mékiskan qu'il doit reposer. Il ne s'agit, initialement, que de faire l'aller retour. Loin d'elle l'idée de s'attarder. Elle veut seulement laisser enfin la colère derrière elle, tourner une page. Mais l'on en finit pas si facilement avec le passé et avec une part de soi-même. Après tout, le sang cri coule dans ses veines. Près de cette rivière, ce n'est pas seulement son père qu'elle doit enterrer mais son ressentiment, tout ce mélange d'émotions néfastes qui la ronge comme bien des Amérindiens. Grâce à la vieille Lucy, une lointaine parente, et ses petits-enfants, elle va vivre un quotidien qui saura la guider vers l'apaisement.
Une fois n'est pas coutume, voici un roman sur les Amérindiens mais pas un roman amérindien. Lucie Lachapelle connait à merveille son sujet mais n'est pas elle-même native de la nation crie. Si le propos de son roman se rapproche beaucoup d'une trame typiquement autochtone : le retour physique du natif qui occasionne une réflexion plus profonde sur la nécessité de guérir une identité meurtrie, le regard distancié, extérieur de l'auteure me semble se ressentir en ce que la culture crie ne résonne pas d'une manière aussi prégnante que dans les titres d'homologues autochtones. Au fond, Alice ne retourne pas à ses origines mais fait la paix avec elle. L'idée n'est pas pour elle de recréer un lien perdu - souvent source du mal-être - mais simplement d'accepter qu'une part d'elle-même est crie. Cesser de le refouler, cesser de le voir d'une manière uniquement péjorative, dépréciative. Simplement accepter.
La langue de Lucie Lachapelle se fait neutre, douce, très simple pour relater ce chemin vers l'acceptation. D'aucuns la trouveront trop simple. Il faut avouer qu'elle ne fait pas dans la métaphore filée. Mais le propos n'est pas le style ; il est plutôt le mouvement positif qui porte Alice. Le voyage au fond ne sera que de courte durée. Elle repartira vers Montréal au bout d'une semaine pour se retrouver à l'endroit précis où son père est mort. On sent que ce récit n'est que l'ébauche d'un cheminement plus vaste, qui se fera loin des Cris (ou peut-être, plus tard, à nouveaux avec eux ?). En attendant, Rivière Mékiskan raconte avec délicatesse la nécessité de guérir les vieilles colères indigentes et démontre, en outre, que si certains clichés délétères sur les Amérindiens ne sont pas sans fondement, il y a toujours aussi un élan de vie.
Merci beaucoup à Anne pour ce livre voyageur !

 Challenge Amérindiens
Challenge Amérindiens
17eme participation
08:57 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (4)
18/07/2014
Le Père Goriot de Balzac

Le Père Goriot de Balzac, Le livre de poche, 2004 [1835], 443p.
"Rappelle-toi Rastignac !" dit Deslauriers à Frédéric Moreau dans L'éducation sentimentale de Flaubert. C'est que Rastignac est le parangon de l'arriviste en littérature, à l'aune duquel s'évaluent les autres jeunes premiers de roman d'apprentissage. Il y a quelques mois, j'y comparais d'ailleurs brièvement le personnage de Bel-Ami. Pourtant, si je connaissais l'illustre Rastignac grâce à La peau de chagrin, dans laquelle il est déjà adulte, dandy un poil désenchanté et grinçant, je ne connaissais pas encore sa genèse. Pour remédier à cela, j'ai empoigné fièrement Le père Goriot, forte de mon récent coup de cœur pour Le colonel Chabert, me disant qu'enfin Balzac et moi serions peut-être réconciliés.
A l'automne 1819, Eugène de Rastignac a vingt-et-un ans. Comme bon nombre de jeunes provinciaux, il est officiellement à Paris pour faire son droit et habite dans la pension de madame Vauquer une chambre médiocre - c'est encore tout ce que sa famille peut lui payer. Officieusement, il ambitionne de croquer Paris. La ville et sa société brille d'un faste qu'il dévore des yeux, qu'il aspire à pénétrer pour se faire une place au soleil. Grâce à une lointaine parente, la vicomtesse de Bauséant, il y glisse un orteil mais se montre bien maladroit. C'est surtout sa bévue chez la Comtesse de Restaud qui lui vaut quelques frayeurs et un regain d'orgueil. Cette dernière n'est autre qu'une des filles du Père Goriot, son pauvre voisin à la maison Vauquer. Rastignac découvre avec circonspection que le vieux vermicellier avait jadis quelque argent et une bonne situation qu'il a progressivement grignotée pour l'amour de ces filles. Grâce à lui et à sa cousine, Rastignac entreprend de séduire la seconde fille de Goriot, Delphine de Nuncigen, y parvient, et glisse alors plus d'un orteil dans ce monde qui deviendra bientôt le sien. Ainsi se clôt le roman, comme un cri de défi à l'adresse de Paris : "A nous deux maintenant!"
J'ai découvert dans ces pages un personnage particulièrement savoureux. Rastignac est complexe et ambigu, bien plus que ne le sera Bel-Ami. Il est certes animé d'une ambition et d'un arrivisme décapant mais il se montre néanmoins terriblement humain. Il nourrit quelques scrupules à réclamer de l'argent supplémentaire à sa famille, il rechigne à ce pacte criminel auquel l'invite Vautrin, enfin il montre bien plus de pitié et d'intérêt pour Goriot mourant que ses propres filles, déjà trop imprégnées de Paris. Le Père Goriot est le roman charnière. Il dépeint le passage du jeune homme aimable, aimant, sincère et naïf à celui d'homme du monde que plus rien n'émeut que sa propre ambition. La mort du père Goriot éteint les dernières "saintes émotions d'un cœur pur" et livre Rastignac à son destin. Il ne reculera plus dès lors devant aucune bassesse pour déployer ses ailes : travaillera pour le mari de sa maîtresse et finira même par épouser sa fille, comme le fera Bel-Ami après lui.
Si l'on sent déjà à travers ce jeune Rastignac une critique de la société parisienne, elle est d'autant plus prégnante dans le contraste entre le père Goriot, généreux, dévoué à ses filles tant aimées et ces deux parvenues égoïstes qui n'ont pas le moindre scrupule à dépouiller leur père à coup de larmes et de plaintes. Si leurs mariages leur ont ouvert la porte de la bonne société, elles se fourrent encore dans des affaires de cœur ou de coquetterie qui les obligent à des dépenses que les maris refusent de payer. C'est pour cette seule raison qu'elle font appel à Goriot. Le jour de son agonie, d'autres affaires les occuperont et elles se déplaceront trop tard. A une autre échelle, l'appât du gain de madame Vauquer, dénuée de la moindre empathie, n'est pas non plus en reste. A la lecture de ce roman et après Le colonel Chabert, j'avoue me demander ce que Balzac pensait des femmes. Assurément, il ne tenait pas la gente féminine en grande estime puisque c'est elle, encore une fois, qui cristallise les pires défauts d'une société hypocrite, égocentrique et vénale.
Enfin, un petit mot du style de Balzac qui m'a ravie dès les premières pages : une ironie délicieusement cinglante, non sans une certaine émotion au moment opportun et quelques interventions du narrateur pour mettre à mal l'illusion romanesque. Autant de style et de manœuvres littéraires pour mettre en lumière un talent explosif. J'ai longtemps trouvé Balzac fort ennuyeux. Je le découvre petit à petit poignant et subtil, amer ou sur le fil d'un humour déguisé. Comme quoi, il ne faut décidément jamais s'arrêter à ses détestations de jeunesse. La maturité, parfois, découvre les lectures sous un tout autre jour, souvent passionnant. Et puisque je ne suis pas à une facilité près face à l'ampleur démentielle de La comédie humaine, un "A nous deux, maintenant !" semble s'imposer !
6eme lecture
 Challenge les 100 livres à avoir lus chez Bianca
Challenge les 100 livres à avoir lus chez Bianca
14eme lecture
09:14 Publié dans Challenge, Classiques, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (14)
03/07/2014
Une page d'amour d'Emile Zola

Une page d'amour d’Émile Zola, Le livre de poche, 1946 [1878], 435p.
Une page d'amour fait partie de ces romans méconnus des Rougon-Macquart, coincé entre les deux monstres que sont L'Assommoir et Nana. Il s'offre comme une parenthèse plus douce, simple et délicate à travers une passion impossible mais longtemps agréable - non sans le poids de l'hérédité qui finit par rattraper les protagonistes.
Le noyau dur du roman est formé par le couple mère/fille Hélène et Jeanne. Hélène devient veuve en même temps qu'elle emménage à Paris ; durant les dix-huit mois de son veuvage, elle ne côtoie que deux frères originaires comme elle de Marseille, l'abbé Jouve et Monsieur Rambaud, ne sort jamais, ne s'occupe que de Jeanne. Cette petite d'une douzaine d'années est d'un caractère entier, trop tendre et trop tyrannique. Elle tient de ses aïeules une faiblesse de caractère proche de la névrose et une santé fragile, subit régulièrement des crises dont on ignore précisément la nature et développe une jalousie maladive à l'égard de sa mère. Elle ne la veut rien qu'à elle ; Hélène ne doit aimer personne d'autre. Pourtant, un amour naît entre Hélène et Henri Deberle, le médecin de Jeanne. Si les relations sont tout d'abord empruntes de fraîcheur, d'une sérénité qui rassure tout le monde, la passion va peu à peu gagner le couple et Hélène de bien moins supporter les caprices jaloux de sa fille. Les sentiments qui se nouent entre elle et Deberle vont donc grignoter cette relation mère/fille exclusive jusqu'à une issue fatale, devrais-je dire, typiquement zolienne.
Sincèrement, ce n'est pas dans le registre amoureux que je préfère Zola et je ne placerai certes pas Une page d'amour sur le même piédestal enthousiaste que d'autres titres de la saga. Néanmoins et à ma propre surprise, je l'ai tout de même plutôt apprécié. Si l'amour d'Hélène et Deberle reste longtemps platonique (sa concrétisation sera le détonateur de l'élément tragique final, il faut donc l'attendre un petit moment), il est surtout le prétexte à de longs chapitres dans l'hôtel particulier des Deberle, qu'il s'agisse d'après-midis dans le jardin ou de réceptions ; Zola nous offre ainsi la peinture du quotidien des bourgeois parisiens fin de siècle, plein de frivolité et de paresse.
Paris tient également une grande part dans la trame narrative. Si Hélène et Jeanne ne s'y promènent jamais, elles observent par contre incessamment les toits de Passy depuis leur appartement. A l'unisson de leurs émotions évoluent le temps, le soleil et les éléments. L'être et Paris vibrent d'une même corde sensible.
Enfin, je le disais, le noyau dur est bien la relation entre Hélène et Jeanne. Si la mère apparaît comme une femme intègre, simple et responsable, Jeanne apparaît d'emblée plus émotive et sûrement plus désagréable. Nous ne sommes pourtant pas face à une peste qui choisit consciemment de tourmenter sa mère, pas plus qu'elle ne simule ses crises, et souvent elle est une parfaite petite fille adorable. L'une ne me semble pas plus à blâmer que l'autre et c'est bien dans les racines de leur relation que Zola a glissé le vers de son déterminisme héréditaire. La santé fragile de Jeanne a conduit Hélène à la surprotéger, à lui offrir un amour maternel disproportionné que sa fille a pris pour acquis. Plus l'arbre de la relation pousse et plus il devient difforme, malhabile, jusqu'à la monstrueuse jalousie de Jeanne. J'aurai presque souhaité trouver plus de Zola dans le développement de cette relation ambivalente, plus que ces longs chapitres bourgeois chez les Deberle (Mme Deberle en bonne maîtresse de maison superficielle est tout particulièrement ennuyeuse au bout de deux chapitres).
Mais enfin, je n'ai globalement pas boudé mon plaisir ! Comme dirait l'autre, jamais deux sans trois : prochainement un autre Rougon-Macquart donc? Qui sait !
 Challenge Rougon-Marquart chez Lili Galipette
Challenge Rougon-Marquart chez Lili Galipette
15eme lecture
 Challenge XIXeme chez Fanny
Challenge XIXeme chez Fanny
6eme lecture
08:00 Publié dans Challenge, Classiques, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (8)





