26/09/2013
Un balcon en forêt de Julien Gracq

Un balcon en forêt de Julien Gracq, ed. José Corti, 1958, 253p.
Depuis le temps que j'entendais parler de Julien Gracq ! Mes professeurs de Lettres m'en ont toujours vanté le phrasé, la langue ciselée, poétique, impeccable. Peut-être trop d'ailleurs car, à force, je crois que j'en ai eu un peu peur. Un peu comme avec Proust, vous voyez ? On en vient à se demander si on pourra lire un tel auteur et l'apprécier à sa juste valeur. Si on peut prendre le risque de passer à côté. Bref, Julien Gracq me collait un peu les miquettes.
Finalement, il m'a fallu le trouver sur une plaquette de lectures imposées pour me motiver à tenter le voyage. Comme quoi, les lectures imposées ont parfois du bon.
Un balcon en forêt ne raconte rien - et donc il dit l'essentiel. L'aspirant Grange est envoyé en faction dans un petit fortin au bord de la Meuse, au tout début de la deuxième guerre mondiale. Il a sous ses ordres trois soldats mobilisés et ne fait quasiment rien de ses journées durant neuf mois, soit les 3/4 du livre. Nous sommes à cette période méconnue, cette drôle de guerre, où les français sont positionnés en nombre réduit autour de la ligne Maginot (où l'essentiel des moyens étaient déployés) et attendent les nazis. Seulement, ils attendront un bon moment avant d'en apercevoir les balles. Et durant ce temps, Grange s'inscrit dans cette vie retirée, pleine de la forêt vitale et d'une vie bucolique resserrée autour d'un petit village. Son quotidien semble être celui d'une ermite à la fois contemplatif et routinier. C'est la nature qui exprime toute la palette des sensations innombrables. En elle que s'imprime l'évolution des heures. Elle semble immobile tout d'abord puis devenir aigre à l'approche des troupes ennemies. La rencontre avec Mona est également de toute beauté tant elle apparaît comme une nymphe perlée de pluie, irréelle et pimpante.
Progressivement et avec une irréalité ironique, les nazis finiront pas atteindre le fortin de leur obus et par tuer deux soldats. Grange n'est que blessé mais préfère rester là, dans ce microcosme étrange. Tellement plein que la solitude n'est plus un problème.
Je ressors de cette lecture très étonnée. Julien Gracq distille une poésie déroutante, presque fantastique. S'il n'est pas question d'épisodes rebondissants, l'écriture et le paysage se meuvent perpétuellement. Dans cette immobilité, les secondes deviennent pénétrantes. En outre, le style de Gracq est à la fois d'une grande modernité dans cette déconstruction du récit et emprunte pourtant au plus grands auteurs du XIXeme dans le phrasé. Je n'ai pu m'empêcher de retrouver fréquemment des formulations typiques de Zola, par exemple.
La lecture de Gracq est indéniablement un voyage du style, en apesanteur.

08:40 Publié dans Classiques, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (8)
23/09/2013
La saga des Béothuks de Bernard Assiniwi
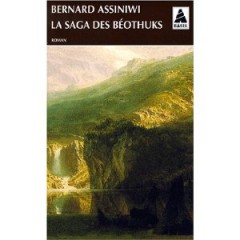
La saga des Béothuks de Bernard Assiniwi, ed. Actes Sud/Léméac, coll. Babel, 1999, 498p.
Qui sont les Béothuks ? C'est à cette question que Bernard Assiniwi répond dans ce foisonnant roman aux allures d'épopée.
Les Béothuks formaient la nation autochtone de l'île de Terre-Neuve, au nord du Canada. Je mentionne ce fait à l'imparfait car ils ont bel et bien été exterminés jusqu'au dernier par les colons anglais. Contrairement à d'autres nations premières aux abords de ce territoire, ils n'ont pas créé de liens d'échanges avec l'occupant. Dès le début, ils ont refusé l'invasion, répondant par la force à la force qu'on leur opposait et ce prime engrenage a créé une spirale dont la nation Béothuk n'est jamais sortie ; et ainsi jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun représentant - car ils n'étaient pas de taille face à des anglais plus nombreux et plus lourdement armés.
Pour raconter cette tragique histoire, Bernard Assiniwi découpe son roman - où devrais-je dire sa saga ainsi qu'il l'a lui même intitulée et effectivement, il respecte la forme des sagas nordiques - en trois parties qui correspondent aux trois périodes marquantes dans l'évolution de la nation Béothuk.
Tout d'abord, il fait remonter le temps jusqu'à l'an 1000 de notre ère (et à ma maigre connaissance, c'est l'oeuvre qui remonte le plus loin dans l'histoire amérindienne) et expose la vie mythique d'Anin, le fondateur de la nation. Anin quitte un jour son clan de la loutre (car la nation était alors divisée en clans indépendamment dirigés) pour tenter de faire le tour de l'île, que l'on considérait comme le monde. Tel était un rite initiatique. Durant ce long périple de plusieurs années, il découvre de nombreux territoires, rencontre sa première épouse qu'il sauve de la mort et affronte les vikings, premiers marins à avoir découvert l'Amérique. Parmi eux, il trouve ses deux autres femmes puis la quatrième sera une esclave irlandaise. Il rentre au clan glorieux et grâce à la protection de son animal totem : l'ours. Pour l'honorer, il fonde le clan de l'ours et devient le premier unique chef de la nation Béothuk. Ainsi, elle s'est fondée sur plusieurs valeurs fondamentales : l'authenticité, le courage, le respect de son environnement et le métissage. Les Béothuks, comme beaucoup d'autres nations amérindiennes, étaient très ouverts aux étrangers dès lors qu'ils acceptaient et respectaient leurs coutumes.
Après avoir laissé les Béothuks en plein essor, le lecteur est ensuite plongé au XVe siècle à l'époque des premiers envahisseurs français et anglais. Les échanges avec les Béothuks sont bien souvent violents et mensongers. Au gré des chefs qui se succèdent, la nation oscille entre des périodes où la défense est le souci majeure et où une paix relative est donc maintenue et des périodes d'assouplissement où ils se font systématiquement avoir. Ces évènements n'incitent pas à la souplesse et à considérer que les étrangers puissent être animés de justes intentions. De nombreux Béothuks ont été tués ou enlevés sous de faux prétextes pour être montrés comme bêtes de foire en Angleterre. Les entrepôts de stockage de nourriture et de fourrure ont été pillés. Malgré tout, la vie est encore agréable et les Béothuks occupent à présent toute l'île de Terre-Neuve. Ils ont accueilli en leur sein un marin français devenu l'époux de la chef et plusieurs chapitres sont consacrés à son apprentissage des us et coutumes autochtones ; bien souvent ces chapitres se terminent sur la conclusion que ceux que les européens jugent sauvages sont en fait érudits et bons (on pense au mythe du bon sauvage, n'est-ce-pas?)
Et puis, ce premier déclin mène à la véritable invasion anglaise au XVIIIe et XIXe. Les Béothuks ne sont plus maîtres de leur territoire ancestral dont les anglais ont pris possession en faisant fi de leur existence. Toute tentative de pacification se solde par une tuerie infâme. De 2000, les Béothuks ne sont progressivement plus que 500 puis une centaine et ainsi de suite. Malgré des édits royaux, les autochtones continuent d'être massacrés et molestés. Une prime est également remise à qui en capture un. Pour couronner le tout, un autre tueur européen sévit : le virus de la tuberculose. Les Béothuks qui ne meurent pas d'une balle de mousquet succombent à cette maladie contre laquelle ils sont impuissants. Dans la dernière centaine de pages, on suit tristement la dernière mémoire de la nation qui sera aussi la dernière survivante. Elle verra tous les membres de son clan et de sa famille quitter ce monde en sachant qu'après elle, les Béothuks cesseront d'exister. Cette partie est le récit d'un génocide en toute impunité.
J'en conviens tout à fait : cette lecture pourrait paraitre un peu austère et trop sérieuse de prime abord. Une sorte de précis historique romancé. Pourtant, la plume de Bernard Assiniwi embarque avec un grand plaisir au gré de ce peuple oublié. Le ton épique de la première partie, où Anin rivalise avec nos grands héros médiévaux en bravoure et esprit chevaleresque, fait progresser la lecture sans mal et même avec entrain. J'ai découvert avec étonnement les premières moeurs des Béothuks. Et puis, le caractère testimonial de l'oeuvre lui donne évidemment une saveur particulière. Savoir que tout cela a existé et a été détruit intégralement ne peut laisser indifférent. On oscille entre intérêt historique, interrogation, admiration, dépit et émotion au fil des pages et des époques. Il ne faut pas oublier, cependant, que cette saga ne saurait être comparé à un essai historique. Bernard Assiniwi affirme clairement le caractère mythique de son écriture dans le titre et on retrouve sous sa plume ce côté manichéen que l'on retrouve chez beaucoup de romanciers à propos de l'histoire amérindienne : l'autochtone est en quelque sorte l'image même du bon sauvage - à tort ou à raison ?
Bref, voilà un livre qui n'intéressera peut-être qu'une poignée de lecteurs mais qui les passionnera à n'en pas douter !
 Challenge Amérindiens
Challenge Amérindiens
8eme lecture

Le Mois Québecois chez Karine :)
3eme lecture
09:00 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (10)
19/09/2013
Le Livre des nuits de Sylvie Germain
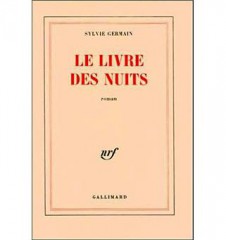
Le Livre des nuits de Sylvie Germain, ed. Gallimard, 1985, 293p.
Voilà presque trente ans que Sylvie Germain embellit les Lettres de notre belle contrée et trente ans que je passais à côté. Allez savoir pourquoi. Au moment de refermer ce premier roman prodigieux, je me dis que le temps est venu pour moi de rattraper mon retard tant j'ai pris une claque comme ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps en littérature française.
Ce sont six nuits et presque un centenaire que nous traversons le souffle coupé et les yeux éblouis aux côtés de la famille Péniel. Des racines de l'eau douce, naitront trois générations d'hommes marquées par la mort brutale, la guerre de 70 et la mutilation. Au décès de son père, Victor-Flandrin quitte ce territoire aquatique avec sa grand-mère Vitalie, qu'il perdra bientôt. Il pénètre seul mais habillé d'un collier de larmes perlées et d'une ombre blonde mystérieuse dans la vie d'à-terre jadis si terrifiante et s'établit dans un hameau feuillu de la Meuse. Loin de tout, ne ressemblant à rien, c'est dans cet espace sans amarre qu'il va construire sur cinquante ans une famille tentaculaire marquée d'une pointe d'or dans le regard.
Comment décrire ce livre sans l'amoindrir, le résumer tragiquement ? Sylvie Germain nous embarque dans un pays fascinant où les deux guerres mondiales deviennent épopée médiévale, où les destinées fauchées des enfants Péniel deviennent tragédie antique, où la vie même de Victor-Flandrin tient du conte fantastique. Cette faculté de transfigurer ainsi le réel pour en exprimer aussi bien sa cruelle vérité tient du génie le plus pur. J'en suis tant charmée et admirative qu'il m'apparait vraiment compliqué d'écrire à présent une chronique sur ce roman. Il fait partie de ces œuvres à côté desquelles on se sent tout petit et tout nu. Toute ma lecture, j'ai oscillé entre l'étonnement, la terreur, et le délice, ce fameux mélange d'émotions qui se révèle au contact des grandes œuvres. Aussi, plutôt que de vous la paraphraser ou continuer à énumérer tout ce que je sais de verbes élogieux, je vous invite urgemment à vous procurer ce livre et à le lire dès lors que vous en sentirez le bon moment. C'est un roman dur, sans nul doute. Les destins des enfants Péniel, tous frappés de gémellité, se perdent dans les affres de l'histoire et des passions. Le livre des nuits est un roman d'initiation fantastique et fantasmé où la quête identitaire se joue à la croisée de mondes surnaturels implacables. Mais c'est aussi un roman lumineux où point l'éternel recommencement de la vie. Jusqu'à la fin la naissance saura contrer la mort et même au sortir de l'effroyable épisode de la seconde guerre mondiale un nouvel enfant germera de l'antique terre noire. Un roman tout simplement bouleversant et indispensable.

09:00 Publié dans Coups de coeur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (14)




