01/06/2018
Testament à l'anglaise de Jonathan Coe
"Laissez-moi vous donner un avertissement sur ma famille, au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, dit-il enfin. C'est la pire bande de salauds, de rapaces, de voleurs, d'escrocs, de traîtres, de criminels, qui ait jamais rampé sur le sol terrestre. Et j'y inclus mes propres rejetons."
L'événement fondateur de ce roman est le suivant : Godfrey est mort. C'était en 1942 lors d'une mission secrète au-dessus de Berlin. Alors qu'il volait, son avion fut abattu par un tir allemand - et ç'aurait pu être la fin de l'histoire ou, éventuellement, le début d'un roman de guerre comme on en connaît beaucoup si l'auteur n'était pas Jonathan Coe. Rien de tout cela ici car entre à son tour en jeu le personnage qui va tout chambouler : la soeur de Godfrey, Tabitha. Celle-ci refuse de voir dans cette tragédie un événement banal de la guerre et accuse son frère aîné Lawrence du meurtre de son cadet. Vous imaginez le tollé. Entre stupéfaction générale, dénégations méprisantes de Lawrence et théories conspirationnistes, Tabitha est internée dans un établissement psychiatrique duquel elle ne sortira qu'épisodiquement. Cela ne l'empêche pas de ruminer âprement la situation et n'entache en rien sa certitude de la culpabilité de son frère. Une démonstration flagrante en est d'ailleurs faite quelques dizaines d'années plus tard, tandis qu'elle bénéficie d'une sortie exceptionnelle pour les cinquante ans du benjamin de la fratrie, Mortimer.
Entre parallèlement en scène Michael Owen, écrivain blasé et inactif bien peu séduisant. L'époque a changé : nous sommes en 1990. Il a la quarantaine solitaire et négligée, ne sort plus de chez lui et n'interagit plus avec ses semblables. Quelques années auparavant, en 1982 exactement, il avait été débauché par la Peacock Press sur injonction d'une Tabitha vieillissante mais toujours obnubilée, pour raconter l'histoire de la tonitruante famille Winshaw. La fratrie d'origine n'était déjà pas géniale mais alors les rejetons, une tripotée de cousins arrivistes et cyniques, décrochent la timbale. Alors que Michael avait totalement lâché le projet, l'intervention inopinée d'une voisine va le motiver à se plonger à nouveau dans ses premiers travaux de recherche. En alternance avec la vie passée, présente et future de ce quadra auquel on s'attache finalement, le lecteur découvre tour à tour chacun des cousins Winshaw, exploitant tous un filon lamentable de notre société contemporaine capitaliste. Qui la télévision, l'art contemporain, la politique ou l'agriculture : tout y passe avec une acuité aiguë et une ironie cinglante de haute volée.
J'ai également pris une ferme décision pour le mot "hôpital". Ce mot est exclu de nos discussions : nous parlons désormais d'"unités pourvoyeuses". Car leur seul but, dans le futur, sera de pourvoir à des services qui leur seront achetés par les autorités et par les médecins en vertu de contrats négociés. L'hôpital devient un magasin, les soins deviennent une marchandise, tout fonctionne selon les règles des affaires : produire beaucoup, vendre bon marché. La magnifique simplicité de cette idée m'émerveille.
J'ai adoré ce roman mais c'est presque délicat de l'avouer. Une part de moi, indéniablement, a savouré cette tendance typiquement anglaise d'appuyer là où ça fait mal avec le sourire. Testament à l'anglaise est un exemple de situations parfois absurdes, souvent inattendues, convergeant toutes vers une des plus grosses gifles littéraires désinvoltes de la fin du XXème siècle. Une autre part de moi, pourtant, a beaucoup de mal à se réjouir de cette satire quand tout, absolument tout, ce qui est dévoilé est vrai et, surtout, quand tout cela se poursuit dans la même direction vingt-cinq ans après la première parution du roman. C'est véritablement terrifiant. Aussi, mes scrupules ne tiennent pas à la qualité du roman, qui est excellente, mais plutôt au propos qui fait froid dans le dos. Jonathan Coe lève le voile sur l'époque Thatcher avec tellement de pertinence, de légèreté et d'originalité que cela relève du sacré tour de force (j'allais écrire génie, hésitant sur le mot, le trouvant peut-être trop fort ? N'empêche que si ce n'est pas le cas, on n'en est vraiment pas loin).
En parlant de tour de force, je ne vous ai encore pas dit grand chose de la forme. J'évoquais tout à l'heure l'alternance des récits. Lorsqu'on entame le roman, on commence par se perdre un peu dans toute la galerie des personnages Winshaw (merci à l'éditeur de fournir gracieusement un arbre généalogique, d'ailleurs!) puis on attaque franchement dubitatif l'existence de Michael Owen. On se dit pendant un bon paquet de pages qu'on a un roman bien écrit sur ce principe assez classique de récits parallèles. C'est évidemment une erreur. Le roman est un puzzle. Peu importe à quel point cette métaphore est éculée ; elle convient trop bien à la construction narrative brillante de l'intrigue. Les récits alternés sont des leurres simplistes à l'intérieur desquels se cache en fait une myriade d'indices - a priori anecdotiques - qui se répercutent au fil du récit sous forme d'échos et dévoilent tous, progressivement, une part du mystère. On ne prête pas forcément attention à la première résonance, puis la deuxième interpelle, enfin la troisième rend le lecteur attentif aux moindres détails. Lorsqu'on en arrive à cet instant de la lecture, on est irrémédiablement scotché à la suite de l'histoire qui se referme comme un piège sur tous et tout.
"Poignardé dans le dos, hein ? dit sèchement Hilary. C'est bien approprié. Est-ce que cela veut dire que Mrs Thatcher est quelque part dans la maison ?"

 Le mois anglais chez Lou et Cryssilda + Lecture commune du Blogoclub
Le mois anglais chez Lou et Cryssilda + Lecture commune du Blogoclub
15:50 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Lecture commune, Littérature anglophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (28) | Tags : jonathan coe, testament à l'anglaise, what a carve up, politique, thatcher, agriculture, presse, édition, art, satire, ironie, critique, angleterre, écriture, écrivain, création, mois anglais, lecture commune, blogoclub
02/05/2018
Les cloches de Bâle de Louis Aragon
Le monde est une machine sanglante à laquelle les êtres se déchirent comme des doigts arrachés.
Lorsque j'étais à la fac (je ne veux pas compter les années), j'ai adoré Aurélien. Je connaissais déjà Aragon comme poète, certes, mais Aurélien fut ma première rencontre saisissante avec le romancier. A l'époque, je me suis promis de continuer à le lire, à m'en délecter... et, comme souvent avec les classiques qui promettent d'être sacrément magiques mais aussi sacrément costauds, je ne l'ai pas fait (ou presque). J'aurais pu continuer à procrastiner longtemps comme ça sans le récent billet de Nathalie sur le dit-roman et la discussion qui a suivi. Et si nous continuions l'oeuvre romanesque de l'auteur ? Et si, pour une fois, on ne s'arrêtait pas à Aurélien ? Le rendez-vous fut pris pour aujourd'hui, sans plus de tergiversations, chacune avec un titre différent. Pour ma part, l'envie était forte d'en revenir aux sources du cycle du Monde réel dont Aurélien est le quatrième tome. Les cloches de Bâle s'est donc imposé de lui-même. Et comme le disent si joliment les mots magiques d'Aragon:
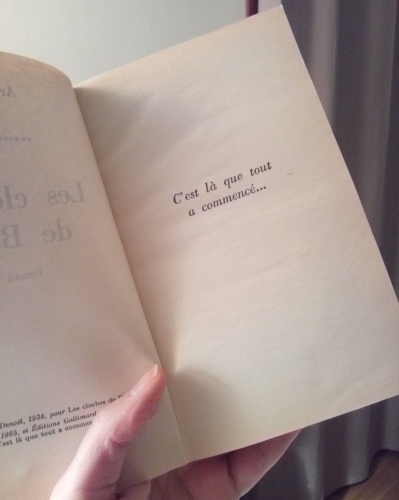
Se dessine d'emblée la dynamique du roman à travers sa construction : quatre parties, de tailles inégales, pour quatre personnages emblématiques de la Belle Epoque.
Diane de Nettecourt est une jeune noble désargentée et divorcée au début du roman. Elle incarne l'ambitieuse sociale, passant d'homme en homme malgré ses engagements dès l'instant que le suivant est plus avantageux que le précédent. Elle finit par se marier avec un certain George Brunel, financièrement très séduisant, grâce à qui elle peut mener à loisir une existence bourgeoise aussi luxueuse que vaine. Quel dommage qu'une sombre histoire de suicide vienne révéler la pathétique nature d'usurier sans scrupule de son époux...
Nous sommes des parasites. Pourquoi ne pas l'avouer ? Il n'y a là rien qui me choque. En quoi est-il mieux d'être la bête qui a des parasites, que le parasite sur le dos du bétail ? Pour moi, je pense tout au contraire que c'est là ce qui s'appelle la civilisation.
Sans transition, on passe à Catherine Simonidzé, fille d'une demi-mondaine de l'acabit de Diane (le remariage et la particule en moins ; le statut d'étrangère en plus). Catherine a vécu une première partie de son enfance dans l'opulence, tant que sa mère était suffisamment belle pour avoir plein d'amants. Et puis, du jour au lendemain, sa beauté s'est défraîchie et les amants sont partis. Puisqu'il n'a jamais été question, ni pour la mère, ni pour Catherine de travailler (faut quand même pas pousser mémé), le quotidien s'est fait plus dur et Catherine en a nourri un ressentiment violent à l'encontre des hommes et de la servitude qu'ils imposent aux femmes. Catherine se veut libre et libérée du joug social qu'on impose à son sexe. Ainsi, elle refuse le mariage, plonge à corps perdu dans les jeux de séduction divers et se lie à l'idéologie anarchiste en ce qu'elle lui semble le mieux servir sa cause. Catherine est cependant un personnage pétri de contradictions, réalisant peu à peu au fur et à mesure des années la fragilité de ses convictions si peu éprouvées à la dureté de la vie (elle n'a jamais travaillé, rappelons-le, parce qu'aussi furibarde qu'elle soit à l'égard de la domination masculine, elle préfère gentiment toucher le chèque de papa tous les mois plutôt que d'aller bosser elle-même. Lalalaaaa).
Catherine ne se faisait aucune idée de ce qu'est la journée de travail. C'est peut-être ce qui sépare avec la plus grande netteté la bourgeoisie du prolétariat. Les bourgeois parlent avec abondance de ceux d'entre eux qui travaillent. Mais le travail au bout duquel la subsistance n'est pas seule assurée, le travail dont on ne sort pas avec juste le temps nécessaire pour récupérer les forces de la journée de travail du lendemain, le travail de celui qui possède, en un mot, de celui qui amasse ne peut être comparé au travail ouvrier que par l'effet d'un abominable jeu de mots.
De cela, elle prend pleinement conscience en rencontrant Victor, le troisième personnage du roman et seul homme à incarner une partie. Victor est chauffeur de taxi et fortement engagé dans la lutte socialiste pour l'amélioration des conditions de travail des ouvriers. Catherine débarque dans sa vie au moment d'une grève des chauffeurs parisiens qui durera plusieurs mois. Il fait pénétrer la jeune féministe anarchiste dans cet univers qu'elle a toujours méprisé.
L'acmé de cette évolution s'incarne en Clara Zetkin, femme politique socialiste majeure du début du XXème siècle et figure tutélaire de la dernière partie, très courte, du roman. Elle est, pour Aragon, la femme des temps modernes. Celle qu'il a choisi de chanter.
Elle est la femme de demain, ou mieux, osons le dire : elle est la femme d'aujourd'hui. L'égale. Celle vers qui tend tout ce livre, celle en qui le problème social de la femme est résolu et dépassé. Celle avec qui tout simplement ce problème ne se pose plus. [...] Maintenant, ici, commence la nouvelle romance. Ici finit le roman de chevalerie. Ici pour la première fois dans le monde la place est faite au véritable amour. Celui qui n'est pas souillé par la hiérarchie de l'homme et de la femme, par la sordide histoire des robes et des baisers, par la domination d'argent de l'homme sur la femme ou de la femme sur l'homme. La femme des temps modernes est née, et c'est elle que je chante.
Et c'est elle que je chanterai.
Honnêtement, j'ai lutté durant toute la première partie du roman. Peut-être la merveilleuse préface des mains de l'auteur, dans laquelle il retrace la genèse du texte commencé comme un jeu surréaliste, m'a-t-elle un brin conditionnée ? En tous les cas, j'ai peiné à comprendre où l'auteur voulait en venir avec cette existence décousue de Diane, pleine de personnages divers et variés, tous plus vains les uns que les autres, et où le style lui-même saute d'un registre à l'autre, d'un discours à l'autre. On ne s'attache à personne, le sens du texte se dérobe sous les mots. C'était franchement fastidieux.
Et puis, les pièces du puzzle se mettent en place avec Catherine. Ce roman, au fond, c'est le grand virage du vingtième siècle vers notre société contemporaine. C'est la mort d'une société et la naissance d'une autre : la remise en question de la place de la femme et, conséquemment, la redéfinition des rapports homme/femme ; l'émergence de nouveaux mouvements politiques majeurs menés par des idéaux sociaux ; la conquête de libertés chéries et les contraintes qu'elles occasionnent ; une réflexion sur la place et les enjeux du travail dans la société. Ce moment où l'ordre ancien est mis à mal et où tout appelle à un nouveau souffle, un nouvel équilibre. Diane, Catherine, Victor, Clara : à eux quatre, ces personnages sont la Belle Epoque ; ils sont les quatre faces du branle du nouveau siècle. Et puis, le roman se clôt en 1912, avant la déflagration ultime : celui de la Première Guerre Mondiale. La suite au prochain numéro, Les beaux quartiers, qui réattaque exactement en 1912. A voir quelle continuation il propose.
Malgré un départ pénible, me voilà ravie d'avoir découvert ce roman sacrément riche. Il me semble avoir perçu avec ce texte, encore plus qu'avec Aurélien (mais sans doute que mes quelques années de plus - je refuse toujours de les compter - m'y aident) le génie de la construction complexe qu'était Aragon. Une foule de personnages se croisent au fil des parties, les décors s'enchaînent et se retrouvent savamment à propos, les dialogues et la narration sont d'une virtuosité assez incroyable sous des abord faussement désinvoltes, et tout, absolument tout, converge dans une perspective précise et affûtée. Les cloches de Bâle, c'est un peu la magie du kaléidoscope, en beaucoup plus politique. C'est ardu, ce n'est pas gagné, mais il impose sans concession Aragon comme un grand romancier. Bref, ce roman gagne à être lu - et, surtout, ne manquez pas de vous délecter en amont de la préface dans laquelle l'éloge qu'il fait du roman est tout simplement merveilleux ♥
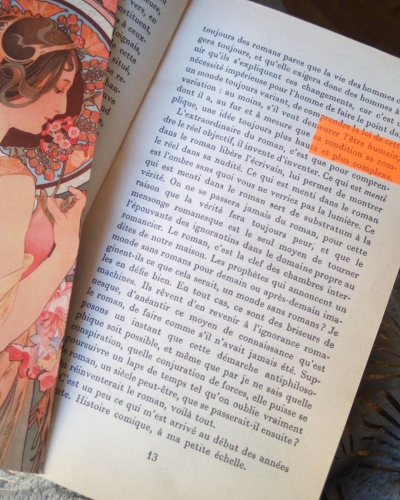
Le billet de Nathalie sur Blanche ou l'oubli est par ici.
10:29 Publié dans Classiques, Histoire, Lecture commune, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : les cloches de bâle, louis aragon, destin de femmes, diane, catherine, victor, clara, anarchisme, communisme, politique, émancipation, début de siècle, xxème siècle, guerre, amour, liberté, travail, socialisme, premier roman, cycle du monde réel
28/03/2018
Fort comme la mort de Guy de Maupassant
Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ; car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l’Éternel. les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas.
Le Cantique des Cantiques
Si Fort comme la mort nous donne à voir un artiste, il ne s'agit pas d'un artiste maudit. Olivier Bertin a joliment réussi. Il est à l'abri du besoin, très en vogue et occupe les salons - dans tous les sens du terme - de ce monde bourgeois et mondain fin XIXème comme s'il y avait toujours vécu. Sa réputation de portraitiste hors pair le conduit douze ans plus tôt à immortaliser la délicieuse Anne de Guilleroy, dont le charme n'a d'égal que son idée de la perfection. Le deuil qu'elle revêt alors le frappe, la marque d'une aura de pureté, de rigueur, de dignité qui n'est pas sans rappeler la passante baudelairienne. Au fil des ans, la passion a fait place au calme de la sécurité d'un amour qui ne réclame plus de se prouver chaque jour. Olivier Bertin et Anne de Guilleroy s'aiment toujours douze ans plus tard, ce qui est assez rare pour être noté dans cette société superficielle, mais ils s'aiment autrement. Cette sérénité, qui a quelque chose de la platitude des habitudes, suit l'évolution de l'âge pour ces deux êtres mûrs, encore superbes, mais se sentant vieillir irrémédiablement.
Lorqu'Olivier peint Anne pour la première fois, la petite Annette, sa fille, n'est qu'une enfant. C'est le temps des jeux, d'une complicité innocente et amusante. Annette et Olivier se tutoient, en toute familiarité. Après des années d'absence, Annette réapparaît. Elle est métamorphosée : elle a maintenant dix-huit ans. Sa fraîcheur, ses cheveux, sa voix. Tout en fait le portrait exact de sa mère douze ans plus tôt, croquée par Bertin. Ce dernier se pense aguerri et ne se méfie pas. Anne, plus lucide, est éclaboussée pour l'évidence : elle décline quand sa fille s'épanouit. C'est ainsi la lente glissade des êtres qui se débattent avec le temps. L'une s'accroche à l'amour, l'autre s'accroche à son image. Dans ces affres que nul ne saurait contrôler, la jalousie, l'impuissance et la passion deviennent les pires ennemis de ceux qui avaient tout mais n'ont pas supporté l'idée de leur finitude.
De cette ressemblance naturelle et voulue, réelle et travaillée,était née dans l’esprit et dans le cœur du peintre l’impression bizarre d’un être double, ancien et nouveau, très connu et presque ignoré, de deux corps faits l’un après l’autre avec la même chair,de la même femme continuée, rajeunie, redevenue ce qu’elle avait été. Et il vivait près d’elles, partagé entre les deux, inquiet,troublé, sentant pour la mère ses ardeurs réveillées et couvrant la fille d’une obscure tendresse.
Que ce roman est une étrange expérience, surtout lorsqu'on ne sait pas précisément à quoi s'attendre. Je croyais lire un roman sur la peinture ; j'ai découvert bien plus que ça. Je confesse cependant qu'à quelques reprises, mon idée préconçue m'a fait m'ennuyer de certains passages, n'en saisissant pas d'abord l'enjeu véritable. C'est qu'il s'agit de nous planter exactement la société dans laquelle s'inscrivent les personnages - ce cocon bourgeois très policé qui fonctionne en vase clos. On ne saurait mélanger les torchons et les serviettes. Savoir cela, y plonger les mains complètement, c'est mieux comprendre les passions ensuite qu'ils ressentiront. Car il y a quelque chose de privilégié, indéniablement, pour Bertin comme pour la Comtesse, à se torturer de réflexions intenses lorsqu'on n'a pas à se demander comme dormir ou manger. J'ose penser néanmoins qu'à travers l'interrogation de la finitude, et connaissant l'ironie de Maupassant, il y a là une critique de cette société soumise aux mêmes lois de la nature que toutes les autres. Le monde change ; ainsi les sociétés que l'on croyait éternelles.
Au-delà du préjugé social, Olivier Bertin, c'est nous. Sur le déclin, dès le départ. De cela, nous sommes conscients. Mais lorsque ce déclin commence à être flagrant, à se ressentir au quotidien et sous les yeux d'êtres florissants, en pleine jeunesse, d'une lumière qui devient aveuglante, la sérénité est plus délicate à trouver. Aussi Bertin se débat-il et ne parvient-il pas à trouver la paix dans cette fuite du temps. On est tenté de le juger sévèrement bien des fois, du moins je l'ai été, et la pitié rôde dangereusement à mesure que les pages se tournent. Et puis finalement, ce roman m'a fait l'effet d'un ébouriffant Memento mori. Personne n'est au-dessus des doutes, des peurs, des regrets. Qui sait l'effet que le passage de certains âges nous fera ? En attendant, nous sommes ici, maintenant.
Un mot, cependant, avant d'en finir (avec cette chronique seulement) sur l'écriture de Maupassant. Les premières pages sont d'une beauté impressionniste qui n'a peut-être d'égal que celle de Zola. La lumière est là, les reflets vibrent, la couleur foudroie. Je me régale toujours de cette écriture naturaliste si picturale, si caractéristique d'un dialogue aimé entre les arts. A mesure que l'ombre s'avance sur Anne et Olivier, l'écriture se resserre : il ne s'agit pas de brosser à grands traits une gigantesque toile où l'on ne saurait donner de la tête mais de croquer nerveusement les instants décisifs. Je n'ai jamais été grande lectrice de Maupassant, la faute sans doute à sa fréquente prédilection pour le format de la nouvelle qui ne m'émoustille que peu. Sur le tard, je m'aperçois que je suis longtemps passée à côté d'un écrivain extraordinaire du XIXème. Prendre de l'âge me permet donc, en l'occurrence, de réparer le défaut que j'avais eu d'évincer inconsciemment Maupassant de mes lectures potentielles. Que les futures années qui viennent sont belles (malgré les rides) si elles m'offrent de découvrir encore d'aussi beaux textes !
Le jour tombait dans le vaste atelier par la baie ouverte du plafond. C'était un grand carré de lumière éclatante et bleue, un trou clair sur un infini lointain d'azur, où passaient, rapides, des vols d'oiseaux.
Mais à peine entrée dans la haute pièce sévère et drapée, la clarté joyeuse du ciel s'atténuait, devenait douce, s'endormait sur les étoffes, allait mourir dans les portières, éclairait à peine les coins sombres où, seuls, les cadres d'or s'allumaient comme des feux. La paix et le sommeil semblaient emprisonnés là-dedans, la paix des maisons d'artistes où l'âme humaine a travaillé. En ces murs que la pensée habite, où la pensée s'agite, s'épuise en des efforts violents, il semble que tout soit las, accablé, dès qu'elle s'apaise. Tout semble mort après ces crises de vie ; et tout repose, les meubles, les étoffes, les grands personnages inachevés sur les toiles, comme si le logis entier avait souffert de la fatigue du maître, avait peiné avec lui, prenant part, tous les jours, à sa lutte recommencée. Une vague odeur engourdissante de peinture, de térébenthine et de tabac flottait, captée par les tapis et les sièges ; et aucun autre bruit ne troublait le lourd silence que les cris vifs et courts des hirondelles qui passaient sur le châssis ouvert, et la longue rumeur confuse de Paris à peine entendue pardessus les toits.
13:13 Publié dans Art, Classiques, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : art, peinture, peintre, paris, xixème siècle, vieillissement, mort, amour, réflexion, bourgeoisie, réalisme, naturalisme, maupassant




