29/10/2012
La théorie des cordes de José Carlos Somoza
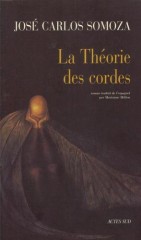
La théorie des cordes de José Carlos Somoza, ed. Actes Sud, Coll. Lettres Hispaniques, 2007, 514p.
Comme je vous l'avais dit dans ma chronique de La caverne des idées le mois dernier, on retrouve systématique deux ingrédients dans les romans de Somoza et celui-ci comme les autres, ne dérogent à pas cette règle.
Un univers particulier tout d'abord, la plongée dans un monde érudit que l'auteur triture pour l'interroger. Comme le titre de l'ouvrage l'indique, il a cette fois jeté son dévolu sur la physique contemporaine et cette fameuse théorie des cordes qui admet l'existence hypothétique de plusieurs dimensions que nous ne pouvons percevoir, notamment celles du temps. Dès lors, Somoza met en scène plusieurs chercheurs, philosophes des sciences, anthropologues et bien sûr physiciens, pour participer à un programme mystérieux sur ce sujet, financé par un fonds privé. Elisa Robledo, notre protagoniste, est l'un deux. Recrutée par l'éminent David Blanes, elle y découvre la possibilité d'isoler certaines cordes de temps et de les "ouvrir" littéralement avec suffisamment d'énergie, afin d'observer des évènements passés.
Et puis, dès lors, des ficelles tenants de la SF et du thriller se mettent en place. A l'excitation d'approcher un enjeu scientifique aussi majeur, succède apidement l'inquiétude, l'angoisse puis la terreur viscérale d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Et dix ans après chez les personnages encore en vie, celle-ci est toujours vivace. Car depuis les premiers travaux, des participants au projet ont commencé à disparaître dans des circonstances non seulement étranges mais surtout épouvantables. Et lorsqu'Elisa, en 2015, empoigne un journal et découvre qu'un nouveau membre est assassiné en Italie, elle se laisse submerger par la peur et déroule enfin le fil du passé à son ami Victor Lopera.
Comme toujours, je suis très bon public avec les romans de Somoza. Je me fais prendre sans discuter dans le suspens haletant et je bois les pages comme une tasse de thé, sans voir le temps passer. Je crois qu'il ne m'est arrivé qu'avec lui de rester scotchée des heures sur un livre au point de ne pas m'apercevoir de la nuit tombée. En outre, j'ai découvert grâce à ce roman des problématiques scientifiques qui étaient parfaitement inconnues à la franche littéraire que je suis (et je ne regarde même pas Big Bang Theory, vous imaginez!) - j'ai ainsi approché rapidement la question de la relativité, des dimensions, et du temps de Planck. Somoza a non seulement le don de vulgariser avec justesse des domaines parfois abscons mais aussi d'en tirer une dynamique accrocheuse et passionnante qui toujours me surprend et qui, pour moi, tient vraiment du génie littéraire.
Néanmoins, malgré cette attirance personnelle pour l'auteur, je tâche de ne pas en perdre mon objectivité littéraire et je dois bien reconnaître que j'ai présentement quelques petites choses à lui reprocher.
Tout d'abord, à force de le lire, je supporte de moins en moins le problème qu'il entretient visiblement avec la gente féminine - et en tant que psychanalyste de formation, il devrait vraiment songer à le soigner. A part La caverne des idées, son premier roman pour lequel il n'avait visiblement pas encore trouvé ce "truc" qu'il reproduit depuis, chaque ouvrage de Somoza est affublé d'une bonnasse décrite abondamment et habillée les 3/4 du temps comme une péripatétitienne, évidemment supérieurement intelligente, avec un mental à toute épreuve blah blah blah. Bref, Somoza fantasme sur Lara Croft et donc, logiquement, on se tape l'ersatz de Lara Croft dans tous ses bouquins. Je dois vous avouer que c'est profondément lassant à la longue. Honnêtement, dans un ou deux bouquins pourquoi pas, surtout si ça sert l'histoire. Mais dans tous les bouquins ?! Ca frise le manque d'originalité voire la fixette pitoyable.
Ensuite, on pourrait reprocher à La théorie des cordes une progression lente, peut-être trop lente, de l'intrigue. Elle met un certain temps à décoller - un peu comme dans le deuxième tome de Millenium, vous voyez ? Au bout de 150 pages, on est toujours pas dans le vif du sujet, et Elisa Robledo ne cesse de dire "Et c'est alors que le pire est arrivé" mais en fait non. En parlant de ça, à force d'attendre le pire, on l'attend finalement comme le Messie et le danger, dans tout ça, c'est d'être un poil déçu. Cela n'a pas été mon cas ici, mais avec un suspens aussi grossier relancé si souvent, cela ne m'étonnerait pas que d'autres que moi plus habitués à des thrillers SF se lassent franchement.
Pour conclure, La théorie des cordes a été pour moi une lecture parfaitement réussie : j'ai accroché tant au sujet traité, aux hypothèses émises et aux réflexions soulevées sur l'éthique scientifique qu'au suspens enlevé. Je suis persuadée qu'il saura séduire des lecteurs habituellement peu portés sur la thématique ou la forme du thriller. Les plus connaisseurs par contre, déploreront sans doute une spéculation scientifique et une progression narrative un peu grossières. Mais ceux-ci pourront se tourner vers d'autres horizons de lecture. Il en faut pour tous les goûts !
*
09:00 Publié dans Coups de coeur, Littérature hispanique, Polar | Lien permanent | Commentaires (6)
25/10/2012
14 de Jean Echenoz

14 de Jean Echenoz, Les éditions de Minuit, 2012, 124p.
Tandis qu'Anthime pédale un samedi à travers la campagne vendéenne, le tocsin résonne à perdre haleine pour annoncer la déclaration de guerre. Et Anthime de rentrer chez lui aussi vigoureusement qu'il était parti, laissant tomber au passage son livre ouvert sur cette citation providentielle - extraite de Saint Paul, à moins que ce ne soit de Victor Hugo - Aures habet, et non audiet ; "Il a des oreilles mais il n'entendra pas".
Car en effet, les oreilles ont capté les cloches mais elles n'ont pas entendu le danger qu'elles annonçaient. Sur la place du village, Anthime a rejoint ses amis Arcenel, Padioleau et Bossis puis son frère Charles. Tous les hommes s'égayent, se tapent dans le dos, partent boire un coup, persuadés que la guerre ne durerait que deux semaines. Non, ils n'ont pas entendu.
Dès lors, c'est le départ et ce que l'on sait, ou ce que l'on croit savoir de cette première guerre mondiale : la marche, la fatigue, les batailles et les tranchées, les blessures, les morts diverses mais toujours atroces, les femmes qui attendent, le retour qui n'a rien d'heureux et la vie malgré tout qui continue avec étonnement.
14 me fait l'effet d'un petit projectile, furtif certes, mais surtout parfaitement ciselé. On a peine à imaginer de prime abord cerner la guerre de 14-18 en si peu de pages, pourtant cet ouvrage montre que tout est affaire de style maîtrisé. Moi-même dubitative, je n'ai pu que me rallier à la posture narrative qui semblait en effet ne pas appeler plus de détails tant tout était là - des évènements quotidiens à l'énumération précise du matériel militaire. Je ne saurais faire de généralité concernant le style de Jean Echenoz puisqu'il s'agit ici de ma première lecture de cet auteur, néanmoins cet ouvrage est une parfaite expression de l'écriture blanche que les néophytes ont souvent tendance à qualifier de non-écriture - car après tout, qu'est-ce que le style si on lui enlève les envolées lyriques, la subjectivité narrative, les descriptions à tire l'arigot, j'en passe et des meilleures? Et bien, dès lors, vous avez un style incisif, tout en hauteur, en précision et en rapidité. Une sorte de flèche où les longs romans font figure de convoi exceptionnel.
Je ne vous mentirai pas, cependant : j'ai toujours un penchant bien plus prononcé pour les dits convois exceptionnels et même si mon oeil de littéraire de formation reconnait la qualité indiscutable de 14, je ne parviens pas encore tout à fait à déterminer si ma pure subjectivité de lectrice s'est délectée de cette lecture ou s'en est plutôt trouvée frustrée. Après tout, j'ai dans l'idée de cette guerre un marasme profond, une douleur persistante et sourde que je n'ai pas retrouvé dans ce projectile si rondement mené. Et puis cette parfaite blancheur lorsqu'il s'agit d'évoquer les vies brisées mais laisse un peu sur ma faim.
Je n'en regrette pourtant pas ma lecture - intéressante découverte d'un style travaillé, aérien et extrêmement bien mené. A savoir si j'irai spontanément me pencher sur d'autres ouvrages du même auteur, ce n'est pas dit. Il m'a par contre grandement donné envie d'aller voir du côté d'Ernst Jünger dont le récit de cette guerre m'attend justement dans ma PAL.
*
"C'est alors qu'après les trois premiers obus tombés trop loin, puis vainement explosés au-delà des lignes, un quatrième percutant de 105 mieux ajusté a produit de meilleurs résultats dans la tranchées : après qu'il a disloqué l'ordonnance du capitaine en six morceaux, quelques-uns de ses éclats ont décapité un agent de liaison, cloué Bossis par le plexus à un étai de sape, haché divers soldats sous divers angles et sectionné longitudinalement le corps d'un chasseur-éclaireur. Posté non loin de celui-ci, Anthime a pu distinguer un instant, de la cervelle au bassin, tous les organes du chasseur-éclaireur coupés en deux comme sur une planche anatomique, avant de s'accroupir spontanément en perte d'équilibre pour essayer de se protéger, assourdi par l'énorme fracas, aveuglé par les torrents de pierres, de terre, les nuées de poussière et de fumée, tout en vomissant de peur et de répulsion sur ses mollets et autour d'eux, ses chaussures enfoncées jusqu'aux chevilles dans la boue"
pp 81-82
 Challenge de la rentrée littéraire 2012
Challenge de la rentrée littéraire 2012
Et de 2 !
09:00 Publié dans Challenge, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (5)
22/10/2012
Le Ventre de Paris d'Emile Zola
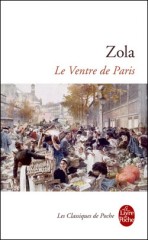
Le Ventre de Paris d'Emile Zola
Voilà plusieurs années, Florent a été condamné à tort au bagne. Il finit par s'en évader et, après un périple éreintant, rejoint enfin Paris dans la charette à légumes de Madame François. C'est ainsi qu'immédiatement le lecteur pénètre avec lui dans le vrai protagoniste de ce troisième volet des Rougon-Macquart : Les Halles centrales de Paris - ce grand corps monstrueux et affamé de vies, comme ont pu l'être les mines de Germinal ou le grand magasin d'Au bonheur des dames. Car toute l'intrigue de ce roman a pour principal prétexte l'exposé de ce ventre de Paris, cette pieuvre gigantesque dans lequel ou autour duquel s'entasse tout un débordement de nourriture, des poissons aux fruits en passant par le beurre, les pâtés ou les pains ; où se tissent et se défont les relations humaines qui ne tiennent qu'à un fil.
"Elles étaient sans cesse là. Il ne pouvait ouvrir le fenêtre, s'accouder à la rampe, sans les avoir devant lui, emplissant l'horizon. Il quittait les pavillons, le soir, pour retrouver à son coucher les toitures sans fin. Elles lui barraient Paris, lui imposaient leur énormité, entraient dans sa vie de chaque heure. Cette nuit-là, son cauchemar s'effara encore, grossi par les inquiétudes sourdes qui l'agitaient. [...]
C'étaient les Halles crevant dans leur ceinture de fonte trop étroite, et chauffant du trop-plein de leur indigestion du soir le sommeil de la ville gorgée."
Florent, donc, y rejoint son frère Quenu, propriétaire d'une aimable charcuterie rue Rambuteau avec sa femme, la belle Lisa. C'est par elle que l'on se rattache à l'obscure famille Macquart : Petite-fille d'Adélaïde, la doyenne héroïne de La forture des Rougon, elle est également la soeur de Gervaise, héroïne de l'Assommoir, la tante de Claude, héros de l'Oeuvre que l'on retrouve ici en guide nomade et mystérieux, et la mère de Pauline, héroïne de La joie de vivre (et on pourrait continuer l'énumération encore longtemps).
Lisa est de ces belles femmes de l'époque, appréciée pour sa fraîcheur, ses formes opulentes, et son honnêteté à toute épreuve. Elle n'hésite pas à accueillir Florent sous le toit du ménage et à lui proposer sa part sur l'héritage de l'oncle Granelle. On comprend pourtant rapidement que toute cette probité souriante est surtout l'expression d'une pensée bien comme il faut, d'un petit esprit bourgeois qui n'aspire qu'au confort sans trop se mouiller. Lisa ou la figure de cette petite bourgeoisie que Zola fustige, dont il montre toute l'étroitesse d'esprit et tout l'égoïsme aveugle. A lire certains passages, on est choqué par l'actualité mordante du propos...
"- [...] Certainement que je profite du bon moment et que je soutiens le gouvernement qui fait aller le commerce. S'il commet de vilaines choses, je ne veux pas le savoir. Moi, je sais que je n'en commets pas, je ne crains point qu'on me montre du doigt dans le quartier. Ce serait trop bête de se battre contre les moulins à vent... Tu te souviens, aux élections, Gavard disait que le candidat de l'empereur était un homme qui avait fait faillite, qui se trouvait compromis dans de sales histoires. Ca pouvait être vrai, je ne dis pas non. Tu n'en as pas moins très sagement agi en votant pour lui, parce que la question n'était pas là, qu'on ne te demandait pas de prêter de l'argent, ni de faire des affaires, avec ce monsieur, mais de montrer au gouvernement que tu étais satisfait de voir prospérer la charcuterie."
Florent, quant à lui, fait presque figure de martyr. Embauché comme remplaçant au poste d'inspecteur des poissonniers, aux Halles, il n'hésite pas à verser l'intégralité de son salaire au titulaire du poste près de mourir. Il n'hésite pas non plus à investir temps et argent à un projet démocratique qui lui tient à coeur. De toutes ces bonnes intentions, il ne retire que la médisance des demoiselles aigries du quartier - un beau ramassis de poules cinglantes et ridées par le mépris - et la méfiance galopante de Lisa, uniquement concerné par la subsistance de son petit empire. Il faut pourtant se garder de tout manichéisme, car le malheur de Florent n'arrive pourtant pas sans crier gare et ce projet de révolution arrive bien trop grossièrement dans un quartier qui ne l'appelait pas.
Et puis au-delà de l'intrigue : les Halles sublimées par l'écriture de Zola - maître parmi les maîtres. Je ne suis pourtant pas fan des descriptions à n'en plus finir mais comment ne pas se délecter ici des pages florissantes, de tous ces étalages gourmands sous le soleil parisien. En vrai peintre impressionniste, Zola manie les mots comme Claude maniera les couleurs et ces Halles voraces scandent au fil du roman l'esprit de ses habitants. Tout d'abord havre de paix, figure d'un paradis terrestre, d'une opulence chatoyante retrouvée après les années du bagne, elles deviennent progressivement pourriture et monstre, à l'image de la dégradation de toute cette société commerçante.
"Le jour se levait lentement, d'un gris très doux, lavant toutes choses d'une teinte claire d'aquarelle. Ces tas moutonnants comme des flots pressés, ce fleuve de verdure qui semblait couler dans l'encaissement de la chaussée, pareil à la débâcle des pluies d'automne, prenaient des ombres délicates et perlées, des violets attendris, des roses teintés de lait, des verts noyés dans des jaunes, toutes les pâleurs qui font du ciel une soie changeante au lever du soleil ; et, à mesure que l'incendie du matin montait en jets de flammes, au fond de la rue Rambuteau, les légumes s'éveillaient davantage, sortaient du grand bleuissement traînant à terre. Les salades, les laitues, les scaroles, les chicorées, ouvertes et grasses encore de terreau, montraient leurs coeurs éclatants ; les paquets d'épinard, les paquets d'oseille, les bouquets d'artichaut, les entassements de haricots et de pois, les empilements de romaines, liées d'un brin de paille, chantaient toute la gamme du vert, de la laque verte des cosses au gros vert des feuilles ; gamme soutenue qui allait en se mourant, jusqu'aux panachures des pieds de céleri et des bottes de poireaux. Mais les notes aigües, ce qui chantait plus haut, c'étaient toujours les taches vives des carottes, les taches pures des navets, semées en quantité prodigieuse le long du marché, l'éclairant du bariolage de leurs deux couleurs."
Sans aucun doute, une de mes plus enthousiastes lectures zoliennes - car après tout, j'ai beau être une inconditionnelle, je n'en ai pas moins mes préférences. Je suis toujours autant subjuguée par tous ces tableaux, toutes ces senteurs. C'est décidément en chroniqueur acerbe de la société, les deux pieds dans sa bourbeuse humanité que je préfère Zola et Le ventre de Paris est encore une éclatante démonstration de ce talent si particulier.
 Challenge Rougon-Macquart
Challenge Rougon-Macquart
14/20
 Challenge Un classique par mois
Challenge Un classique par mois
Octobre, bis
08:51 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (10)




