14/12/2015
Neverhome de Laird Hunt
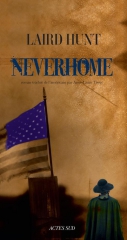
Neverhome de Laird Hunt, Actes Sud, 2015, 258p.
 Deuxième lecture de la rentrée littéraire ; deuxième coup de cœur et deuxième pépite. Vous êtes en droit, légitimement, de vous demander si trop de thé liquéfie l'esprit critique. Ou si j'ai une chance de cocue. Honnêtement, je ne sais pas quelle alternative je préfère.
Deuxième lecture de la rentrée littéraire ; deuxième coup de cœur et deuxième pépite. Vous êtes en droit, légitimement, de vous demander si trop de thé liquéfie l'esprit critique. Ou si j'ai une chance de cocue. Honnêtement, je ne sais pas quelle alternative je préfère.
Mais attendez d'en apprendre plus sur Constance devenue Ash Thompson par la magie de l'uniforme militaire. Il ne lui a pas fallu plus qu'un mari chétif et quelques casseroles personnelles pour la décider à endosser elle-même les couleurs de l'Union et partir se battre comme un homme. Sous le manteau, elle manie son Springfield 1861 à la perfection, se fait rapidement repérer pour ses talents de tireur d'élite, de chasseur et son courage sans faille. Pourtant, elle en voit de toutes les couleurs, notre héroïne travestie (veuillez m'excuser mais j'ai une vieille chanson de Mylène Farmer dans la tête, damn !). Que ce soit durant l'entraînement, au combat ou sur le chemin du retour digne de L'Odyssée, les aventures se succèdent, brèves, violentes, hallucinées. La guerre de Sécession n'aura décidément épargné personne, et surtout pas les survivants.
Pour tout vous dire, je n'ai pas pleinement adhéré dès les premières pages (l'épiphanie de Mā ne se lit pas tous les jours). J'ai d'abord sillonné à tâtons, me demandant où me portaient les mots et les pas de Constance. Des aventures certes, des épisodes du quotidien des formations de jeunes recrues, des imprévus. La faim aussi, le froid, la solitude. Les lettres envoyées au vent vers ceux qu'on aime. Constance, au début, se débat un peu avec les mots dont elle n'est pas une spécialiste. Mais tout cela à quelle fin ? Je ne savais trop le dire ou le comprendre dans les premières pages. Je me payais même le luxe de trouver le style inégal - je suis comme ça, à l'occasion : sans concession.
" La bataille dura des jours et des jours. Dans nos têtes, ces jours étaient des semaines. Dans nos rêves - nous rêvions recroquevillés en petits tas à même le sol, dur et froid - ces semaines étaient des années." p. 109
Et puis, bam ! A l'orée de la seconde partie, la guerre de Sécession attaque dure et éclabousse les visages lecteurs. On n'est plus du tout dans la promenade de santé ou l'expectative ; on se débat les deux pieds dans la boue ; comme Constance, on a les tympans crevés des balles de mousquets qui tirent à fond de cale entre les hommes et on déroule les pages comme on essaye de courir pour échapper à l'ennemi. En lieu et place d'un style méjugé inégal, j'ai découvert chez Laird Hunt une poésie tellurique, un art de manier la mort, les blessures, l'aridité de la guerre par le petit bout de la lorgnette avec une explosion ahurie et jouissive des sens. Ce qui fait vivre la guerre, pour nous lecteurs, c'est ce sensoriel exacerbé où tout devient bruit, sueur et miroitement.
"Alors je dormis. Je m'en fus voyager dans des contrées en noir et vert." p. 116
"Il devait être ensorcelé, ce tabac que j'emportai en haut dans ma chambre, car ensuite, je passai des jours entiers, quelle que fût la chaleur au-dehors, enfouie sous les couvertures dans l'obscurité, mes yeux, qu'aucune larme ne mouillait, dévorant tantôt la poussière tourbillonnant autour des planches de lumière qui entraient par les fentes entre les rideaux, tantôt l'obscurité des oreillers, tantôt seulement l'arrière de leurs propres paupières. D'autres jours, je me levai pour travailler dans le jardin, m'occuper de la cour, laver les vitres ou lessiver les planchers de l'aube au crépuscule, respirant les senteurs fraîches du monde tout au long du jour pour, vers sa fin, retourner dans cette chambre me tapir sous ces couvertures, où je cessai de me rappeler les batailles, les maisons de fous, les maris, les histoires, le souffle suave des nourrissons et les mères qui ne respectaient pas leurs propres ordres." p. 228
En outre, comme le bon vin délivre ses arômes au fil de la dégustation, on pourrait imaginer que le bon livre s'envisage avec le recul des jours. J'ai fini Neverhome depuis une petite semaine mais c'est comme si la rugosité éblouissante de Constance ne m'avait pas quittée. J'en suis encore toute habitée, avec ce sentiment savoureux d'avoir décidément fait une sacrée bonne pioche, encore, dans la rentrée littéraire 2015.
Puisqu'il convient de rendre à César ce qui lui appartient, je remercie ma copine Anne pour ça : sans son billet que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait, je n'aurais sans doute pas eu l'idée d'aller cueillir l'excellent roman que voilà à la bibliothèque (et merci aux bibliothécaires, par la même occasion!)
Et puisque je suis dans les remerciements, et puisque je relis quelques passages du roman, j'en profite pour saluer le travail de traduction d'Anne-Laure Tissut, sacrément pas piqué des hannetons ! Il fallait réussir à la restituer si poétiquement en français, la langue de Laird Hunt ! Bien joué, madame la traductrice (PS d'une lectrice pointilleuse : par contre, traduire gun par pistolet dans le contexte de la guerre de Sécession est une iniquité historique. Mieux vaut préférer arme ou arme de poing pour distinguer des armes d'épaule. A votre guise. Mais il n'y avait pas de pistolet sur les champs de batailles de la guerre de Sécession, pas plus qu'ailleurs à cette époque ; c'était des revolvers.)
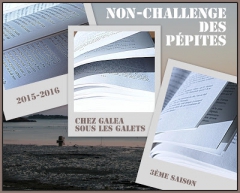 Et une deuxième pépite pour le non-challenge 2015-2016 de Galéa !
Et une deuxième pépite pour le non-challenge 2015-2016 de Galéa !
06:58 Publié dans Coups de coeur, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (15)
06/12/2015
Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, Le livre de poche, 1974 [1907], 281p.
L'époque de Noël est particulièrement propice aux lectures doudous ; on s'enroule dans un plaid, on sirote un thé (Mariage Frères, of course) et puis on enfile avidement quelques pages d'un classique bien poussiéreux, bien usé jusqu'à la corne, qui fait du bien. A défaut de faire un sapin (parce qu'avec plusieurs chats frétillants, ça s'apparente à un suicide domestique), je me paye une régression littéraire les week-ends de décembre. C'est mon petit cadeau à moi.
Cela dit, je dis "classique usé jusqu'à la corne", mais je n'avais encore jamais lu celui-là. Il a fallu que je le donne à lire à mes 5e pour considérer qu'il était de bon ton, tout de même, que je m'y colle aussi. Rouletabille y fait une entrée en fanfare - Rouletabille, à peine sorti du berceau, d'ailleurs : c'est quand on lit qu'à dix-huit ans, il est déjà brillant reporter d'un journal national qu'on se dit que le bouquin a bien vieilli - pour démêler la tentative de meurtre spectaculaire de Miss Stangerson dans une chambre totalement close. On peut tourner et virer : l'assassin n'a pas pu sortir. Où est donc le bougre ?! Non content de ce premier exploit, ce dernier le renouvelle quelques jours plus tard. C'est à croire qu'il est un fantôme. Ou qu'il n'existe pas. Ou que l'on se joue de nous.
Heureusement, à l'instar de Poirot qui fait fonctionner habilement ses petites cellules grises quand tout le monde hallucine, Rouletabille sait prendre la raison par le bon bout. L'assassin n'a qu'à bien se tenir !
Ah ! Du pouvoir des retardements en pagaille dans les vieux romans policiers ! Voilà un procédé interminable comme on en fait plus ! Dès le début du roman, on comprend que Rouletabille a compris - pas tout certes, mais l'essentiel. Il - ou plutôt le narrateur - se plait bien sûr à esquiver, à tourner autour du pot, à expliquer de mille manières qu'il faut attendre pour l'efficacité de l'enquête. Ici, ce ne sont pas tant les rebondissements qui font tourner les pages sans s'arrêter jusqu'à la fin, que ces interminables retardements. D'une manière ou d'une autre, quoiqu'il en soit, on est pendu à l'identité de l'assassin. Deux avis possibles à la fin : soit on est époustouflé par un twist savoureux, soit on est quand même tenté de se dire que c'est un peu tiré par les cheveux. Je me rangerais plutôt dans la seconde catégorie objectivement, surtout que Rouletabille, tandis qu'il se targue d'user de sa raison, use surtout d'un flair plus que discutable. Il a du bol que ces élucubrations s'avèrent justes, un point c'est tout. Mais puisque j'ai gardé une âme de gosse en lisant ce roman, j'ai gobé quand même l'invraisemblance. Après tout, je ne réclamais pas grand chose : M'évader, m'amuser, me trouver plonger dans une ambiance, une société et des us et coutumes parfaitement désuets qui fleurent bon le vingtième siècle qui vient de naître. J'ai été servie de ce côté-là. En outre, Rouletabille, comme tous les grands détectives littéraires, est un mélange savamment dosé de figure attachante et de prétention surfaite. C'est un parfait Poirot adolescent, sans moustache et avec l'énergie en plus. je n'en demandais pas plus ! Voilà donc un fort bon week-end passé en la compagnie de Rouletabille, Larsan, Darzac et Stangerson. Il ne manque plus que quelques cookies maison pour parfaire le tableau, que je vais m'employer derechef à pâtisser en regardant l'adaptation ciné de Bruno Podalydès ! Noël is comiiiiiing !
14:28 Publié dans Classiques, Littérature française et francophone, Polar | Lien permanent | Commentaires (10)
01/12/2015
Mā de Hubert Haddad
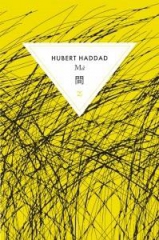
Mā de Hubert Haddad, Zulma, 2015, 246p.
"La marche à pied mène au paradis ; il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir, mais il faut marcher longtemps. Avant d'en connaître l'épreuve, je fréquentais assidûment un des bars lilliputiens de la plus étroite des ruelles de Golden Gai, dans la zone est de Tokyo, à proximité de Kabukicho ; les touristes occidentaux, en file indienne sur les chaussées, aiment y retrouver l'ambiance des vieux films de l'après-guerre, au temps de l'occupation américaine. La pègre voisine n'encombre qu'incidemment les Six Ruelles, même si les filles et les noceurs de Kabukicho s'y égarent à l'occasion. Carré de baraques joliment décorées en plein coeur de Shinjuku, Golden Gai est un bout de quartier plutôt tranquille fréquenté par les ronds-de-cuir et les représentants de commerce solitaires habitués des hôtels capsules, quelques cérébraux, des originaux mélancoliques, poètes et barbouilleurs, toute cette bohème noctambule des comptoirs." p.9
 Mā, quel étrange titre pour les européens que nous sommes ! A la fois plein de mystère et vaguement ridicule, ce simple kanji dit pourtant tout l'espace qui relie les éléments du monde dans une harmonie imperceptible. Au fil des pages, à l'image de ce titre taoïste, Hubert Haddad raconte une magnifique histoire de reliance éminemment poétique.
Mā, quel étrange titre pour les européens que nous sommes ! A la fois plein de mystère et vaguement ridicule, ce simple kanji dit pourtant tout l'espace qui relie les éléments du monde dans une harmonie imperceptible. Au fil des pages, à l'image de ce titre taoïste, Hubert Haddad raconte une magnifique histoire de reliance éminemment poétique.
En des époques différentes, deux Shōichi prennent la route. L'un porte en lui la blessure profonde du suicide de sa mère qu'il noie de poésie et de saké. Après quelques tentatives pour vivre sédentaire, c'est dans la marche que ce Shōichi là, devenu Santōka par la magie des pseudonymes littéraires, découvre comment vivre l'instant présent. Entre les pas, Santōka envoie ces haïkus au vent, à la lune et à son éditeur. C'est ainsi qu'on le connait plus d'un siècle après son existence solitaire.
C'est ainsi que Saori lui voue une admiration sans borne. Elle, la quadragénaire fraîchement divorcée qui lui dédie une biographie fouillée dans laquelle elle se permet d'intervenir. Elle, qui se pique d'un jeune serveur sous prétexte qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Cet autre Shōichi portera à son tour une blessure : celle de trop aimer Saori qui s'en moque, au fond, et qui disparaît subitement. Laissé seul, désemparé, sans repère, c'est encore une fois la mort qui précipite le malheureusement dans l'errance sans fin. Shōichi choisit malgré lui d'aimer Saori jusqu'au bout en devenant celui qui l'a fasciné : un bougre vagabond.
"Le voyageur, après combien de haltes où nul ne l'espère, se dissout à la fin aux boucles du voyage sans rien avoir appris des espaces. On marche si longtemps, des années, pour oublier ; on pourrait très bien mourir à chaque pas, c'est pour ça qu'on avance. Il faut savoir s'arrêter n'importe où, à n'importe quel moment, et prendre avec délicatesse le pouls de l'impermanence. Si les saisons et les jours sont les enfants du temps, chaque instant est un temple." p. 69
Un nouveau roman "japonais" de Hubert Haddad, c'est un appel délicieux que je ne pouvais pas manquer. J'avais encore des impressions très douces de son Peintre d'éventail, sans doute l'un de mes plus agréables souvenirs récents de lecture. Je ne m'attendais à rien, pourtant, de ce nouveau titre, par peur d'être déçue. Et puis, dès la première page, je retrouve ce même souffle fabuleux qui me transporte. Je découvre à quel point j'aime Hubert Haddad, à quel point je le trouve inspiré, précieux dans le style mais juste dans la perception de l'esprit Zen, aérien et subtil, tout en volutes. Il faut dire que je suis sensible à l'esprit japonais suranné et spirituel qu'il évoque à travers la vie dépouillée de Santōka. D'aucuns pourront parler de clichés qui ne reflètent plus le Japon contemporain. Mais j'aime ce Japon qui subsiste malgré tout dans tout le quotidien du pays et Haddad le livre avec une telle poésie que j'en voudrais bien des clichés tous les jours.
Mā, c'est un roman qui peine à se décrire ; c'est avant tout un esprit qui circule entre les êtres et appelle à concevoir les années qui séparent, la mort ou le désamour, comme autant de cordes invisibles qui maintiennent au contraire tous en un même cercle. C'est le roman des destinées oubliées, qui se sont toujours tracées en marge des douleurs et des lumières aveuglantes. Mā nous raconte avec un sacré talent comment la simplicité peut être source du sublime.
"Les années passent, semblables aux lanternes célestes qui se dispersent très haut et s'éteignent parmi les étoiles. Le passé n'est passé de rien, le futur nous effleure à peine, et tout se résorbe dans l'instant présent." p. 104
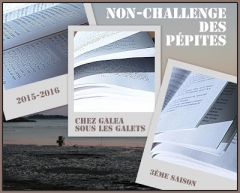 Et une sacrée pépite pour le non-challenge 2015-2016 de Galéa, une !
Et une sacrée pépite pour le non-challenge 2015-2016 de Galéa, une !
15:17 Publié dans Coups de coeur, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (12)




