08/04/2016
Paix sur les champs de Marie Gevers
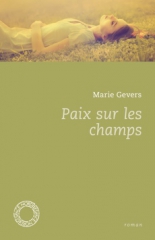
Paix sur les champs de Marie Gevers, Espace Nord, 2013 [1941], 231p.
Le printemps ne va pas tarder, sur les champs en Campine. En attendant, une obscure brume de février préside à la rencontre de Julia, une jeune fille élevée par sa grand-mère Anna, et Louis Vanasche, un émondeur un peu effronté. Leurs maisons respectives sont les deux premières que le lecteur découvre. Il entrera encore dans celle d'Aloysius, un vieux rebouteux un peu devin, censé comprendre les forces secrètes qui régissent alors les campagnes, celle de Jules, le frère d'Anna et celle de Johanna et Lodia. A mesure que l'on avance entre les amours malheureuses de Julia et Louis et entre les morts d'Aloysius et d'Anna, on dénoue le fil d'une vieille rancœur de sang entre Johanna et les Vanasche, qui s'enroule autour du fantôme de la première Lodia, morte assassinée et dont la mort n'a jamais été ni jugée ni pardonnée. L'amour, lumineux, tentera de démêler les erreurs du passé et les héritages trop lourds à porter pour offrir un avenir où le meurtre et la sorcellerie ne sont pas des tares héréditaires.
Et voilà que je découvre en refermant ce beau roman qu'il est le deuxième d'un diptyque consacré à la campagne campinoise. C'est donc malheureusement sans connaître La ligne de vie, le passé de certains personnages, la problématique de l'amour incestueux et des guerres d'un village à l'autre que j'ai lu Paix sur les champs qui se déroule une génération plus tard. Les jeunes ignorent pour la plupart ce qui a motivé la haine et la rancœur entre les familles. Ils ne veulent que s'aimer et concrétiser le sentiment le plus simple et, pensent-ils, le plus pur. Pourtant, les souvenirs serpentent entre eux, dans le noir des mots tus, et grèvent la simplicité de leurs amours. Il est aussi question de toutes ces nuances de ce sentiment qui ne saurait être juste et bon que dans le cadre du mariage. Aussi, Louis oscille entre celle qui se donne et enfante en dehors du sacrément qui donnerait une légitimité à la descendance et celle qui se refuse, dans l'espoir du droit chemin et du consentement maternel. On pénètre ainsi dans un univers rural archaïque, pétri de superstitions, de croyances occultes, de traditions rigides malgré cette période de l'entre-deux guerres qui a apporté bien des évolutions. Le monde bouge, évolue, mais encore un peu loin de ces familles qui devront attendre Louis et Lodia pour tenter de secouer le grand arbre séculaire et émonder les vieilles rancunes.
Comme toujours avec Marie Gevers, c'est une lecture passionnante, servie par une langue poétique d'une grande pureté et d'une maîtrise impeccable. On soulève un pan de la petite histoire de jadis, dans les campagnes oubliées, qui mérite pourtant d'être découvert. Merci à Anne et Mina de m'en donner encore une fois l'occasion lors de ce nouvel avril belge.
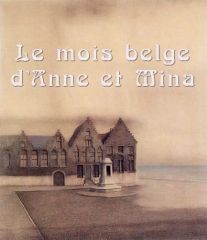 Deuxième participation au mois belge 2016 d'Anne et Mina
Deuxième participation au mois belge 2016 d'Anne et Mina
Rendez-vous autour d'un classique
06:50 Publié dans Challenge, Classiques, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (10)
03/04/2016
Kinderzimmer de Valentine Goby

Kinderzimmer de Valentine Goby, Actes Sud, 2013, 218p.
 N'est pas Valentine Goby qui veut. Comprendre par là : comment parvenir à mettre des mots sur ce roman, qui lui rendent hommage sans le déflorer, et comment mettre des mots sur les camps de concentration, puisque tel est le lieu du roman ? Je tourne autour du pot, j'écris puis j'efface, j'hésite mais il me faut bien arriver au bout de quelque chose. Il faut bien mettre des mots sur cette lecture passionnante et bouleversante à tous points de vue.
N'est pas Valentine Goby qui veut. Comprendre par là : comment parvenir à mettre des mots sur ce roman, qui lui rendent hommage sans le déflorer, et comment mettre des mots sur les camps de concentration, puisque tel est le lieu du roman ? Je tourne autour du pot, j'écris puis j'efface, j'hésite mais il me faut bien arriver au bout de quelque chose. Il faut bien mettre des mots sur cette lecture passionnante et bouleversante à tous points de vue.
Le camp est une régression vers le rien, le néant, tout est à réapprendre, tout est à oublier.
Il faut plonger à Ravensbrück, se faire la puce sur l'épaule de Mila qui s'y trouve avec des milliers d'autres femmes, avec sa cousine Lisette, après une dénonciation. Mila est prisonnière politique. Nous sommes en janvier 1944 et, jusqu'à la fin de la guerre, elle ne codera plus de messages sur des partitions musicales. Elle va connaître, heure après heure, minute après minute, seconde par seconde, la faim, le froid, la honte, la douleur, la maladie. La mort enfin, partout autour, qui pullule comme les poux. Même cet enfant que porte Mila est signe de mort : peut-il seulement y avoir une étincelle de vie dans cet univers noir ? La survie, seulement.
Il n'y a pas un bébé dans ce camp, pas une mère parce que mettre au monde c'est mettre à mort.
Et puis Mila échappe au chien des surveillantes. Pour une raison qu'elle ignore, il ne l'attaque pas. Elle prend ça comme un signe fort, qui reviendra souvent : "Le chien n'a pas mordu", comme une litanie pour croire encore en quelque chose de possible pendant le camp, après le camp. Des amitiés de fortune mais fortes, essentielles se nouent. Surtout celle avec Teresa qui devient la branche sur laquelle s'appuyer pour aider le petit être dans le ventre de Mila à arriver à terme, à survivre lui aussi. Sans le savoir, il devient la branche de toutes ces femmes qui l'attendent, l'espèrent, font leur possible pour le garder en vie.
Vivre est une œuvre collective.
A force de s'accrocher, on veut se souvenir. Mila consigne dans sa tête les dates et les évènements à mesure que la situation allemande se délite. A mesure que l'on compte les jours pour la survie des bébés qui sont pris dans le même flot tragique que les mères. A mesure que l'hiver pénètre dans les os, que des prisonnières sont envoyées vers des camps d'extermination - car il faut faire le ménage avant l'arriver des Alliés. Puis Mila consigne sur des feuillets. Se répète autant que possible, mais tout ne reste pas dans les confins de sa mémoire. Il faut parfois combler les blancs auxquels elle ne peut répondre, des années plus tard, lorsqu'elle raconte son expérience aux lycéens. C'est alors que littérature prend le relai, exactement.
Il faut des historiens, pour rendre compte des événements ; des témoins imparfaits, qui déclinent l'expérience singulière ; des romanciers, pour inventer ce qui a disparu à jamais : l'instant présent.
Nous y voilà donc, à ce devoir de mémoire par l'imaginaire, par le pouvoir des mots d'inventer, de refaire, de tisser les bribes entre elles et de combler les blancs ; par la nécessité de prendre la langue par les deux bouts, de la triturer, de balayer tous ses possibles : longues phrases amples, gestes saccadés, enflures ici et gouffres là, de formuler sans complaisance jusqu'à toucher ces corps qui suintent, meurent, s'exposent à tout.
Kinderzimmer est saisissant, époustouflant. Valentine Goby y fait un impressionnant travail d'écrivain qui se détourne pas les yeux et empoigne la matière de son art avec une force brute, une intensité admirable pour dire très exactement l'indicible. C'est à peu près parfait à tous points de vue, et pour le peu qui ne l'est pas, vu l'ampleur de la tâche thématique et stylistique, ça l'est quand même.
Mila inspire. Je veux tenir sous la glace, persister droite et dure en aiguille de sapin. Je veux être verte, ferme. Je veux m’économiser jusqu’au retour de la lumière, ralentir le battement de mon cœur, mettre mon corps au diapason, faire d’ultimes réserves de sève fraiche et propre, je veux être prête pour la suite, s’il y a une suite.
Une rencontre marquante avec Mila, avec Sacha-James, Lisette, Teresa et les autres, avec ce camp de Ravensbrück et cette improbable pouponnière ; une rencontre marquante, enfin, avec Valentine Goby, dont il me faudra forcément lire d'autres romans !
19:26 Publié dans Coups de coeur, Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (16)
01/04/2016
Rendez-vous poétique avec François Jacqmin et Jacob Kassay

En dénichant ce recueil de Jacqmin, je m'attendais à lire "le récit de l'extase du poète face à la nature" ainsi que l'annonçait la quatrième de couverture. Une poésie des fleurs et des cailloux, en somme (mais en mieux). En fait, j'ai découvert encore mieux. C'est à dire que cette nature dans laquelle évolue le poète est l'incarnation de l'Être auquel se confronte le moi vivant, pensant et a fortiori le moi écrivant. De là, Jacqmin glisse vers une réflexion qui interroge l'écriture elle-même, remet en cause sa prétention à dire ou à donner forme à ce qui ne peut l'être. Le langage est finalement bien plus au cœur du recueil que la neige en tant que telle, qui se fait tour à tour métaphore de la pureté, de l'humilité ou de l'insaisissable. Chaque poème de Jacqmin forme une bille autonome, ronde et lisse comme une boule de neige, que d'aucuns trouveront trop ronde ou trop lisse mais qui me semble, au contraire, restituer à la perfection la pensée méditative et réflexive.
Le livre de la neige de François Jacqmin, Espace Nord, 2016 [1993], 145p.
On soupçonne
que les ténèbres n'ont pas leur source
dans la nuit.
On devine
une opacité primitive, un
crépuscule
qui précède l'obscur.
On songe à une ombre très reculée qui devance
l'informe, et
qui montre que le noir
n'est que la coutume d'une incohérence plus noire.
p. 21
Belle
sans la disgrâce de la précaution, la neige
éblouissait
de toute son expérience précaire.
Sa légèreté
était un pressentiment qui précède le toucher ; on ignorait
si sa fourrure
frôlait la démence ou l'immatériel.
En la regardant, l'âme se savait regardée.
p. 37
Que peut-on espérer
d'un infini
qui n'a aucune inclination pour le mot ?
Que faut-il attendre d'une neige
qui n'établit
aucun rapport entre son signe et la pensée ?
En quoi
peut-on convertir ce tout qui évite le tout ?
Serait-ce une révélation
que d'ignorer ce que l'on doit à l'ignorance ?
p. 41

Untitled, 2013
Vue de l'exposition de Jacob Kassay à la galerie Art Concept à Paris
Et tandis que François Jacqmin interroge les prétentions de l'écriture par l'entremise de la blancheur neigeuse, Jacob Kassay interroge les prétentions de l'art occidental par l'entremise du monochrome argenté.
Tout, en art, est éternel dialogue.
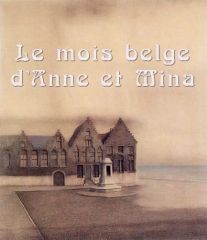 Première participation au mois belge 2016 d'Anne et Mina
Première participation au mois belge 2016 d'Anne et Mina
10:31 Publié dans Art, Challenge, Poésie, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (12)




