27/08/2016
Les échecs de l'été
Une fois n'est pas coutume, et peut-être parce que cet été aura été particulièrement riche en livres qui me sont tombés des mains, j'ai décidé de garder la trace d'un petit florilège de mes échecs.
Je sais qu'il y a eu dernièrement (et ce n'est pas la première fois) une polémique sur l'intérêt de chroniquer un livre qu'on n'a pas aimé et, a fortiori, un livre qu'on n'a même pas fini. Après tout, sur quoi se base-t-on pour émettre un jugement (forcément péremptoire) si l'on n'a parcouru que le tiers, le quart voire le dixième du livre ? Que cela plaise ou non aux auteurs, je suis persuadée (et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent beaucoup de critiques et d'éditeurs, je n'ai donc pas inventé le concept) que le style et le propos d'un livre se cernent assez rapidement entre les premiers chapitres, et quelques autres pages prises au hasard. On saura vite si on a affaire à un bon roman, un grand roman, un chef d'oeuvre intersidéral, un ovni (et je classe dans cette catégorie les livres qui me laissent toujours dubitative au début de la lecture, ceux dont je ne sais quoi penser - dans ces cas-là, je poursuis toujours), un roman médiocre, un roman commercial, un roman déjà écrit cent fois et/ou un roman surfait. Ce n'est sans doute pas infaillible, évidemment. C'est sans doute aussi pétri de subjectivité. Mais à partir du moment où cette subjectivité est bonne à dire lorsqu'elle est positive, l'inverse doit être également valable.
Partant de cette idée, je me dis qu'un partage des romans interrompus peut représenter autant d'intérêt que le partage d'un coup de cœur. En tout cas, pour ma part, je suis très curieuse d'échanger au sujet de ces échecs, afin de saisir ce que j'ai peut-être raté, de me sentir aussi moins seule dans mon ennui ou mon agacement face à certains ouvrages, et/ou, pourquoi pas, me faire changer d'avis et m'inviter à repartir du bon pied avec un livre rencontré au mauvais moment.
*
 Les singuliers d'Anne Percin, Le Rouergue, 2014, 393p. (J'ai constaté en librairie avant-hier qu'il venait de sortir en poche chez Babel.)
Les singuliers d'Anne Percin, Le Rouergue, 2014, 393p. (J'ai constaté en librairie avant-hier qu'il venait de sortir en poche chez Babel.)
Que de promesses pour ce roman épistolaire qui plonge son lecteur au cœur d'une communauté artistique de la fin du XIXème, entre le fantasme (Hugo Boch et Hazel sont, entre autres, des mirages de l'auteure pour mener à bien son processus narratif) et la réalité (où l'on croise un Gauguin truculent, jouisseur et l'image d'un Van Gogh déjà évanescent, insaisissable). Le roman se veut la peinture bouillonnante d'une fin de siècle en pleine création et mutation : la peinture ne cesse de se renouveler, la photographie et la Tour Eiffel deviennent les symboles de la technologie faite art, les femmes commencent à être acceptées en écoles d'art et, dans tout ce tourbillon, les voyages forment toujours le mieux les artistes. C'est bien souvent du côté de petits villages perdus de la Bretagne d'Hugo Boch devise sur le monde, ses amis, l'inspiration, laissant deviner au lecteur une communauté éclectique et passionnante.
Connaissant mon amour de l'art, de la peinture en particulier et de la peinture du XIXème encore plus précisément, connaissant une certaine accointance pour l'épistolaire depuis un certain chef d'oeuvre du genre que je place au panthéon des miracles de la littérature, ce livre était fait pour moi à condition d'être à la hauteur des deux domaines sus-mentionnés - ce qui ne fut pas le cas, vous le voyez venir : entre une correspondance cousue de fil blanc (quoiqu'à ce stade-là, on frise le fluo) à laquelle on ne croit pas trois lettres et des propos sur l'art d'une banalité déconcertante, j'ai réussi à m'acharner sur 200 pages très molles avant d'abdiquer face à la platitude du style et l'inexistante profondeur du propos. Certains morceaux sont doux, plein de bonnes intentions, et parfois, pas trop mal vus mais l'ensemble est malheureusement trop lisse et trop superficiel à mon goût. Ecrire un livre sur la création artistique en se contentant de collectionner les clichés ne peut me convenir. Ce n'est pas désespéramment mauvais, non, c'est simplement médiocre - et je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, en fait.
 Le grand marin de Catherine Poulain, L'Olivier, 2016, 368p.
Le grand marin de Catherine Poulain, L'Olivier, 2016, 368p.
Je ne vais pas vous faire l'affront de résumer l'histoire de ce roman, parce qu'en toute honnêteté, je ne m'y suis pas acharnée très longtemps (beaucoup moins longtemps que le livre d'avant par exemple). Du coup, je ne sais même pas véritablement de quoi ça parle, à part ce que j'en ai lu dans les revues critiques et sur les blogs. Ce qui m'a par contre franchement marquée dès les premières pages, c'est l'incompréhension totale que j'ai ressenti lorsque j'ai attaqué le bouquin, pleine d'enthousiasme à la lecture des éloges démentiels qui en avaient été fait. Sans tourner autour du pot ni faire des courbettes diplomatiques, j'ai tout bonnement trouvé le style de Catherine Poulain d'une nullité limite insultante pour le lecteur et ce qu'elle racontait pas beaucoup plus élevé. Or quand je vois tous les prix que ce roman a glanés, tous les avis positifs qu'il a suscités dans des revues ou sur des blogs que je sais exigeants dans leurs lectures, je me dis que j'ai dû louper une marche, me planter de bouquin, ou faire une indigestion de champignons hallucinogènes. Avis à tous les lecteurs du Grand marin donc : qu'avez-vous trouvé au style (qui, définitivement, m'est rédhibitoire - non, en fait, vraiment, je le trouve insultant), à l'histoire ?! Ou inversement, y-a-t-il des lecteurs déconfits qui ont fait le même constat d'échec agacé que moi ?

Le huitième livre de Vésale de Jordi Llobregat, Le cherche midi, 2016, 620p.
Rien de tel, lorsqu'on est en panne estivale de lecture, qu'un bon thriller un poil obscur, historique, érudit et, qui sait, peut-être un peu ésotérique. En repérant ce roman sur le site du Cherche Midi qui mentionnait une comparaison avec Carlos Ruiz Zafon, j'ai immédiatement pensé à Marina que j'avais fort apprécié. Communauté linguistique oblige, j'ai aussi beaucoup pensé à José Carlos Somoza dont je dévore chaque ouvrage. Bref, ce roman devait me réconcilier avec le plaisir de dévorer avidement des centaines de pages en une après-midi, ce qui m'a décidé à le demander en SP (une fois n'est pas coutume).
Et là, c'est le drame... La scène d'ouverture, découverte d'un corps non identifié, presque irréel et donc censé être hautement flippant, est à la limite du risible. Soit, une plantade arrive et la tentation du cliché, dans ce genre littéraire, n'est jamais loin. Il faut savoir accepter de passer outre certaines facilités pour se laisser embarquer (oui, je suis faible, parfois). Poursuivant, donc, je découvre que les chapitres suivants dévoilent un personnage clé successivement, et l'histoire est ainsi vue alternativement par tel ou tel regard - regard qui perpétue malheureusement le cliché sus-mentionné : qui, le tout jeune professeur d'université à qui tout sourit mais qui reçoit une lettre le ramenant sur les traces de son passé (suspeeeeeeens), qui le journaliste pouilleux, endetté jusqu'à la moelle, risée de son journal mais qui cache, en fait, un scoop en or massif qu'il ne peut pas tout de suite dévoiler (ouh ouuuuuh), qui un personnage mystérieux dont la noirceur frise en fait le satanisme de farces et attrapes (depuis que beaucoup trop d'auteurs se sont amusés avec). Bref, on en revient aux ficelles fluo que j'évoquais tout à l'heure chez Anne Percin, à la différence près que j'ai trouvé ici une prétention narrative pas du tout en accort avec le mauvais style de gare effectif de l'auteur. Cette prétention fallacieuse a achevé de me rendre le bouquin carrément détestable. Anne Percin avait le mérite d'être d'une sincérité humble dans ses mots. Ici, jordi Llobregat semble persuadé d'avoir inventé la poudre alors qu'il écrit, à tout casser, un mauvais thriller déjà écrit cent fois, pompeux, ennuyeux et téléphoné.
Je m'excuse auprès du Cherche Midi qui a eu la gentillesse de me faire parvenir ce roman pour cet avis virulent et sans aucune nuance. Ça ne m'arrive pas souvent de trouver un livre à ce point mauvais mais quand c'est le cas, je préfère ne pas tourner autour du pot.
*
Quelqu'un parmi vous a-t-il lu l'un de ces trois romans ? J'attends vos avis divers et variés - plus pondérés, mitigés, aussi virulents que moi, dubitatifs, tranchés, opposés, passionnés, à paillettes ? - pour enrichir mes propres lectures !
16:12 Publié dans Divers, Littérature anglophone, Littérature française et francophone, Littérature hispanique | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : le grand marin, les singuliers, le huitième livre de vésale, livre, livres, vésale, peinture, xixème, gauguin, van gogh, hugo boch, boch, lili, marin, jordi llobregat, catherine poulain, anne percin, l'olivier, cherche midi, rouergue, thriller, prix littéraires
08/08/2016
En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeaut

En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeaut, Finitude, 2016, 159p.
"Certains ne deviennent jamais fous... Leurs vies doivent être bien ennuyeuses." Ainsi parlait Charles Bukowski qui n'était pas loin d'avoir raison si l'on s'en tient à la vie superfétatoire du trio familial que voilà : un jeune narrateur et ses parents totalement hallucinés, pour qui la vie n'est que fêtes grandioses, cocktails et danses au son de "Mr. Bojangles" sans jamais travailler ni ouvrir le courrier. Au diable les conventions quand on peut affubler l'être aimé d'un prénom différent chaque jour ou apprendre les mathématiques dans son bain ! C'est indéniablement la mère, le point névralgique de cette folie familiale, toujours pleine d'idées saugrenues, mais le père ne se fait pas tellement prier non plus, lorsqu'il raconte comment il chassait les mouches au harpon. Et pourquoi pas acheter un château en Espagne, tant qu'on y est ? Parce qu'il n'existe rien de tel que des métaphores ou des expressions. Que nenni ! Tout cela est fait pour devenir réalité ! En attendant Bojangles est fait ainsi : d'une folie glissante, dont on sent dès le départ qu'elle emballe, puis qu'elle s'emballe et l'on ne sait plus trop si ce sont les personnages qui la crée ou si c'est elle qui les mène par le bout du museau.
En attendant Bojangles a la saveur d'un petit bonbon sucré qu'on suçote avec le sourire. La voix du narrateur, pleine de la clairvoyance ignorée de l'enfance, est joliment agréable et l'on s'amuse fréquemment de trouvailles imagées qui font mouche. On sourit, on se dit que c'est bien vu, bien senti, même émouvant. La voix du père, en contre-point n'est pas en reste, et l'on comprend très vite qu'il n'est pas si fou, finalement. Il a la folie amoureuse, une sorte de folie compatissante et moelleuse pour aimer cette femme qui ne sait pas faire autrement que de vivre dans un rêve en tourbillon. Depuis toujours il sait que le tourbillon l'emportera. Il a la folie du sursis : que chaque jour soit un jour de gagné.
Mais peut-être parce que je connaissais déjà l'histoire de A à Z à force de blogs, peut-être parce qu'on me l'a vendu comme un chef d’œuvre d'émotions et de poésie (?), je n'ai pas décollé de mon bonbon sucré, qui a fini par me coller un poil aux dents, pour y trouver la saveur inégalée d'un mets de grand chef étoilé. C'est charmant et pas mal du tout mais ce n'est pas non plus à se pâmer. L'évolution est très attendue, tout de même, et tout le récit tient essentiellement à une certaine folie des grandeurs dans ses réalisations quotidiennes. On est jamais très loin de tomber dans le cliché, même si ce n'est certes pas celui du pathos - plutôt celui du fantasme - et ça ne s'arrange pas, dès lors que la folie devient pathologique. A partir de là, les ficelles frisent carrément le ridicule pas totalement assumé. Et puis, on m'avait parlé de poésie, de musicalité du style. Alors là, je n'ai pas compris du tout. Il y a un ton original, c'est certain mais de là à parler de poésie, c'est peut-être un peu trop s'emballer.
Alors voilà, j'ai refermé En attendant Bojangles mi figue mi-raisin, partagée entre le sentiment d'une lecture de vacances sympathique et la déception d'une attente décoiffante pas du tout comblée. J'ai même réussi à trouver les 159 pages un peu longues : ça résume à peu près tout.
10:40 Publié dans Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bourdeaut, bojangles, livre de plage, folie, succès
25/07/2016
Aziyadé de Pierre Loti
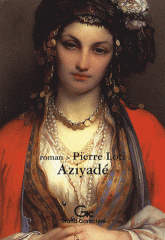
Aziyadé de Pierre Loti, 1879
Lecture numérique
 L'Orient est décidément le territoire de tous les fantasmes au XIXème siècle, mélange d'exotisme, de sensualité et de violence. Il y a quelque chose d'hypnotique dans l'Orient déformé de les auteurs de ce siècle romantique !
L'Orient est décidément le territoire de tous les fantasmes au XIXème siècle, mélange d'exotisme, de sensualité et de violence. Il y a quelque chose d'hypnotique dans l'Orient déformé de les auteurs de ce siècle romantique !
Il y a évidemment de cela dans l'Aziyadé de Pierre Loti qui raconte l'amour passionnel, fulgurant, improbable entre Loti, un officier de marine anglais et la fameuse Aziyadé, toute jeune femme murée dans son harem. Leur rencontre se fait à travers les barreaux qui scellent son appartement puis, sans se parler puisqu'une langue les sépare, ils se rencontrent nuitamment, à la faveur des absences de l'époux d'Aziyadé. Ils se suivent ainsi de Salonique à Stamboul (les noms de villes aussi ont quelque chose d'exotique, n'est-ce pas ?) et vivent à la faveur d'un petit appartement camouflé de feuillages, Loti déguisé en autochtone, et grâce au concours de Samuel, Achmet, ou Kadidja.
Mais c'est trop beau, cela ne peut durer. Loti se fait rappeler par son pays un beau jour de mai 1877. Il n'a que quelques jours avant le départ et malgré des hésitations, il ne peut se résoudre à rester en Turquie. Il laisse Aziyadé qui jure de ne pas pouvoir lui survivre. Le conte oriental prend alors des accents de tragédie shakesperienne.
Aziyadé parle peu ; elle sourit souvent, mais ne rit jamais ; son pas ne fait aucun bruit ; ses mouvements sont souple, ondoyants, tranquilles, et ne s’entendent pas ; C’est bien là cette petite personne mystérieuse, qui le plus souvent s’évanouit quand paraît le jour, et que la nuit ramène ensuite, à l’heure des djinns et des fantômes.
Le plus frappant, dès lors qu'on entame la lecture, est la forme choisie par Pierre Loti. C'est une succession de courts chapitres, qu'on peut qualifier de fragments, qui développent sous forme de journal et de lettres une histoire qui commence immédiatement, sans préambule. Loti arrive à Salonique, décide de se promener en tenue traditionnelle par défi, ennui ou désinvolture, on ne sait trop - pour se divertir tout du moins -, croise les yeux d'Aziyadé et nous voilà dans le vif du sujet. Point de longue mise en place de la situation, du décor, des personnages. Tout est déjà là, en quelques chapitres d'une quinzaine de lignes chacun. C'est progressivement, à mesure que l'histoire se nourrit et, particulièrement, dès lors qu'elle est sise à Istanbul, que l'environnement historique, politique et quotidien de la vie turque fleurit et prend de l'ampleur en écho à l'épanouissement de la relation entre Loti et Aziyadé. Les chapitres s'étoffent et l'on découvre une vie éminemment exotique et chatoyante. Je ne l'ai pourtant pas trouvé si fantasmée que ça et il semble que Pierre Loti ait été un observateur pertinent du tournant vers la constitution turque en 1876 et du début de la guerre russo-turque en 1877.
Par ailleurs, on sent l'esprit fin de siècle gagner le personnage de Loti. Il n'a plus rien de l'exaltation pleine d'espoir, parfois poussive, du personnage romantique. Il se révèle au contraire pétri de contradictions, de questionnements et, surtout, d'une sorte d'impossibilité de vivre le sentiment jusqu'au bout, trop empêtré dans une langueur sourde. Quelque chose de l'esprit déjà blasé, à moitié consumé, qui semble avoir déjà trop vécu pour son jeune âge. Loti apparaît comme le miroir inversé d'Aziyadé, d'une grande naïveté et d'une pureté de sentiments dénuée de calcul. Leur rencontre, tout comme leur relation est improbable. On ne sait comment cela tient, si ce n'est par une magie proche du conte, qui nous embarque dans les rues odorantes, bruyantes, voilées d'une Turquie lointaine, qui n'a peut-être jamais existé.
Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de morale, rien n'existe de tout ce qu'on nous a enseigné à respecter; il y a une vie qui passe, à laquelle il est logique de demander le plus de jouissance possible, en attendant l'épouvante finale qui est la mort.
En somme, ce fut un beau voyage (comme dirait Du Bellay)
Image : La fontaine du Harem, Frederick Arthur Bridgman, 1875
14:24 Publié dans Classiques, Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : aziyadé, pierre loti, loti, turquie, stamboul, istanbul, amour, tragédie, roman épistolaire, journal




