02/12/2016
Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir
 Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, Folio, 2016 [1958], 473p.
Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, Folio, 2016 [1958], 473p.
"Pour de vrai, je ne me soumettais à personne : j'étais, et je demeurerais toujours mon propre maître" p.79
Je n'ai jamais beaucoup versé dans les autobiographies. Je crois que je me représente ce genre comme trop mêlé d'impudeur et d'égo ; ce qu'il est, certes - mais seulement en partie, pour les bons ouvrages. Certains d'ailleurs, dans cette catégorie, m'ont régulièrement taquinée et je n'ai jamais trop cessé de leur tourner autour. Mais il faut toujours attendre LE bon moment pour plonger dans telle ou telle vie, le bon angle pour comprendre, le bon temps pour savourer. Et puis un jour, qui ressemble pourtant à tous les autres, sans trop savoir pourquoi, on empoigne le livre et on est prêt à voyager.
Un beau jour, donc, j'ai fini par ouvrir ces Mémoires d'une jeune fille rangée, dont tout le monde parle c'est-à-dire cite le titre, et dont la plupart des littéraires ont étudié un extrait ou deux. Il se peut même qu'une fois prof devenus, nous ayons resservi les dit-extraits à nos ados souvent ennuyés : car il y a, dans ce premier volume des mémoires de Simone, toute une époque révolue ou, plus justement, une époque ET un milieu. Elle naît à peu de choses près avec le vingtième siècle (en 1908 pour être précise), dans une famille tout ce qu'il y a de plus bourgeois parisien. Son père, particulièrement, cristallise cette caste conservatrice, conventionnelle, très comme il faut en politique comme en littérature. A propos de sa passion pour le théâtre, Simone affirme d'ailleurs : "Dans cette passion têtue se résumait sa singularité. Par ses opinions, mon père appartenait à son époque et à sa classe." (p. 49). On pourrait d'ailleurs reprocher à Simone de Beauvoir d'être elle-même un produit de sa classe : sans trop de souffrances ni de préoccupations matérielles de première nécessité, même un fois la faillite familiale survenue, Simone évolue de caprices sensationnels en réflexions métaphysiques alambiquées avant de devenir première de la classe en tous points. Certes, Simone n'a pas trop souffert - du moins matériellement, c'est indéniable. Elle n'a pas non plus essuyé d'horribles pertes - à cet égard, la Première Guerre Mondiale est très lointainement évoquée, il faut donc croire que peu de membres de la famille s'y sont abîmés - ou une éducation misérable.
"Quand j'évoquais mon avenir, ces servitudes me parurent si pesantes que je renonçai à avoir des enfants à moi : ce qui m'importait, c'était de former des esprits et des âmes : "je me ferai professeur", décidai-je" p. 76
Toutefois, à force de lire, on se rend compte que le carcan bourgeois se révèle de façon insidieuse particulièrement oppressant, notamment pour la femme qui aspire - qui aspire, déjà : quelle drôle d'idée pour une femme d'aspirer à quelque chose, pourrait répondre le parfait bourgeois de l'époque - à une vie différente, singulière et, disons-le indépendante. La notion même d'indépendance pour la femme du début du vingtième siècle est inexistante. La femme reste pure et vierge, sert de décoration élégante lors d'un déjeuner, d'un thé ou d'une soirée, doit se montrer intelligente mais surtout pas trop (poser trop de questions est l'apanage des anarchistes), croit en Dieu, se marie, pond et finit par se taire dans toute la sainteté de son destin tracé. Cette tacite obligation, dont tout dépassement est vécu comme une honte, une insulte, une bravade, est particulièrement sensible à travers l'existence manquée de Zaza, la meilleure amie de Simone, qui ne saura jamais tout-à-fait prendre son envol, avoir le cran de se révolter contre les normes oppressives de son milieu. Encore une fois, on pourra dire que Simone de Beauvoir y est parvenue parce qu'une brèche, finalement, lui était offerte. Néanmoins, elle offre là une incroyable leçon de vie : la liberté comme choix douloureux mais assumé, comme responsabilité, comme travail de chaque instant et jouissance conquise. Car, on aurait tort de l'oublier, évoquant peut-être trop la bourgeoisie de Simone de Beauvoir, qu'elle était avant tout un incroyable génie, une besogneuse de première classe qui a décroché l'agrégation de philosophie du premier coup et de quelques années plus jeune que Sartre. Toute l'exigence qu'elle exprime à l'égard du monde, de l'existence, de son entourage, elle se l'applique à elle-même : elle montre l'exemple d'une philosophie qui passe par le philosophe, qui se doit d'être vécue.
Je n'ai pu m'empêcher de me rappeler régulièrement au fil de ma lecture les mots de George Sand qui développait, dans Histoire de ma vie, l'idée que l'écriture de soi est aussi, et peut-être avant tout, un enseignement fraternel qui aurait pour vocation de stimuler le lecteur. C'est cette inspiration stimulante qui m'a semblé parcourir chaque page de ces Mémoires d'une jeune fille rangée. Choix, exigence, liberté : tels sont les trois mots que je retiendrais des premiers pas déjà hors du commun, d'une incroyable richesse d'enseignement, et à la franchise exemplaire, de Simone de Beauvoir. On le dit de bien des classiques mais celui-ci, absolument, doit être lu.
"Je veux la vie, toute la vie. Je me sens curieuse, avide de brûler plus ardemment que toute autre, fût-ce à n'importe quelle flamme" p. 406

 Challenge Femmes de Lettres chez George
Challenge Femmes de Lettres chez George
2ème participation pour une auteure du XXème siècle
17:45 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Ecriture de soi, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (16)
21/11/2016
La traduction est une histoire d'amour de Jacques Poulin
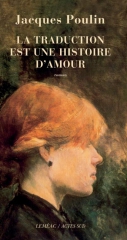
La traduction est une histoire d'amour de Jacques Poulin, Actes Sud/Léméac, 2006, 132p.
Par le hasard de la vie, Marine, la traductrice globe-trotteuse indépendante, décide de traduire l'oeuvre de monsieur Waterman. Par un nouvel hasard, elle le croise dans la dernière demeure de sa mère, un livre à la main. De fil en aiguille, il en vient même à lui proposer d'habiter un chalet sur l'île d'Orléans ; puis de week-end en week-end, ils deviennent amis, malgré leurs différences. Entre eux, il y a la littérature, la joie de jouer avec les mots, et d'écouter chanter le son juste - en somme, tel est leur apprivoisement.
"Je pris le livre qu'il me tendait. [...] Éblouie, je fermai les yeux, tête inclinée en arrière. D'un seul coup, j'étais transportée dans la vieille maison du langage, à mi-chemin entre la terre et le ciel. J'ai l'air de divaguer, mais il n'en est rien : je venais d'entrer dans un lieu, un domaine, un univers où j'étais à l'abri des malheurs de ce monde et où, monsieur Waterman et moi, malgré la différence d'âge, nous avions la possibilité de nous rejoindre." p. 77
Là dessus, survient un maigre chat noir (ainsi qu'un renard, un héron et quelques autres bestioles qui s'apprivoisent, elles aussi). Ce filou tient dans son collier un message lancé au vent, une bouteille à la mer, par une jeune fille seule et un peu paumée. Marine et monsieur Waterman entreprennent de la dénicher puis de lui tendre la main.
On en a jamais fini de tisser des liens entre les égarés du monde dans ce roman de Jacques Poulin, par lequel je découvre l'auteur. Je vous avoue pourtant que je ne vois pas grand chose à vous en dire. J'en attendais beaucoup, peut-être trop, de cette simplicité poétique dont j'avais beaucoup entendu parler et de ces subtilités entre les êtres. Malheureusement, ce court récit n'a pas su me toucher ni interpeller l'amoureuse des textes vigoureux que je suis. Pour vous dire vrai, je me suis même ennuyée assez sec. La relation entre Marine et monsieur Waterman m'a semblé une succession de scénettes alternant entre l'anecdotique et le mièvre ; leur "aventure" avec la jeune fille à sauver couronnant le tout d'une gentillette invraisemblance qui ne sert à rien. Une parabole sur ces liens doux qui se créent petit à petit entre les hommes, à l'image du petit prince et du renard, sans doute mais qui pêche par trop de lisse et de fade à mon goût.
Merci à ma chère Topi pour cette découverte de Jacques Poulin
 Québec en novembre 2016 chez Karine et Yueyin
Québec en novembre 2016 chez Karine et Yueyin
09:00 Publié dans Challenge, Littérature française et francophone, Swap | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : québec, jacques poulin, waterman, écrivain, traduction, traducteur, renard, amitié
11/11/2016
Le collier rouge de Jean-Christophe Rufin

Le collier rouge de Jean-Christophe Rufin, Gallimard, 2014, 156p.
En plein cœur de l'été, un cabot fait des siennes et hurle jour et nuit, ce qui n'est pas sans rendre fou le gardien de la caserne juste en face, Dujeux. Ce dernier ne garde qu'un seul prisonnier puisqu'en 1919, tout le monde est rentré chez soi : L'énigmatique Morlac, plutôt taiseux et taciturne, et plutôt réfractaire à accepter l'indulgence du juge Lantier venu l'interroger. Tout se joue, dans les premiers temps du récit, entre ces deux-là (Dujeux fait seulement partie du décor) et le chien qui rythme questions et réponses et semble, à distance, répondre à son maître enfermé. Nous ne savons pas grand chose, alors. Nous sommes à l'image de Lantier : nous cherchons à comprendre ce que Morlac fait là, pourquoi il se complait dans une opposition si farouche et, pourquoi, surtout, il refuse l'affection si démonstrative du chien.
A mesure que l'histoire se déroule, entre les tranchées, les morts, et la solitude, un troisième personnage crucial apparaît : Valentine (Cherchez la femme, qu'ils disaient, cherchez la femme !). Tout n'est donc pas qu'une histoire de guerre, finalement. C'est plus complexe, et pourtant très simple.
Au premier abord, j'ai trouvé Le collier rouge d'une grande finesse, d'une maîtrise évidemment totale (sans avoir jamais lu Rufin auparavant, c'est tout à fait le genre de style auquel je m'attendais) mais d'une finesse et d'une maîtrise finalement un peu froides, un peu sèches - oserais-je dire un peu plates? Je me retrouvais exactement avec le même sentiment de lecture que 14 d'Echenoz (si mon souvenir est exact). J'avançais donc, dubitative, dans l'attente de quelque chose : de ressentir, plutôt que de penser, je crois.
Puis, finalement, je me suis prise au jeu de frayer dans les pas de Lantier. Sans être du tout un policier - on est même loin du compte -, la construction est habile, et joue à nous dévoiler les informations au compte-goutte, en commençant évidemment par les plus anecdotiques pour monter progressivement en puissance, en intérêt, en curiosité. Les personnages prennent du relief et se colorent de toute l'ambivalence de l'humanité (exception faite, peut-être, de Dujeux et du gendarme local qui représentent le petit fonctionnaire dans toute la splendeur de sa bêtise fatiguée mais heureuse).
Rufin aborde la Première Guerre Mondiale sous un autre angle : la voilà finie. Les tranchées ne sont plus là, effectivement, mais fourragent encore dans les esprits avec une puissance lancinante. L'après semble aussi lourd que le pendant - pas de la même façon, pas avec autant de terreur bien sûr, mais il pèse durablement. L'après sonne aux oreilles de Morlac comme une vaste mascarade laissant entrevoir que personne n'a compris l'essence de la guerre et qu'être un héros n'a rien de reluisant. C'est d'une tristesse infinie d'être un héros. Et voilà que je me surprends à méditer encore, mine de rien, le message tout simple et si crucial de Rufin. Finalement, elles valaient sacrément le coup, cette grande finesse et cette maîtrise totale.
C'était lui, le héros. C'est ça que j'ai pensé, voyez-vous. Pas seulement parce qu'il m'avait suivi au front et qu'il avait été blessé. Non, c'était plus profond, plus radical. Il avait toutes les qualités qu'on attendait d'un soldat. Il était loyal jusqu'à la mort, courageux, sans pitié envers les ennemis. Pour lui, le monde était fait de bons et de méchants. Il y avait un mot pour dire ça : il n'avait aucune humanité. Bien sûr, c'était un chien... Mais nous qui n'étions pas des chiens, on nous demandait la même chose. Les distinctions, médailles, citations, avancements, tout cela était fait pour récompenser des actes de bêtes. p. 121
09:43 Publié dans Histoire, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : jean-christophe rufin, le collier rouge, première guerre mondiale, héros, légion d'honneur




