01/06/2016
Rendez-vous poétique avec John Keats et J.M.W. Turner
Here lies one whose name was writ in water
(Ici repose celui dont le nom était écrit dans l'eau)
A défaut d'avoir terminé le livre prévu pour débuter le mois anglais, voici un rendez-vous poétique comme il y a longtemps, et très romantique pour une fois. Entre les mailles du contemporain, merveilleux, à découvrir, il est bon parfois d'effeuiller à nouveau quelques textes classiques pour se rappeler la beauté de ces vers qui n'ont rien perdu de leur lumière. Ainsi en est-il du bien nommé Bright Star de John Keats, plein d'un lyrisme exalté et d'une solitude solaire. Bon mois anglais à tous !
Bright star, would I were stedfast as thou art --
Not in lone splendor hung aloft the night,
And watching, with eternal lids apart,
Like nature's patient, sleepless eremite,
The moving waters at their priestlike task
Of pure ablution round earth's human shores,
Or gazing on the new soft-fallen mask
Of snow upon the mountains and the moors ;
No -- yet still stedfast, still unchangeable,
Pillow'd upon my fair love's ripening breast,
To feel for ever its soft swell and fall,
Awake for ever in a sweet unrest,
Still, still to hear her tender-taken breath,
And so live ever -- or else swoon to death.
1819, dans Life, Letters and Literary Remains of John Keats (1848)
(Etoile lumineuse, puissé-je être immobile comme toi
Non pas solitaire, resplendissant au-dessus de la nuit,
Les yeux toujours ouverts,
Veillant avec patience, tel un ermite de la Nature,
Observant les eaux mouvantes à leur tâche sacrée
De purification des hommes,
Ou encore contemplant la neige fraîchement
Tombée sur les monts et bois,
Mais plutôt, toujours immobile, immuable,
Assoupi sur le sein fleuri de ma bien-aimée
Pour ressentir à jamais son doux mouvement,
Éveillé pour toujours dans une douce insomnie,
Encore et encore à l'écoute de sa tendre respiration
Et vivre ainsi toujours, - ou sinon m'évanouir dans la mort.)

Norham Castle, Sunrise, J.M.W. Turner, about 1845
 Le mois anglais 2016 chez Lou et Cryssilda
Le mois anglais 2016 chez Lou et Cryssilda
1ère participation
09:00 Publié dans Art, Challenge, Littérature anglophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (8)
25/05/2016
Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez
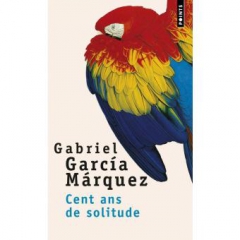
Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, Points, 1997 [1967], 461p.
Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace.
 On dit des grands romans qu'ils se repèrent dès la première phrase. Il en va ainsi Du côté de chez Swann ou de Mrs Dalloway. Il en va de même pour Cent ans de solitude dont le génie éclabousse dès l'incipit - ce génial incipit où le réalisme merveilleux de Garcia Marquez se dévoile éblouissant, drôle, savoureux, parodique et lyrique tout à la fois.
On dit des grands romans qu'ils se repèrent dès la première phrase. Il en va ainsi Du côté de chez Swann ou de Mrs Dalloway. Il en va de même pour Cent ans de solitude dont le génie éclabousse dès l'incipit - ce génial incipit où le réalisme merveilleux de Garcia Marquez se dévoile éblouissant, drôle, savoureux, parodique et lyrique tout à la fois.
Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons en glaise et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et, dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineau, qui répondait au nom de Melquiades, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés, et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melquiades. "Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un accent guttural ; il faut réveiller leur âme, toute la question est là."
Au commencement était Macondo - puisque tout est mythique dans ce roman où chaque phrase contient le monde et toute l'histoire est une prophétie de solitude infligée à la descendance du couple premier José Arcadio et Ursula Buendia pour avoir commis le péché d'inceste puis le meurtre. Descendance ô combien hallucinante et hallucinée, entre le rêve et la cruauté la plus brute, où chacun dessine les contours cent fois vécus et réinvente en même temps le présent d'un village fantasmé. Aux sentiments violents de la passion, de l'orgueil ou de la gourmandise se mêlent les guerre et les fléaux, un déluge impressionnant, la colonisation ou la dictature militaire. Entre les mailles d'une nouvelle Bible gorgée de sang et des fleurs délicieuses d'un style tout en nuances sous les atours de l'hyperbole, Garcia Marquez évoque aussi l'Histoire de son pays et construit le mythe de la Colombie à travers le mythe de l'Homme.
Se succède ainsi une série de vies entrecroisées, tantôt fulgurantes, tantôt étonnamment dilatées, qui se répètent inlassablement, suivant un déclin pré-destiné. Un tel projet enjoint deux réflexions au lecteur au fil de la lecture : la première est relative à l'intelligence de la construction, l'admiration face à l'ampleur d'un univers imaginaire ahurissant ; la deuxième avoue pourtant la difficulté d'en suivre les méandres sur la longueur tant la circularité des destins - les nombreux prénoms identiques - peuvent perdre à force de se répéter. Malgré tout, c'est l'impression d'avoir touché du doigt un chef d'oeuvre comme on en fait peu qui prévaut indéniablement. La certitude que Garcia Marquez est un prix Nobel évident. Je n'ose imaginer quel pouvait être le cerveau d'un tel homme. Etait-ce d'ailleurs encore un homme, à un tel stade du génie ?
Il n'y avait, dans le coeur d'un Buendia, nul mystère qu'elle ne pût pénétrer, dans la mesure où un siècle de cartes et d'expérience lui avait appris que l'histoire de la famille n'était qu'un engrenage d'inévitables répétitions, une roue tournante qui aurait continué à faire des tours jusqu'à l'éternité, n'eût été l'usure progressive et irrémédiable de son axe.
 Challenge des 100 livres à lire chez Bianca
Challenge des 100 livres à lire chez Bianca
24ème participation
15:51 Publié dans Challenge, Classiques, Coups de coeur, Littérature hispanique | Lien permanent | Commentaires (10)
18/05/2016
D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère
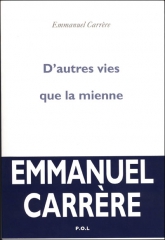
D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrière, P.O.L., 2009, 310p.
Au départ, le couple d'Emmanuel Carrère et d'Hélène bat de l'aile, malgré des vacances paradisiaques au Sri Lanka. Tous s'ennuient et s'engluent dans la frustration jusqu'à ce que le tsunami de 2004 vienne tout dévaster. Emmanuel et Hélène sortent de leur marasme sentimental pour apporter de l'aide à un autre couple, Delphine et Jérôme, qui vient de perdre leur petite fille Juliette. De fil en aiguille, on suit à travers les yeux de l'auteur ces quelques jours infernaux où le deuil s'accompagne de la nécessité de retrouver le corps, de retrouver la paix.
De retour en France et quelques mois plus tard, c'est une autre Juliette qui se prépare à mourir, la soeur d'Hélène cette fois, d'un cancer du sein. Juliette est/était juge d'instruction, mère de trois fillettes. A sa mort, avec le concours du mari de Juliette et de son collègue juge également, Emmanuel va reconstituer la vie de la jeune femme par le menu : l'avant, le pendant et l'après maladie, comme l'envie de saisir rétrospectivement tout de cette Juliette qu'il ne connaissait quasiment pas.
Et là, j'en arrive à la partie où je suis censée développer mon avis critique et je sens se dérouler une monumentale tarte à la crème. Parce qu'autant le dire tout de suite : je n'ai pas goûté mon plaisir, loin de là. Entendons-nous bien : Emmanuel Carrère sait fort bien manier les mots pour promener son lecteur jusque dans les méandres - parfois limites - de sa vie et de la vie des autres (parce qu'il n'est pas seulement question d'autres vies que la sienne dans ce livre) et ses mots savent toucher la plupart du temps. De tout cela, je suis aujourd'hui certaine comme tous les autres lecteurs de Carrère avant moi. Mais manier et toucher comment, pourquoi ? Son style est loin de m'avoir éblouie et l'émotion qu'il a fini par me susciter à l'endroit de Juliette, je l'aurais tout autant ressentie en regardant un téléfilm sur M6. Dans l'ensemble (parce que je ne vais pas y passer la journée non plus), j'ai trouvé Carrère prétentieux, peu inventif, peu subtil, d'un égocentrisme et d'une impudeur parfaitement détestables. Cette façon de se toucher la nouille sur le dos des autres (cette tournure inspire d'amusantes images, tiens, aha) est une tendance qui m'irrite particulièrement dans la littérature contemporaine. Bon, vous l'aurez compris : je ne goûte pas du tout à l'autofiction en général et si certains auteurs/titres font parfois exception, ce n'est clairement pas le cas de Carrère. Et quand je lis que c'est ici un de ses livres les moins narcissiques, je n'ai aucunement envie d'aller voir ailleurs si j'y suis, au risque de chopper de l'urticaire.
Voilà, c'est court, c'est lapidaire mais il vaut mieux couper net au lieu de tourner autour du pot. Un petit mot seulement sur le juge et les méandres juridiques du surendettement que j'ai trouvés particulièrement intéressants. Mais à ce compte-là, sur le même sujet, je lirai autre chose la prochaine fois.
14:58 Publié dans Ecriture de soi, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (14)




