10/03/2014
L'Assommoir d'Emile Zola
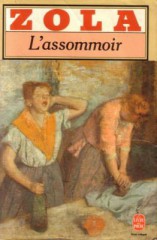
L'Assommoir d’Émile Zola, Le livre de poche, 1983 [1877], 491p. (+30p. de notes pour la présente édition)
 Gervaise a le malheur d'être née Macquart, cette branche bâtarde issue de l'ancêtre Adelaïde à qui l'on doit tous les personnages de la saga zolienne. Elle porte le vice héréditaire sur sa jambe boiteuse et l'alcool coule depuis toujours dans ses veines, tant ses parents aimaient la goutte et l'anisette. Pourtant, Gervaise est aimable comme tout, ronde et rose comme une fleur et travailleuse avec ça. Lorsque cette fripouille de Lantier la délaisse en plein Paris, avec deux enfants sur les bras, pour aller courir le jupon et une meilleure fortune, Gervaise se démène comme un diable à la blanchisserie de madame Fauconnier et assure son train-train. "On ne m'y reprendra plus" dit-elle en parlant des hommes et de leurs belles promesses. Pourtant, Coupeau se montre bien gentil, lui fait une cour comme il faut et ne boit pas. Ça, non ! Le père Coupeau s'est cassé le cou en tombant d'un ouvrage un jour de grosse culotte, on ne risque pas de le prendre à faire pareil ! Gervaise finit donc par céder et se remet en ménage. Elle se marie même cette fois-ci (et la noce de crapahuter au Louvre avec des yeux ronds). Si la vie semble tourner joliment, c'est pour mieux dégringoler. La faiblesse de Coupeau pour la boisson, qu'il a lui aussi dans les veines, finit par le rattraper. Du vin, il tombe à la gnôle que le père Colombe distille dans son alambic aux allures de monstre infernal. La faiblesse de Gervaise pour la gourmandise et la paresse la pousse à des complaisances de plus en plus délétères. Pour ne pas embêter son monde, pour ne pas être embêtée, elle tolère d'abord beaucoup puis tout et n'importe quoi. Dans ce torrent, la boutique de Gervaise, l'argent, les maigres espoirs fondent et c'est tout une boue qui finit par engluer le ménage. Plus on s'encrotte et moins on a l'envie d'en sortir. Coupeau ne travaille plus depuis longtemps et part régulièrement à Saint-Anne se retaper après une crise de delirium tremens. Gervaise salope tous ses ouvrages, finit par être mise dehors de partout. Au fond, une goutte n'a jamais fait de mal à personne alors à quoi bon s'en priver ? Quitte à boire l'argent du ménage, autant le boire à deux. De toutes façons, Gervaise n'a plus qu'une paillasse sous un escalier. Gervaise n'est déjà plus grand chose. La tragédie héréditaire l'a rattrapée.
Gervaise a le malheur d'être née Macquart, cette branche bâtarde issue de l'ancêtre Adelaïde à qui l'on doit tous les personnages de la saga zolienne. Elle porte le vice héréditaire sur sa jambe boiteuse et l'alcool coule depuis toujours dans ses veines, tant ses parents aimaient la goutte et l'anisette. Pourtant, Gervaise est aimable comme tout, ronde et rose comme une fleur et travailleuse avec ça. Lorsque cette fripouille de Lantier la délaisse en plein Paris, avec deux enfants sur les bras, pour aller courir le jupon et une meilleure fortune, Gervaise se démène comme un diable à la blanchisserie de madame Fauconnier et assure son train-train. "On ne m'y reprendra plus" dit-elle en parlant des hommes et de leurs belles promesses. Pourtant, Coupeau se montre bien gentil, lui fait une cour comme il faut et ne boit pas. Ça, non ! Le père Coupeau s'est cassé le cou en tombant d'un ouvrage un jour de grosse culotte, on ne risque pas de le prendre à faire pareil ! Gervaise finit donc par céder et se remet en ménage. Elle se marie même cette fois-ci (et la noce de crapahuter au Louvre avec des yeux ronds). Si la vie semble tourner joliment, c'est pour mieux dégringoler. La faiblesse de Coupeau pour la boisson, qu'il a lui aussi dans les veines, finit par le rattraper. Du vin, il tombe à la gnôle que le père Colombe distille dans son alambic aux allures de monstre infernal. La faiblesse de Gervaise pour la gourmandise et la paresse la pousse à des complaisances de plus en plus délétères. Pour ne pas embêter son monde, pour ne pas être embêtée, elle tolère d'abord beaucoup puis tout et n'importe quoi. Dans ce torrent, la boutique de Gervaise, l'argent, les maigres espoirs fondent et c'est tout une boue qui finit par engluer le ménage. Plus on s'encrotte et moins on a l'envie d'en sortir. Coupeau ne travaille plus depuis longtemps et part régulièrement à Saint-Anne se retaper après une crise de delirium tremens. Gervaise salope tous ses ouvrages, finit par être mise dehors de partout. Au fond, une goutte n'a jamais fait de mal à personne alors à quoi bon s'en priver ? Quitte à boire l'argent du ménage, autant le boire à deux. De toutes façons, Gervaise n'a plus qu'une paillasse sous un escalier. Gervaise n'est déjà plus grand chose. La tragédie héréditaire l'a rattrapée.
Évidemment, le naturalisme de Zola est impressionnant. Dans le quartier noir de la Goutte d'Or, si joliment choisi, c'est tout le monde ouvrier qui se met en branle. On croise tantôt une fleuriste, un forgeron, une dentelière, un sergent de ville, des concierges, des ouvriers en chambre, un serrurier, un croque-mort et tout ce petit monde s'agite dans la ruche de Paris ; une ruche crasseuse, où règne la promiscuité, mais qui se refait tranquillement une beauté en ouvrant les boulevards. Et quoi de mieux pour faire parler le peuple que d'user de sa propre langue ? Pour sûr, il fallait oser, il fallait bien s'appeler Zola, pour cravacher la littérature à coup d'oralité et de jurons bien tapés ! On comprend mieux les quelques critiques salées qui ont pu fleurir à la parution du roman en 1877. En attendant, ces petites langues précieuses rabattues, ce procédé audacieux donne à chaque page une vie explosive. Non, L'Assommoir "ne porte pas bien son nom" comme je l'entends si souvent ironiquement. L'Assommoir est vibrant, à chaque page.
Pour schématiser honteusement, le projet romanesque de Zola dans ce volume était de démontrer les ravages de l'alcool dans le milieu ouvrier, de concert avec sa théorie déterministe héréditaire. En d'autres mots, tous les personnages sont peu ou prou les deux pieds dans la goutte mais ceux qui s'y roulent carrément jusqu'à la déchéance sont ceux qui en avaient déjà quelques antécédents fâcheux. Oh oui, on lit tout cela dans L'Assommoir. Mais, on ne va pas se mentir : ce n'est pas ce pseudo-côté scientifique qui le rend génial.
 Ce qui est fabuleux chez Zola, ici comme dans tous ses autres romans, c'est qu'aussi naturaliste soit-il, il est 100 fois plus que ça. Son naturalisme dépasse les bornes d'une stricte obédience à une logique scientifique et à l'observation documentaire. Son naturalisme se fait mythe, se fait grandiloquence, et parvient comme l'a jadis fait le Romantisme avant lui, à créer toute une gamme d'émotions puissantes. Nous ne sommes pas dans la dissection mais dans la passion perpétuelle ! Zola n'a rien du naturalisme un peu froid, un peu pince sans rire de son comparse Maupassant. Bien au contraire, comme le fait si bien l'alambic, il allume les flammes, déchaîne les passions, et rend le lecteur tout essoufflé de toutes ses impressions qu'il provoque. Comment, en effet, ne pas ressentir une sympathie dévorante pour Gervaise, cette pauvre petite bonne femme si gentille qui s'enlise inexorablement ? On a bien souvent envie de la cajoler ou de lui secouer les puces. Et puis ses fripons de Lorilleux ou de Lantier, ils mériteraient bien quelques tannées bien senties. Enfin, on se surprend à aimer ou détester les personnages de Zola comme si on les connaissait.
Ce qui est fabuleux chez Zola, ici comme dans tous ses autres romans, c'est qu'aussi naturaliste soit-il, il est 100 fois plus que ça. Son naturalisme dépasse les bornes d'une stricte obédience à une logique scientifique et à l'observation documentaire. Son naturalisme se fait mythe, se fait grandiloquence, et parvient comme l'a jadis fait le Romantisme avant lui, à créer toute une gamme d'émotions puissantes. Nous ne sommes pas dans la dissection mais dans la passion perpétuelle ! Zola n'a rien du naturalisme un peu froid, un peu pince sans rire de son comparse Maupassant. Bien au contraire, comme le fait si bien l'alambic, il allume les flammes, déchaîne les passions, et rend le lecteur tout essoufflé de toutes ses impressions qu'il provoque. Comment, en effet, ne pas ressentir une sympathie dévorante pour Gervaise, cette pauvre petite bonne femme si gentille qui s'enlise inexorablement ? On a bien souvent envie de la cajoler ou de lui secouer les puces. Et puis ses fripons de Lorilleux ou de Lantier, ils mériteraient bien quelques tannées bien senties. Enfin, on se surprend à aimer ou détester les personnages de Zola comme si on les connaissait.
Le recours au naturalisme grandiloquent a bien son pendant : un bon petit manichéisme de derrière les fagots, l'air de rien, point le bout de son museau. A l'exception des personnages principaux, la plupart des autres s'apparentent surtout à des "types", chargés de broder la toile du quartier ouvrier parisien comme il faut ou simplement de relancer le récit. Il faut bien quelques travers. Celui qui peine le plus le lecteur est sans doute cet indécrottable pessimisme. Vous pouvez courir pour trouver chez Zola quelque chose qui éclaire in extremis le chemin. Non, il est tracé d'avance, c'est comme ça. C'est bien la fatalité tragique. Mais que voulez-vous, avec Zola, je suis aussi faible que Gervaise et je lui pardonne tout. Je deviens toute rose et complaisante à son endroit. D'ailleurs, je suis déjà en manque de cette petite goutte littéraire bien savoureuse et je me demande si je ne vais pas m'enfiler cul-sec un autre Rougon-Macquart pour la peine...
(Illustration 1 : La blanchisseuse de Toulouse Lautrec, 1888 ; illustration 2 : Les blanchisseuses de Degas, 1874)
Lu en lecture commune avec Charline douce dont je vais lire immédiatement le billet !
 Challenge XIXeme chez Fanny
Challenge XIXeme chez Fanny
4eme lecture
 Challenge Rougon Macquart chez Lili Galipette
Challenge Rougon Macquart chez Lili Galipette
14eme lecture
 Challenge Le mélange des genres chez Miss Léo
Challenge Le mélange des genres chez Miss Léo
1ere lecture pour le XIXeme siècle dans la catégorie "Classique français"
08:18 Publié dans Challenge, Classiques, Lecture commune, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (18)
03/03/2014
La messagère de l'au-delà de Mary Hooper

La messagère de l'au-delà de Mary Hooper, Les Grandes Personnes, 2012, 239p.
J'avais repéré Mary Hooper chez Bianca il y a quelques mois. Depuis, elle était restée patiemment dans un coin de ma mémoire, jusqu'à ce que je découvre le titre d'aujourd'hui et Waterloo Necropolis dans une librairie d'occasion début février. Ni une ni deux, je n'ai pas hésité une seconde à sauter le pas de la découverte !
La messagère de l'au-delà s'inspire d'une histoire vraie qui défie les lois de l'imagination !
Dans l'Angleterre de 1650, une loi particulièrement odieuse permet d'accuser d'infanticide toute femme victime d'une fausse-couche, accouchant d'un enfant mort-né ou dont ce dernier décèderait de la mort subite du nourrisson. La malheureuse est alors présumée coupable tant que son innocence n'est pas prouvée. Évidemment, peu de nobles ont souffert de cette loi qui touchait surtout les femmes de basse condition.
C'est donc d'infanticide que se trouve accusée la toute jeune Anne Green, quatorze ans. Servante dans la maison du seigneur Thomas Reade, elle se laisse avoir par les promesses fallacieuses du jeune maître Geoffrey et s'en trouve enceinte ; l'enfant pourtant n'arrivera pas à terme et elle accouchera d'un petit être à peine formé et sans vie à six mois de grossesse. Anne Green pense enterrer l'enfant dans un coin du domaine et cacher tout cela au reste du personnel. Malheureusement, elle est découverte et Thomas Reade apprécie bien peu que la réputation de son petit-fils soit salie par Anne. Dès lors, elle est emprisonnée puis jugée coupable d'infanticide malgré le témoignage d'une sage-femme. Sa peine est la pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive, puis son corps sera légué à la science pour être disséqué. Ce qui devait être le point final d'une existence bien douloureuse est pourtant le théâtre d'un évènement hors du commun : Anne Green, sur la table de dissection, cligne des paupières et donne des signes de vie ! Incroyable mais vrai : la jeune Anne Green a survécu à sa pendaison !
L'auteur raconte dans une mini-note finale ce qu'on sait de cette affaire aujourd'hui et les hypothèses qui permettent d'expliquer ce "miracle" ; probablement une sorte de cryogénisation du cerveau due au grand froid le jour de l'exécution qui aurait évité à celui-ci d'être privé d'oxygène.
Supposition scientifique mise à part, Mary Hooper souhaite imaginer toute cette histoire du point de vue de la principale intéressée. C'est donc dans la pénombre de son coma que nous la retrouvons au début du roman. Elle ne comprend pas, alors, ce qui lui arrive, elle espère voir bientôt le paradis et craint l'enfer et surtout, elle se rappelle tout ce qui l'a conduite dans cette situation. Parallèlement, un autre récit s'écrit entre les souvenirs d'Anne Green : celui des médecins qui, pensant pratiquer une dissection, constatent peu à peu les signes de vie et tentent de la sauver.
Au-delà des qualités éminemment romanesques de l'affaire dont s'inspire Mary Hooper, elle nous propose également une plongée fascinante dans l'Angleterre inique, précaire, sombre d'Oliver Cromwell. Une période historique que je ne connaissais absolument pas et qui m'a vivement intéressée. L'auteure fait preuve d'un passionnant souci du détail pour un texte de littérature ado et donne vraiment envie d'en connaître plus sur les faits et la période explorés. En outre, elle ne ménage pas son lecteur et certaines scènes sont décrites de manière tout à fait réaliste, notamment celle de l'accouchement d'Anne Green dans les latrines de la laiterie. Si celle-ci ne choquera certainement pas un lecteur adulte, elle fera probablement forte impression sur un 12-13 ans.
Cela dit et malgré mon âge autrement plus avancé que la cible visée, j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai dévoré goulument et j'ai tout simplement hâte de découvrir le titre suivant présent dans ma PAL. Bien sûr, il faut avoir conscience qu'on lit de la littérature pour ados lorsqu'on attaque ce livre. Cela évitera d'en espérer plus que ce qu'il ne peut offrir. Pour ma part, il est évident que j'apprécierais à présent en lire une version "pour adulte" qui, tant qu'à faire, ne s'arrêterait pas au réveil d'Anne Green mais ferait aussi la part belle à son existence postérieure de "messagère de l'au-delà". Quelqu'un aurait-il l'inspiration de s'y coller ? Avis aux écrivains de talent !

 Challenge Le mélange des genres chez Miss Léo
Challenge Le mélange des genres chez Miss Léo
1ere participation pour la catégorie "Roman jeunesse"
08:24 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Littérature ado, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (16)
27/02/2014
L'hiver dans le sang de James Welch

L'hiver dans le sang de James Welch, Albin Michel, coll. Terres d'Amérique, 2008 [1974], 213p.
On ne va pas se mentir : oui, encore du roman amérindien, et même le 3eme de James Welch depuis l'automne. D'aucuns pourraient penser que ça frise la monomanie cette année et ils n'auraient pas tort. Entre cette littérature en particulier et les classiques français, voilà deux orientations plus ou moins imposées par mon travail, auxquelles je goûte néanmoins avec plaisir la plupart du temps, mais qui, j'en conviens, peuvent devenir un peu omniprésentes sur ce blog et le faire souffrir d'un manque de diversité. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous y glanerez quand même quelques belles idées de lectures !
L'hiver dans le sang, donc, est le premier roman de James Welch que je m'amuse à lire dans le désordre. Publié en 1974 aux USA, il est premièrement paru en France en 1992, deux ans plus tard en poche, pour finir par ne plus l'être du tout comme beaucoup de littérature amérindienne (et sa version 10/18 n'est donc trouvable que d'occasion). Bien heureusement, Albin Michel en a lancé une seconde édition courante en 2008, assortie d'une préface de Louise Erdrich - très connue en France donc... On fait ce qu'on peut pour appâter le chaland sur une lecture qui vaut le coup mais qui, pour une raison que j'ignore, passionne peu.
Avec ce roman, James Welch s'inscrit dans la droite ligne de N. Scott Momaday et sa Maison de l'Aube parue en 1968 (qu'il faut définitivement que je me procure et lise grmbl) ; ligne dans laquelle s'inscrira également Leslie Marmon Silko avec sa géniale Cérémonie en 1977 : la fameuse "renaissance amérindienne", où une voie nouvelle, celle de la littérature, est prise par ceux qui ont longtemps été forcés au silence. Ils y disent à la fois toute l'aliénation personnelle et culturelle dont ils souffrent et leur volonté de renaître, de réconcilier leurs racines ancestrales et la possibilité d'aller vers une évolution constructive.
Le héros de L'hiver dans le sang, qui en est aussi le narrateur, nous reste inconnu. Nous ne connaitrons jamais son nom. Nous savons seulement qu'il est un jeune Blackfeet d'une trentaine d'années entre les années 60 et 70 et qu'il habite une réserve du Montana. Il vit avec sa mère, son beau-père Lame Bull et sa grand-mère antédiluvienne, jadis épouse du dernier grand chef Blackfeet, aujourd'hui mutique. D'après ce que l'on comprend, il est cowboy : sa vie est rythmée, lorsqu'il ne boit pas, par les veaux et le travail des champs. Le roman brosse quelques jours de ce quotidien fait d'errances alcooliques, de rencontres improbables, de travail aux champs et avec les bêtes et de souvenirs hypnotiques de son frère aîné et de son père décédés.
En chapitres très courts, Welch alterne les épisodes sans forcément de transitions. A l'image de Leslie Marmon Silko dans Cérémonie mais avec beaucoup moins de complexité dans la construction et une plus grande simplicité stylistique, ce parti pris narratif métaphorise la fragmentation de l'être qui ne se reconnait plus dans un passé qu'il n'a pas connu et qui ne lui a pas été transmis, un présent sans racine et un avenir flou voire impossible. La perte des deux figures majeures du narrateur, le père et le grand frère exprime d'ailleurs cette perte de repères essentiels. L'un mort violemment à cheval, l'autre gelé au fond d'un ravin ne sont pas sans rappeler une Histoire qui reste ainsi gravée même si sa souvenance n'apparaît pas consciemment. Comme ce passé qui ne peut plus se dire ni s'entendre, les deux anciens du roman souffrent de lacunes sensorielles : la grand-mère est muette et le vieux Yellow Calf est aveugle. Beaucoup les pensaient d'ailleurs déjà morts mais c'est seulement dans la solitude et l'indifférence qu'ils vieillissent. Ils n'appartiennent déjà plus à ce monde.
L'aliénation se traduit également dans l'absence totale d'émotions. Aucun affect n'est jamais accordé aux personnages - et qui plus, au personnage narrateur. Ils sont dans une distance perpétuelle à l'autre et à eux-mêmes et aucun sentiment ne semble les relier. Le narrateur l'exprime parfaitement dès la fin du premier chapitre :
"Rentrer chez ma mère et une vieille qui était ma grand-mère. Et la fille qu'on prenait pour ma femme. Mais elle ne comptait pas vraiment. D'ailleurs, aucune d'elles ne comptait ; elles n'étaient plus rien pour moi. Sans raison spéciale. Je n'éprouvais ni haine, ni amour, ni remords, ni mauvaise conscience, rien qu'une distance qui s'accroissait au fil des ans."
Louise Erdrich dit dans son introduction qu'elle comprend ce que veut dire le titre sans nous en dévoiler la signification mais c'est peut-être bien ça, "l'hiver dans le sang" : à la fois, un passé voilé, non pas absent mais recouvert et gelé comme un sol d'hiver, sur lequel ne peut rien pousser, ni présent, ni émotion. Une image pleine de nature et d'une idée de la lignée, deux éléments si chers jadis aux amérindiens, pour en signifier précisément aujourd'hui l'impossibilité.
Quoique. L'impossibilité comme avant, certes. Mais il y a toujours une possibilité d'évolution. Après tout, le narrateur s'occupe de ses bêtes et de ses terres. C'est d'ailleurs dans leurs évocations que naissent les morceaux les plus poétiques du roman. A la fin, il va même au péril de sa vie pour sauver une vache prise dans un marécage. Et le livre se clôt sur l'envie de regarder en avant plus qu'en arrière. Une lueur alors point.
Je pourrais en dire encore beaucoup sur ce premier roman qui m'a touchée et dans lequel j'ai retrouvé énormément de thèmes de la littérature amérindienne. Welch a notamment un talent particulier pour brosser en peu de mots des portraits de personnages éphémères atypiques et pleins de sens. Mais je vais plutôt conclure en vous disant qu'il me semble être un livre parfait - pas trop long en plus - pour comprendre cette littérature. Il est simple, très abordable tout en étant riche et poétique.
 Challenge Amérindiens
Challenge Amérindiens
14eme lecture
 Challenge américain chez Noctenbule
Challenge américain chez Noctenbule
11eme lecture
08:37 Publié dans Challenge, Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (14)




