06/06/2020
Neverwhere de Neil Gaiman
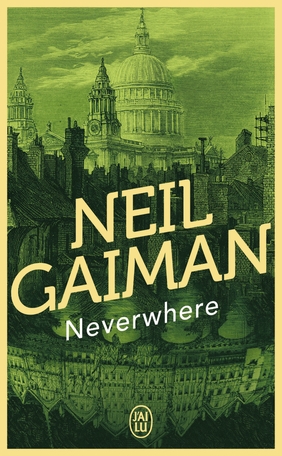 Richard Mayhew est l'archétype de Monsieur-Tout le monde. Il n'a pas de physique particulier, pas de passions, pas d'ambition, il bosse dans un bureau normal et habite un petit appartement londonien normal. Il se laisse gentiment porter par la vie. C'est ce qui l'a amené trois ans plus tôt à quitter son Écosse natale pour Londres puis ce qui l'a amené, quelques temps plus tard, à se fiancer à Jessica, une jeune femme aux dents longues et aux projets d'avenir très arrêtés. Un soir qu'ils s'apprêtent à dîner avec le patron de cette dernière, soirée qui avait au demeurant mal commencé à cause de l'étourderie et du manque de fiabilité légendaires de Richard, le couple tombe nez à nez avec une jeune fille blessée sortie de nulle part (littéralement). Jessica est partante pour laisser la fille agoniser sur le trottoir parce que la vie est une question de priorité et qu'ils risqueraient d'être en retard au restaurant ; Richard est plutôt d'avis d'agir en être humain normal plutôt qu'en grosse raclure de bidet et décide de porter secours à l'inconnue.
Richard Mayhew est l'archétype de Monsieur-Tout le monde. Il n'a pas de physique particulier, pas de passions, pas d'ambition, il bosse dans un bureau normal et habite un petit appartement londonien normal. Il se laisse gentiment porter par la vie. C'est ce qui l'a amené trois ans plus tôt à quitter son Écosse natale pour Londres puis ce qui l'a amené, quelques temps plus tard, à se fiancer à Jessica, une jeune femme aux dents longues et aux projets d'avenir très arrêtés. Un soir qu'ils s'apprêtent à dîner avec le patron de cette dernière, soirée qui avait au demeurant mal commencé à cause de l'étourderie et du manque de fiabilité légendaires de Richard, le couple tombe nez à nez avec une jeune fille blessée sortie de nulle part (littéralement). Jessica est partante pour laisser la fille agoniser sur le trottoir parce que la vie est une question de priorité et qu'ils risqueraient d'être en retard au restaurant ; Richard est plutôt d'avis d'agir en être humain normal plutôt qu'en grosse raclure de bidet et décide de porter secours à l'inconnue.
A partir de là, tout part en steack dans sa vie : sa fiancée le quitte, la jeune fille refuse d'appeler les secours et préfère demander de l'aide à un rat et au Marquis de Carabas, un duo de meurtriers du type Laurel et Hardy du crime lui rend visite, le menace et lui coupe le téléphone et, cerise sur le gâteau déjà bien chargé en sucre, plus personne ne le reconnaît. Certains, même, ne le voient plus. C'est qu'il existe, voyez-vous, deux Londres. Le Londres d'En Haut, celui que nous connaissons tous, et le Londres d'En Bas, cité sombre et méandreuse où frayent des êtres étranges, souvent dangereux et invisibles à nos yeux profanes. Quiconque côtoie l'une n'appartient plus à l'autre et puisque Richard a aidé celle qui se prénomme Porte, puisqu'il a dialogué avec nombre de créatures de la ville d'En Bas alors il n'existe plus aux yeux du peuple d'En Haut. Il n'a pas d'autre choix que de partir à l'aventure avec Porte et le Marquis de Carabas. La première cherche à faire la lumière sur la mort tragique de sa famille, le second honore une dette envers le père de Porte et Richard, quant à lui, espère simplement retrouver sa vie.
Avec ce roman, le tout premier de Neil Gaiman seul au stylo, on est sur du très bon roman d'aventure fantastique. La trame est somme toute assez classique pour le genre - un héros lambda dans une vie ennuyeuse se retrouve plongé dans un univers abracadabrant et vit mille péripéties haletantes qui lui permettront d'advenir à lui-même - et est très bien menée. Il n'y a rien à redire là-dessus : ça ne révolutionne rien mais c'est impeccablement huilé et ça se lit tout seul. L'univers fantastique imaginé par Neil Gaiman est quant à lui absolument savoureux. J'ai craint au départ en choisissant ce roman pour la journée consacrée à Londres lors de cette nouvelle édition du mois anglais que mon choix serait un peu capilotracté puisqu'on migre dès les premiers chapitres en dehors de la capitale anglaise. C'était sans compter le fait que la ville d'En bas se révèle rapidement un miroir déformé et fantasmagorique de la ville d'En Haut. Les noms des célèbres stations de métro ou de quartiers londoniens ne sont plus que des noms : ils prennent sens. Imaginez donc un peu de qui se trouve à Blackfriars ou à Shepperds Bush... En outre, le fog de jadis n'a pas disparu mais est descendu pour mieux terrifier les promeneurs et les tableaux du British Museum ouvrent des passagers secrets. Vous l'aurez compris, on est toujours bel et bien dans Londres, mais dans un Londres qui ne connaît plus aucune limite à l'imagination. Il s'agit d'y plonger corps et âme avec des yeux d'enfants et le courage d'un guerrier (parce que vous avez quand même des tueurs aux trousses et des énigmes à résoudre. Il ne faudrait pas croire que c'est une promenade de santé !). Après quoi, exactement comme Richard, vous ne serez plus tout à fait les mêmes.
Bon voyage !
"Il existe à Londres de petites bulles de temps passé, où les choses et les lieux ne changent pas, comme des bulles prises dans l'ambre, expliqua-t-elle. Il y a beaucoup de temps dans Londres, et il faut bien qu'il aille quelque part - tout n'est pas consommé tout de suite.
- Je dois encore avoir la gueule de bois, soupira Richard. J'ai trouvé ça presque cohérent."
PS : Il existe plusieurs versions de Neverwhere. La version originale anglaise de 1996 traduite en français en 1998 ; la version originale américaine qui remanie le texte anglais à la demande de l'éditeur, ce que Neil Gaiman a accepté, et enfin la version qui mélange les deux premières éditions anglophones et modifient en prime d'autres trucs. Elle paraît en 2005 outre-Manche et est traduite en 2010 en France par Le Diable Vauvert. C'est cette dernière édition que je vous ai chroniquée aujourd'hui.
Romans et comics précédemment chroniqués de Neil Gaiman : American Gods, De bons présages, Anansi boys, Stardust, L'étrange vie de Nobody Owens, Marvel 1602

Le mois anglais chez Lou et Titine
Journée consacrée à la ville de Londres
07:38 Publié dans Aventure, Challenge, Fantastique/Horreur, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : neverwhere, neil gaiman, le mois anglais, londres, fantastique, fantasy, aventur, voyage, voyage initiatique, ange, marquis de carabas, monstre
10/06/2019
Le Serpent de l'Essex de Sarah Perry
- Je me suis libérée de l'obligation d'être belle. Et je n'ai jamais été plus heureuse.
Janvier : Cora Seaborne vient tout juste de perdre son mari - et puisque le récit prend place dans l'Angleterre victorienne de la fin du XIXème siècle, un tel événement équivaut autant à un cataclysme qu'à une liberté retrouvée pour la jeune veuve. Mariée tôt, comme toutes les femmes ou presque à cette époque, elle n'a connu rien d'autre que la domination masculine, passant du père au mari comme il seyait alors. Michael Seaborne est l'homme qui [l']a faite, lui offrant l'éducation et la culture, entre autres cette passion pour la paléontologie. En contrepartie, Michael était un homme froid, cinglant et violent : son corps s'en souvient. Autant dire qu'elle ne saurait souffrir de la mort d'un tel mari. Aussitôt enterré, ou presque, Cora part avec Martha, son amie socialiste convaincue et son fils Francis, très clairement Asperger même si un tel terme n'est évidemment jamais mentionné au vu de son anachronisme à l'époque des faits, dans l'Essex rural. Les deux femmes y font de longues marches vivifiantes et Francis amasse toutes sortes d'objets insolites qui créent un monde cohérent dans son esprit atypique jusqu'au jour où Cora entend parler du serpent. Ce monstre marin légendaire reprend du service après plusieurs siècles de silence sur les lèvres de tous les habitants des environs d'Aldwinter. Cora est piquée de curiosité. Elle se demande si elle ne pourrait pas être la nouvelle Mary Anning car elle est persuadée que le serpent est de ces animaux préhistoriques encore inconnus. Elle embarque sa troupe au village d'Aldwinter où elle fait la connaissance de la famille Ransome et se lie particulièrement avec le pasteur, William.
La question, ce n'est pas ce que je vois, mais ce que je sens : je ne vois pas l'éther ; pourtant, je le sens qui entre et qui part, et je dépends de lui. Je sens que quelque chose arrive : tôt ou tard, souvenez-vous-en. Ce quelque chose s'est déjà vu, comme vous le savez, et il reviendra, sinon de mon vivant, du vôtre ou de celui de vos enfants, donc je me prépare, mon révérend, et si je pouvais me permettre un instant cette audace, je vous recommanderais d'en faire autant.
Autour de ce noyau dur de personnages dont les relations se développent dès la fin de février grâce à l'entremise des Ambrose se tissent mille et un autres personnages et mille et une autres relations, plus ou moins discrètes, plus ou moins furtives qui composent toute une variation délicieuse sur le thème de l'amitié.
L'amitié, n'est-ce pas, est un sentiment finalement peu exploité en littérature, tout du moins en temps que thème principal - car il y a bien toujours des amis dans la plupart des romans, d'amour par exemple, mais ils ne sont alors qu'un contrepoint. Dans ce roman de Sarah Perry, l'amitié s'affirme, à juste titre me semble-t-il, comme le pilier fondamental des relations humaines et à l'occasion elle flirte avec bien d'autres sentiments - l'amour, la passion, le désir, l'égoïsme, l'idéalisme, l'ambition, la possession, la filiation, la folie - se colore, se mélange, devient mystère, angoisse ou épanouissement mais toujours finit par être la véritable boussole des existences. Ce parti pris, auquel je souscris complètement, et l'incroyable subtilité des variations harmoniques amicales de l'auteure font de ce roman un texte passionnant, fin et juste. Malgré l'empreinte puissante de l'époque victorienne dont elle est aussi, évidemment, une excellente cartographie politique et sociale, et c'en est un plaisir, ce texte résonne de façon puissamment intemporelle.
J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de mystères, rien que des choses que nous ne connaissons pas encore, mais récemment, j'ai pensé que même la connaissance ne pouvait pas retirer toute son étrangeté au monde.
Puisque les êtres, bien plus que les faits, sont au cœur du roman, mieux vaut apprécier une certaine lenteur narrative pour être tout à fait plongé dans les mois qui défilent et ne pas s'attendre à des rebondissements saisissants. La mécanique des cœurs se met en branle doucement, parfois fortuitement, et de façon plausible - comprendre par là qu'il n'y a pas de surenchère illusoire pour faire rêver dans les chaumières. C'est doux et pertinent à défaut d'être fou et fantasmé. Le Serpent de l'Essex est de ces romans que l'on apprécie lorsqu'on on a fait le deuil d'une quelconque attente en tournant les pages : on est dans la vraie vie dès le départ, qui n'attend pas d'événements particuliers pour débuter, qui ne connaît pas cette perpétuelle répétition du même qu'on voit venir à des kilomètres joliment appelé cliché (c'était ma crainte concernant la relation de Cora et Will et, merveille, l'auteure a brillamment tout évité) et qui, conséquemment, n'est pas suspendu à une hypothétique closure finale non plus. Décidément, il faut se détacher de la linéarité en lisant ce roman. Ni début, ni rebondissements, ni fantasmes, ni fin ; seulement la vie et donc l'amitié. Très simplement.
En plus, j'ai eu la chance de lire ce roman en lecture commune avec une de mes plus chères amies : je ne pouvais pas rêver meilleure cerise sur ce délicieux gâteau. Merci pour nos échanges, ma petite Mélie d'amour ♥

07:30 Publié dans Challenge, Coups de coeur, Lecture commune, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (28) | Tags : le serpent de l'essex, sarah perry, christian bourgois, angleterre, londres, victoria, aldwinter, cora seaborne, paléontologie, recherche, monstre, meurtre, disparition, mort, amour, amitié, mystère, société, égalité, socialisme, autisme
04/02/2018
Au bonheur des dames d'Emile Zola

- Sans doute. Est-ce que Paris n'est pas aux femmes, et les femmes ne sont-elles pas à nous ?
Mouret II, le retour. Dans Pot-Bouille, nous avions quitté le bellâtre fraîchement marié avec Mme Hédouin et, devenu par là, propriétaire du Bonheur des dames. Le magasin n'est alors qu'une boutique de soieries parmi d'autres - avec un peu plus de potentiel et dirigé par une femme éclairée et ouverte au progrès du commerce. Elle permet ainsi à son jeune mari de mettre en branle de grands travaux d'agrandissements... Et le dixième roman des Rougon-Macquart se termine sur ces entrefaites, à peu de choses près.
- Nos maisons croulent déjà, voisin, dit Baudu d'un air sombre. Nous y resterons tous.
Nous retrouvons ici notre personnage peu de temps après le décès de Mme Hédouin. Celle-ci, tombée dans un trou des travaux - l'ironie du sort est quand même délicieuse : le progrès ne fait décidément pas d'omelette sans casser des oeufs - laisse Mouret veuf et pimpant dans son magasin en pleine expansion. Déjà, il grignote le quartier et le magasin des Vabre qui était une enseigne respectable de Pot-bouille n'est plus qu'un souvenir (il faut dire que Berthe Josserand épouse Vabre, n'aura pas fait grand chose pour économiser le ménage).
On eût dit que le colosse, après ses agrandissements successifs, pris de honte et de répugnance pour le quartier noir, où il était né modestement, et qu'il avait plus tard égorgé, venait de lui tourner le dos, laissant la boue des rues étroites sur ses derrières, présentant sa face de parvenu à la voie tapageuse et ensoleillée du nouveau Paris. Maintenant, tel que le montrait la gravure des réclames, il s'était engraissé, pareil à l'ogre des contes, dont les épaules menacent de faire craquer les nuages.
A l'image de l'alambic dans L'Assommoir, Le Bonheur des dames est de ces figures mythologiques monstrueuses créées avec brio par Zola pour signifier la marche impérieuse et inexorable d'une société qui ne fait pas dans la dentelle des individus. Le bonheur des dames, en un mot, c'est la déferlante capitaliste dont Octave Mouret est le génial chef d'orchestre. Toujours aussi hâbleur, séducteur et fin précurseur, il ne néglige aucune opportunité d'arriver à ses fins : user des femmes pour rencontrer la bonne personne dans quelque salon, traiter les employés comme du bétail, se donner le beau rôle tandis qu'il délègue les tâches ingrates. C'est bel et bien le héros de Pot-Bouille mais avec plus d'assurance et un charme encore plus magnétique capable de séduire toutes les femmes de toutes les classes sociales. Sa réussite commerciale, s'il la doit à des idées novatrices, est aussi un juste prolongement de son caractère.
C'était la femme que les magasins se disputaient par la concurrence, la femme qu'ils prenaient en continuel piège de leurs occasions, après l'avoir étourdie devant leurs étalages. ils avaient éveillé dans sa chair de nouveaux désirs, ils étaient une tentation immense, où elle succombait fatalement, cédant d'abord à des achats de bonne ménagère, puis gagnées par la coquetterie, puis dévorée.
[...]Toutes lui appartenaient, étaient sa chose, et il n'était à aucune. Quand il aurait tiré d'elles sa fortune et son plaisir, il les jetterait en tas à la borne, pour ceux pourraient encore y trouver leur vie. C'était un dédain raisonné de Méridional et de spéculateur.
En parallèle de cette chronique économique et sociale de l'essor des grands magasins au XIXème, d'une finesse si extraordinaire qu'elle en est terrifiante à mesure que meurent les petits commerces alentours, Zola développe par le truchement de Denise Baudu, petite provinciale orpheline sans le sou d'une vingtaine d'années, une histoire d'amour qui fait chavirer bien des lecteurs depuis des générations. Durant cinq ans, elle va faire des va-et-vient au Bonheur des dames. Entrée comme simple vendeuse grâce à Mouret qui voit en elle un pied de nez fait à l'oncle de Denise, son concurrent, elle est moquée, régulièrement rabaissée et finit renvoyée. Le hasard et le germe d'un amour naissant au cœur de Mouret, incompréhensible aussi bien pour lui que pour moi (je dois bien l'avouer), la rappelleront au grand magasin jusqu'à l'apothéose finale : cette déclaration contre laquelle les deux protagonistes auront longuement lutté. Je dois dire que je ne fais pas partie des aficionados de cet aspect-là du roman. Il me semble que la progression de cette histoire va tantôt trop vite, tantôt trop lentement. En outre, sous couvert d'une vertu passablement horripilante à la longue et d'une douceur avisée, Denise n'est finalement pas différente de toutes celles qui se pâment devant le charisme et le pouvoir de Mouret (sans céder, certes, mais elle se pâme quand même) au lieu d'être rebutée par son tempérament despotique et égocentrique. Quant à Mouret, en dehors d'un égo fouetté par les refus répétés de Denise qui illustrent parfaitement le fameux adage "fuis-moi, je te suis ; suis-moi, je te fuis", je ne vois décidément pas ce qu'il lui trouve.
Il eut un geste fou. C'était la première qui ne cédait pas. Il n'avait eu qu'à se baisser pour prendre les autres, toutes attendaient son caprice en servantes soumises ; et celle-ci disait non, sans même donner un prétexte raisonnable. Son désir, contenu depuis longtemps, fouetté par la résistance, s'exaspérait.
[puis plus loin]
- Je la veux, je l'aurai !...
Ce petit bémol mis à part qui persiste décidément lors de cette deuxième lecture, j'ai goûté par contre avec encore plus de plaisir les descriptions foudroyantes des étals de tissus, des expositions d'ombrelles, de soies ou de blanc. En somme, s'est rouverte devant moi toute une exposition de tableaux impressionnistes encore plus émoustillante que dans mon souvenir. Zola a décidément un talent pictural saisissant et embarque son lecteur par tous les sens ; nous offre de tout voir, de tout entendre, de tout goûter avec délice et subtilité. Il y a, en cela, quelque chose du poète chez lui - un poète chroniqueur de la modernité, tantôt emballé et subjugué, tantôt pondéré et critique quant à cette marche du progrès sur l'humain.
C’était l’exposition des ombrelles. Toutes ouvertes, arrondies comme des boucliers, elles couvraient le hall, de la baie vitrée du plafond à la cimaise de chêne verni. Autour des arcades des étages supérieurs, elles dessinaient des festons ; le long des colonnes, elles descendaient en guirlandes ; sur les balustrades des galeries, jusque sur les rampes des escaliers, elles filaient en lignes serrées ; et, partout, rangées symétriquement, bariolant les murs de rouge, de vert et de jaune, elles semblaient de grandes lanternes vénitiennes, allumées pour quelque fête colossale. Dans les angles, il y avait des motifs compliqués, des étoiles faites d’ombrelles à trente-neuf sous, dont les teintes claires, bleu pâle, blanc crème, rose tendre, brûlaient avec une douceur de veilleuse ; tandis que, au-dessus, d’immenses parasols japonais, où des grues couleur d’or volaient dans un ciel de pourpre, flambaient avec des reflets d’incendie.
♥
Ce qui arrêtait ces dames, c’était le spectacle prodigieux de la grande exposition de blanc. Autour d’elles, d’abord, il y avait le vestibule, un hall aux glaces claires, pavé de mosaïques, où les étalages à bas prix retenaient la foule vorace. Ensuite, les galeries s’enfonçaient, dans une blancheur éclatante, une échappée boréale, toute une contrée de neige, déroulant l’infini des steppes tendues d’hermine, l’entassement des glaciers allumés sous le soleil. On retrouvait le blanc des vitrines du dehors, mais avivé, colossal, brûlant d’un bout à l’autre de l’énorme vaisseau, avec la flambée blanche d’un incendie en plein feu. Rien que du blanc, tous les articles blancs de chaque rayon, une débauche de blanc, un astre blanc dont le rayonnement fixe aveuglait d’abord, sans qu’on pût distinguer les détails, au milieu de cette blancheur unique. […] Autour des colonnettes de fer, s’élevaient des bouillonnés de mousseline blanche, noués de place en place par des foulards blancs. Les escaliers étaient garnis de draperies blanches, des draperies de piqué et de basin alternées, qui filaient le long des rampes, entouraient les halls, jusqu’au second étage ; et cette montée du blanc prenait des ailes, se pressait et se perdait, comme une envolée de cygnes. Puis, le blanc retombait des voûtes, une tombée de duvet, une nappe neigeuse en larges flocons […].
Au bonheur des dames n'est pas un des Rougon-Macquart les plus connus et les plus lus pour rien. C'est un morceau de choix, assurément.
Précédemment chroniqués sur le blog :
Pot-bouille, Une page d'amour, L'Assommoir, Le ventre de Paris et La terre.
16:42 Publié dans Classiques, Histoire, Littérature française et francophone, Réflexion | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : au bonheur des dames, pot-bouille, émile zola, grand magasin, commerce, modernité, essor, capitalisme, ogre, monstre, progrès, argent, économie, société, histoire, portrait, amour, désir, femme, denise baudu, octave mouret, descriptions, impressionnisme, exposition, poète, poésie, romancier, rougon-marcquart




