31/05/2012
Le poisson-scorpion de Nicolas Bouvier

Le poisson-scorpion de Nicolas Bouvier, ed. Gallimard, 1982/Folio, 2006, 173p.
Il était plutôt du genre bougeon, Nicolas Bouvier. Le genre à ne pas rester en place, à considérer que l'on voyage pour "que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. "
Pourtant, tout comme je l'ai fait avec Sylvain Tesson, autre écrivain voyageur invétéré, ce n'est pas par le récit d'un de ces voyages physiques que j'ai abordé le sieur Bouvier - ç'aurait été trop évident, n'est-ce pas ? J'ai plutôt choisi de l'attaquer (avec quelques autres acolytes lecteurs) à travers les mots d'un périple différent, étrange et pénétrant pour qui a l'habitude de se réveiller perpétuellement à un endroit et se coucher à un autre : le voyage immobile.
Au milieu des années 50, Nicolas Bouvier vient de gambader durant deux ans dans toute l'Asie. Il en a soupé, il en a chié, il a les semelles qui collent aux cailloux mais il s'en est mis plein la tête et les yeux. Le poisson scorpion s'ouvre sur le jour de son départ de l'Inde, qu'il quitte pour le Sri Lanka, autrefois appelé Ceylan. Très peu par envie et fortement par nécessité médicale, il y restera plusieurs mois et en profitera, malgré la chaleur démoniaque, pour mener à bien divers travaux d'écriture dont ce journal qu'il publiera plusieurs décennies plus tard.
De son départ enlevé et plein d'une clairvoyance de connaisseur, le récit glisse progressivement vers une version tropicale du spleen baudelairien, assorti de quelques hallucinations maladives. Souffrant de ces affections locales que sont le paludisme et l'amibiase, Bouvier nous livre ses observations maniaques de la pléthore d'insectes qui peuplent sa chambre et ses rencontres avec un prêtre fantôme. Lui qui a toujours bougé, il semble vivre cette immobilité dans un douleureux état de prisonnier possédé.
Qu'à cela ne tienne, il décortique, il passe au scalpel de l'humour et du regard aiguisé ces facétieuses aventures hallucinatoires (qui ne devaient, néanmoins, par être une partie de plaisir). Il les presse jsqu'à la moëlle et tant qu'à faire, vit cette traversée du désert à fond les ballons. C'est précisément avec cet instinct de promeneur qu'il parviendra à dépasser cette étape (qui le conduira ensuite au Japon) et dans le tourbillon, il saisit la substantifique moëlle de l'existence - un voyage que le mouvement, peut-être, ne permet pas de comprendre aussi bien que l'immobilité et la solitude :
"Derrière ce dénuement terrifiant, au-delà de ce point zéro de l'existence et du bout de la route il doit encore y avoir quelque chose. Quelque chose de pas ordinaire, un vrai Koh-i-Nor, c'est certain pour être à ce point gardé et défendu. Peut-être cette allégresse originelle que nous avons connue, perdue, retrouvée par instants, mais toujours cherchée à tâtons dans le colin-maillard de nos vies."
J'ajouterai qu'outre un récit enrichissant et décoiffant pour le lecteur, cet ouvrage est également un pur bijou littéraire où le style, nom de Dieu, est tout simplement extraordinaire ! Une parfait syncrétisme ciselé de drôlerie, de perspicacité, d'érudition et de sagesse profane. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises de relire plusieurs fois un même paragraphe tant la langue était délicieuse (et un tel blocage d'admiration m'arrive rarement).
A l'instar de l'auteur lui-même qui disait que "
09:00 Publié dans Littérature française et francophone, Nature Writing/Récit de voyage | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : poisson scorpion, voyage, récit, ceylan, sri lanka, sylvain tesson, nicolas bouvier
24/04/2012
Les femmes du braconnier de Claude Pujade-Renaud

Les femmes du braconnier de Claude Pujade-Renaud, ed. Actes Sud, 2010 / Babel, 2012
Cet obscur braconnier, ce charmeur de bêtes magnétique et puissant, c'est le poète anglais Ted Hughes. Lors d'une lecture sur le campus de Cambridge en 1956, il rencontre Sylvia Plath, alors jeune étudiante américaine en Littérature et appelée à devenir une des plus grandes poétesses de son temps. Entre eux, c'est la passion immédiate, le mariage quelques mois plus tard, puis la création, la vie conjugale, deux enfants et des échanges fascinants, intenses, sur le fil. Après une lourde dépression en 1953, Sylvia Plath restera toujours habitée par une profonde déchirure malgré ses apparents débordements d'énergie ; Ted Hughes, quant à lui, ne saura jamais vraiment se résoudre à la monogamie. Au bout de six ans, c'est la sensuelle Assia qui sera à l'origine de leur rupture, premier maillon d'une longue série d'évènements tragiques.
Il faut dire que quand j'aime tout particulièrement un artiste, en l'occurrence ici Sylvia Plath, et qu'en plus j'ai eu l'occasion de l'étudier pour les besoins de l'Université, il m'est toujours très délicat d'attaquer un ouvrage le concernant, surtout si ce dernier se présente comme une fiction. Je suis immédiatement à l'affût de quelques inexactitudes ou de clichés trop flagrants et surtout de l'essence même de l'artiste esquissé. En gros, je pars avec un a priori suspicieux et c'est à l'auteur de faire ses preuves, de me convaincre. Et Dieu sait qu'il m'ait arrivé d'avoir des déconvenues assez magistrales.
Je me suis donc lancée dans Les femmes du braconnier avec le sourcil froncé et une petite moue interrogative.
Mais très rapidement, ma moue s'est transformée en sourire de plaisir : Claude Pujade-Renaud m'a littéralement emmenée dans l'univers captivant de son roman polyphonique ! Elle y mêle avec brio la voix des poètes et celles des personnes alentours ; un style précieux, délicat et la rudesse d'une intimité exaltée.
Les mauvaises langues pourraient dire que le procédé est un peu éculé, un peu artificiel. Il est vieux comme le monde pour brosser le portrait de personnalités à multiples facettes, à la complexité notoire. Qu'à cela ne tienne, l'auteure n'en maitrise pas moins les codes pour offrir un croquis parfaitement exact (à mon humble avis) de Ted Hughes et Sylvia Plath et de leur relation tumultueuse. J'y ai retrouvé la poétesse telle que je la voyais moi-même en lisant ses oeuvres grandement autobiographiques : à la fois fragile, obsédée par le fardeau du père disparu, parfaitement maniaque, acharnée au travail, dévoreuse d'amour et perfectionniste au possible. J'y ai également retrouvé la lourde emprunte de la psychanalyse qui n'a cessé de jalonner sa vie, pour le pire plus que pour le meilleur. Et puis cette vision de Ted, grand, charismatique, bestial, prédateur, et paternel. Honnêtement, plus je lisais, je me disais que Claude Pujade-Renaud avait tout compris !
A noter, en outre, que l'ouvrage fait de Ted Hughes le personnage principal, ce qui explique la poursuite du roman sur plus d'une centaine de pages après le décès de Sylvia Plath. Et finalement, le destin d'Assia ne diffèrera pas tant de celui de Sylvia, la reconnaissance littéraire en moins. Toutes deux subjuguées, âppées puis écrasées par la présence de celui qui donne tout à la poésie.
Un jeu de passion et de mort, tout en retenu et en délicatesse chez une auteure dont je poursuivrai la découverte après un coup de coeur si délicieux!
Merci à ma Clara fraise des bois pour cet ouvrage glissé dans mon swap printanier !
*
"Vous savez, je l’ai compris depuis peu : écrire ne sert à rien. Je veux dire, ne protège pas contre le désespoir ou la dépression. Je l’ai cru, lorsque j’avais dix-huit ou vingt ans. Plus maintenant. Non, écrire ne guérit de rien… On recoud la plaie au fil des mots. On enfouit le mal sous l’écorce du langage. La plaie se referme, ligneuse. En dessous, ça s’enkyste. Ou ça suppure."
09:03 Publié dans Coups de coeur, Littérature française et francophone, Swap | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : sylvia plath, ted hughes, assia wevill, suicide, mort, poésie, amour, passion, animaux
30/03/2012
L'inquiétude d'être au monde de Camille de Toledo
Une fois n'est pas coutume, chers lecteurs, c'est la plume d'un ami que je vais vous donner à lire aujourd'hui sur mon blog. Après tout, les lectures sont faites pour être partagées avec le plus grand nombre et j'ai trouvé cette note si intéressante qu'elle pourra peut-être vous inspirer une envie de lecture, qui sait !
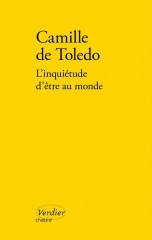
L'inquiétude d'être au monde de Camille de Toledo, ed. Verdier, 2012, 64p.
C’est suite à ma lecture de la critique dans le Magazine littéraire de Janvier dernier que je me suis décidé à plonger dans L’inquiétude d’être au monde de Camille de Toledo. Sobrement sous-titré « chant », l’auteur en une cinquantaine de pages cinglantes, sanglantes, expulse avec le souffle de l’agonisant sa vision d’un état de l’Occident en ce début de siècle neuf ; Occident frigorifié par la peur et dont les enfants rejouent les horreurs passées à petite échelle (les tueries symptomatiques de Columbine et plus récentes d’Utøya forment un refrain couplé au rappel de la Grande Guerre).
Les pures stylistes regretteront peut-être des effets de répétition à voir comme des lourdeurs de style mais l’essentiel n’est pas là mais bien dans le refus actuel de ne pas faire face, de se cacher derrière les parapets aux fils barbelés de l’Europe dite civilisée qui pourtant est livrée autant qu’elle se livre à une barbarie acceptée, si bien nommé « pop-fascism ». Plus qu’un déchant, c’est une secousse, un appel à résister « contre les promettants : ceux qui font commerce de la consolation, ceux qui vendent les solutions provisoires de la dépossession ». Salutaire pour la période qui s’ouvre, hygiénique en tout temps.
Nicolas Py
*
Extrait :
" Voyez, au vingt-et-unième siècle !
Quelqu’un frappe à la porte du petit jardin.
Là, juste en bas de chez nous.
Il frappe et sonne au petit portillon de bois.
Si c’est pas une misère,
nous l’avions justement repeint !
Contre le vent, la pluie,
nous le repeignons chaque année.
Nous croyons pouvoir ainsi garder
le contrôle du destin.
La peinture, c’est tout ce qu’il nous reste.
La peinture et le portillon, frontières
de l’homme ancien.
Et voyez, c’est un dimanche rassurant du mois de mai.
Des milliers de pères repeignent
le petit portillon de bois qui les sépare,
croient-ils, de la barbarie."p. 38-39
09:00 Publié dans Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (2)






