01/04/2015
Ouverture poétique du mois belge !
 Aujourd'hui 1er avril s'ouvre tout un mois consacré à la littérature belge à l'invitation de deux blogueuses amies Anne et Mina. A cette occasion, je publierai quelques billets divers (dont je n'ai pas encore décidé le nombre : tout dépendra de ma motivation). En attendant, j'ai choisi d'ouvrir le bal avec un texte poétique (et je le fermerai sans doute de même) qui n'est pas sans annoncer l'un de mes billets à venir pour le 7 avril. Un grand classique de la poésie belge, c'est certain ! Je ne fais pas ici dans l'originalité. Mais les classiques ont ceci d'agréable qu'on ne s'en lasse jamais et qu'à chaque lecture on est plongé dans mille souvenirs en même temps qu'on découvre quelque chose de nouveau.
Aujourd'hui 1er avril s'ouvre tout un mois consacré à la littérature belge à l'invitation de deux blogueuses amies Anne et Mina. A cette occasion, je publierai quelques billets divers (dont je n'ai pas encore décidé le nombre : tout dépendra de ma motivation). En attendant, j'ai choisi d'ouvrir le bal avec un texte poétique (et je le fermerai sans doute de même) qui n'est pas sans annoncer l'un de mes billets à venir pour le 7 avril. Un grand classique de la poésie belge, c'est certain ! Je ne fais pas ici dans l'originalité. Mais les classiques ont ceci d'agréable qu'on ne s'en lasse jamais et qu'à chaque lecture on est plongé dans mille souvenirs en même temps qu'on découvre quelque chose de nouveau.
Je vous souhaite à tous un bon début de mois belge !
 BRUGES
BRUGES
Les bras des longs canaux que le couchant fait d'or
Serrent près du beffroi, comme autour d'un refuge,
Toute la gloire ancienne et dolente de Bruges,
La ville est fière, et douce, et grande par la mort.
Mais néanmoins, toujours, monte vers la lumière
Le rectiligne élan de sa beauté guerrière,
Et son bourdon réveille un trop vivant écho
Pour éternellement pleurer sur son tombeau.
Émile Verhaeren (Toute la Flandre, t. I., «La guirlande des dunes», Paris, 1907.)
Tableau : Mon coeur pleure d'autrefois de Fernand Khnopff (1889)
07:19 Publié dans Art, Classiques, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (8)
18/03/2015
Bâtons à message - Tshissinuashitakana de Joséphine Bacon

Bâtons à message - Tshissinuashitakana de Joséphine Bacon, Mémoire d'encrier, 2009, 140p.
 Le premier espace de la parole tracée, pour les Innus, fut la nature elle-même. Ainsi, l'épinette blanche se faisait balise pour informer les êtres de leur progression dans les territoires gigantesques et gelés. Ces marques révélaient une alliance primordiale entre l'être et le lieu et entre les êtres eux-mêmes.
Le premier espace de la parole tracée, pour les Innus, fut la nature elle-même. Ainsi, l'épinette blanche se faisait balise pour informer les êtres de leur progression dans les territoires gigantesques et gelés. Ces marques révélaient une alliance primordiale entre l'être et le lieu et entre les êtres eux-mêmes.
Dans son premier recueil poétique, Joséphine Bacon fait de la poésie les nouveaux bâtons à messages : Le poème devient repère nécessaire dans une jungle qui en manque cruellement. Elle retourne aux racines, fouille les légendes, les sons du tambour, les accents de voix ; de même que les peines et les désespoirs. C'est le terreau duquel naissent ses poèmes, comme l'épinette, qu'elle entend nous transmettre avec une simplicité et une grâce désarmante.
Je n'ai, très sincèrement, pas apprécié tous ces textes avec la même force et la même émotion. Certains me sont apparus trop naïfs - même pour une poésie qui se veut simple et claire comme l'eau vive. Il faut néanmoins souligner que le recueil est bilingue et que les poèmes ont été composés premièrement tantôt en français, tantôt en langue innue. Peut-être, donc, faut-il imputer cette apparence naïveté à une traduction difficile de certains textes ? Toujours est-il que d'autres m'ont par contre incroyablement touchée. J'ai trouvé chez Joséphine Bacon une force brute qui dynamise et syncrétise en quelques vers brefs ; j'ai savouré une douceur, une confiance et une lumière intérieure qui valent mieux que de longs discours.
Je retrouve chez Joséphine Bacon ce que j'avais tant apprécié dans la prose de Virginia Pésémapéo Bordeleau et chez d'autres auteur(e)s amérindien(ne)s : le caractère presque performatif de la parole. Écrire, c'est avant tout ne pas oublier et aller de l'avant simultanément. En somme, c'est avant tout guérir.
Tschishikushkueu,
Femme de l'espace,
ce matin, j'ai revêtu
ma plus belle parure
pour te plaire
tu guideras
mes raquettes ornées
de l'unaman de mes ancêtres.
Mes pas feutrés
touchent avec respect
cette neige bleue
colorée par le ciel
l'étoile de midi
me conduit à Papakassik
où m'attend la graisse
qui élève le chant de mon héritage
quand je pile les os.
*
Ma douleur,
devenue remord,
est le long châtiment
qui courbe mon dos.
Mon dos ressemble
à une montagne sacrée,
courbée d'avoir aimé
tant de fois.
*
Ma peine m'est venue
d'une parole,
un soir d'orage,
alors que le tonnerre
réclamait
une tendresse silencieuse,
son sourd
que seule la pluie écouta.
*
Je me suis fait belle
pour qu'on remarque
la moelle de mes os,
survivante d'un récit
qu'on ne raconte pas.
*
13:59 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (6)
06/03/2015
Les Vagues de Virginia Woolf
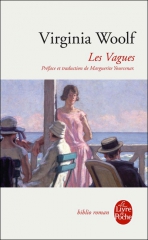
Les Vagues de Virginia Woolf, traduction de Marguerite Yourcenar, Le Livre de Poche, 2004 [1931], 286p.
 A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
A chaque roman, Virginia Woolf déshabille un peu plus le genre. De La traversée des apparences à Entre les actes, elle découd un peu plus la narration, gomme un peu plus les personnages. Elle manie avec un art consommé les aiguilles à détricoter. Mais à force de tout enlever, de distendre et de jeter le flou, que reste-t-il ? se demande honnêtement le lecteur un brin circonspect. La réponse est là : il reste Les Vagues.
Tandis que Mrs Dalloway dilatait le temps au point de faire d'un seul jour l'histoire de tout un roman, Les Vagues resserre les mouvements de l'horloge humaine - et la course du soleil - jusqu'à raconter l'histoire universelle de six consciences éclatées, bercées par le quotidien et pris dans la houle de l'univers entier. Ils sont Bernard, Louis, Neville, Suzanne, Rhoda et Jinny. Nous ne saurons jamais rien d'eux que ce qu'ils veulent bien penser et ressentir à différents âges de la vie. Entre chaque, les vagues éclaboussent le rivage ; le soleil monte et descend au gré d'une jeunesse qui s'épanouit et d'une vieillesse qui se creuse tout doucement.
Souvent, j'aime des romans. Parfois, j'ai même un coup de cœur pour l'un d'eux. Toujours, j'ai conscience d'avoir affaire au produit, bien que talentueux, d'un être aussi humain que moi. Pourtant, tout cela s'efface lorsque je lis Virginia Woolf et, plus particulièrement, lorsque je lis ses romans de la maturité. Je me rappelais avoir été subjuguée il y a quelques sept ans par Les Vagues mais, pour une raison inconnue, Mrs Dalloway restait pour moi son titre phare, son titre le plus abouti en terme l'alchimie entre un projet littéraire périlleux et la nécessité d'embarquer le lecteur. Je crois à présent pouvoir dire que Les Vagues lui est encore bien supérieur à tous points de vue. Pour cela, il m'aura fallu attendre un paquet d'années, il m'aura fallu lire et relire d'autres Woolf, et il m'aura fallu dénicher le moment propice pour revenir à ce titre-ci.
Rien ne se perd, un éclat se crée et tout se transforme. Tel pourrait être l'adage des Vagues. A l'image de chaque jour, la fin n'existe que pour être un nouveau départ : la mort est une transition ; une partie du mouvement perpétuel. Tout ce qui émerge dans l'éclat d'un rayon, le battement d'un cil ou l'éclair d'une conscience est source de création. L'être y apporte sa touche particulière et forme le grand ballet de la vie au sein duquel chaque parcelle d'herbe et de joie a l'importance particulière de révéler l'instant présent.
Je vois très distinctement chaque brin d'herbe. Mais mon pouls retentit contre mes tempes, contre les yeux, avec le bruit d'un tambour. C'est pourquoi tout danse, le filet, l'herbe. Vos visages voltigent comme des papillons ; les arbres ont l'air de bondir. Il n'y a rien d'assuré, rien de définitif dans cet univers. Tout est mouvement, tout est danse ; tout est triomphe et rapidité. p. 53
La vie vient ; la vie s'en va. Nous créons la vie. p. 174
Et Bernard d'ajouter à la toute fin du roman, comme l'ultime saut de ce qui ne connait jamais de point final :
Oui, c'est bien l'éternel renouveau, l'incessante montée qui suit une retombée sans fin.
Et en moi aussi, la marée monte. La vague se gonfle, elle se recourbe. Une fois de plus, je sens renaître en moi un nouveau désir ; sous moi quelque chose de redresse comme le cheval fier que son cavalier éperonne et retient tour à tour. p. 286

La vague de Pierre-Auguste Renoir, 1879
Ce mouvement éternel et perpétuel, c'est aussi celui de l'écriture romanesque. Car nous évoquions le dépouillement progressif de la narration woolfienne ; à tel point qu'on pourrait même se demander pourquoi elle n'en vient pas tout naturellement à la poésie. Pourquoi continuer de recourir à ce qu'on effiloche ? Mais regardons de plus près ces Vagues étonnantes : C'est vrai, nous n'avons plus d'histoire, nous n'avons plus de décor, nous n'avons même plus de personnages. Les consciences narratives ne sont plus que silhouettes incertaines. Woolf a éliminé tout ce qui fait du roman une vaste fumisterie. La construction minutieuse d'une supercherie consentie entre l'auteur et le lecteur. Woolf lève le voile. Vois-tu, semble-t-elle nous dire, il n'y a rien de tout cela. Tout cela est faux et ne sert à rien ; ne dis rien de l'essentiel. Woolf ne garde que le temps précieux du roman : sa capacité à tenir une note sur laquelle tresser les mots merveilleux. Et puis, sur cette note, elle va ajouter quelques autres perles piquées ici ou là - car dépouiller ne veut pas forcément dire laisser nu ensuite : cette succession de monologues intérieurs comme autant de monologues théâtraux et ces réflexions tantôt aériennes tantôt pesantes comme autant de poèmes en prose. Les romans de Woolf ont ce quelque chose de magique qui fait de chaque page le lieu d'une potion où se rencontrent tous les genres.
Partout où il est question de la vie et du temps dans Les Vagues, il est question de l'écriture. Deux consciences ont des velléités littéraires : Neville, le poète byronien qui savoure l'ordre et se languit de l'amour et Bernard, le raconteur d'histoires. Bernard qui compile dans un carnet chaque phrase qui lui vient un beau matin pour s'en resservir plus tard. Bernard qui est le seul des six consciences à devenir narrateur à l'occasion. Bernard, enfin, à qui reviendra la lourde tâche de boucler la boucle du jour/de la vie/du roman, de "faire l'addition" et d'en rouvrir une nouvelle. Mais Bernard qui n'écrit jamais rien en définitive, ne finit jamais aucune histoire :
J'ai inventé des milliers d'histoires ; j'ai rempli d'innombrables carnets de phrases dont je me servirai lorsque j'aurai rencontré l'histoire qu'il faudrait écrire, celle où s'inséreraient toutes les phrases. Mais je n'ai pas encore trouvé cette histoire. Et je commence à me demander si ça existe, l'histoire de quelqu'un. p. 185
Mais les histoires n'existent pas, pas plus que Perceval n'existe. Perceval qui attire et subjugue, qui fait le lien entre tous par une aura que nous ne parvenons pas à saisir, mais qui ne pense pas, ne parle pas. Qui apparait aussi fantomatique qu'un rêve. Perceval, le bien-nommé, est ce héros des romans de jadis, pleins d'héroïsme, d'aventures et de consistance factice. On se raconte des péripéties fabuleuses qui aident à s'endormir et à continuer à vivre. Ainsi Perceval est-il le meneur d'une amitié branlante entre six esprits aux quatre vents. Et puis Perceval meurt brutalement : c'est la mort du grand roman médiéval. A la suite de Bernard, nous sommes invités à remettre en cause l'épopée mystérieuse des histoires romanesques.
Perceval est mort. (Il est mort en Égypte, il est mort en Grèce : toutes les morts ne sont qu'une seule mort.) p. 169

Nymphéas de Claude Monet, 1914-1926
Les Vagues est un roman impossible. Le pari totalement fou de dire ce qui ne peut être dit ou plutôt le pari de le dire d'une manière totalement inédite et si épurée que tout autre écrivain en aurait fait une peau de chagrin à mi-chemin entre l'insipide et l'informe. Mais Virginia Woolf a réussi à en faire LE roman, tenu étroitement et en équilibre, centré très précisément autour de peu de consciences et qui, pourtant, touche à une universalité géniale et absolue. Dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman me semble presque ridicule. Le coup de cœur concerne les bons romans qui m'ont tenue en haleine ou m'ont séduite. Les Vagues m'a fait entrevoir quelque chose de l'ordre du transcendant et du divin. C'est ce qu'on appelle un coup de grâce !
18:06 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Littérature anglophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (14)




