06/05/2019
Les femmes de Heart Spring Mountain de Robin MacArthur
"Combien d'années on peut tenir sans joie, avant que tout ce bordel se casse la figure ?" demandait Bonnie des années plus tôt [...].
Lorsqu'Irene s'abat sur le Vermont le 28 août 2011, Bonnie se fait un shoot d'héroïne et part déambuler dans les rues de sa ville ravagée par l'ouragan. Elle est en plein trip, s'avance vers les eaux en crue de la Silver Creek et disparaît. Sa fille Vale, à plusieurs kilomètres de là depuis huit ans pour mettre à distance cette relation douloureuse à la mère, prend immédiatement le chemin de Heart Spring Mountain, le fief familial, cette montagne où naît la Silver Creek et où ses ancêtres se sont installés depuis des générations. S'y retrouvent à présent trois existences de femmes pleines de failles et d'étincelles : Hazel, la grande tante antédiluvienne qui commence doucement à perdre la tête et à mélanger les époques ; Deb, la tante par alliance qui a autant aimé ce coin de montagne que Stephen, le fils d'Hazel ; et Vale, en plein tourment. A travers elles, et à travers chaque parcelle de cette nature puissante, résonne aussi la voix de Lena, la grand-mère de Vale, la tante de Stephen et la sœur d'Hazel, morte en couches peu après la naissance de Bonnie. En recherchant sa mère, Vale part en même temps à la recherche d'elle-même, de ses racines longtemps mises à l'écart et qui sont pourtant, souvent, le remède pour aller de l'avant.
C'est le leitmotiv de la souffrance qui les réunit. Et pourtant, Vale : Deb voit des lueurs d'espoir dans sa présence. Vale qui éclaircit les mystères du passé, qui détricote une histoire révisionniste où l'amour existait là aussi.
Franchement, je n'avais formulé aucune attente à propos de ce roman malgré -ou peut-être à cause - de son matraquage sur les réseaux sociaux. C'aurait même eu tendance à me refroidir - mais voilà qu'il m'a appelée un beau jour tandis que je passais dans une librairie et je n'ai pas tergiversé. Ça m'arrive extrêmement rarement de céder ainsi à l'appel d'un grand format et encore plus rarement de l'entamer immédiatement dans la foulée, ça méritait donc d'être souligné. Et j'ai furieusement bien fait.
Objectivement, ces existences de femmes n'ont rien de follement extraordinaires : elles se débattent, chacune, avec un passé tortueux, des doutes présents et un avenir incertain, des sentiments souvent mêlés et ce feu intérieur qui réchauffe autant qu'il brûle. Autour d'elles gravitent nombres d'hommes aux mêmes mille facettes compliquées mais toujours bienveillants. Robin MacArthur crée ici des personnages banals c'est-à-dire vibrants, des monsieur-et madame-tout-le-monde qui ont cette force et cette épaisseur furieuse de vivre quoiqu'il en coûte. Et c'est là que le pari de ce premier roman réussit : on est complètement embarqué dans ces voix et ces époques qui se croisent pour remettre en ordre le puzzle familial parce qu'elles sonnent vraies et sont très attachantes - à défaut d'être extrêmement fouillées ou étonnamment originales.
Il y a d'autres empreintes, qu'elle n'identifie pas. De martre ? De renard ? Celles d'animaux qui s'éveillent avec le jour et viennent s'abreuver. Dans ce proche avenir apocalyptique, se dit-elle, je serai comme eux : regard aux aguets, oreilles dressées, tournant la tête en tous sens. Réfugiée près de ces marécages fertiles ; réapprenant toutes ces choses oubliées.
Le récit se lit d'un souffle, aimantés que nous sommes à ces personnages amis et ce n'est pas sans regret que je les ai quittés, un peu plus apaisés sans doute ou du moins sur le chemin de l'être. C'est ce qui me console d'avoir tourné la dernière page, sans vraiment leur avoir dit au revoir car ils m'accompagnent encore un peu en rédigeant cette chronique. Je pourrais aussi souligner, pour être tout à fait franche, qu'il m'a semblé sentir dans le style de Robin MacArthur la jeunesse de son entreprise romanesque. Certains tics d'écriture sont presque palpables tant ils se retrouvent souvent (les phrases nominales, les subordonnées relatives, l'usage des deux points...). Mais enfin, il faut que jeunesse se fasse et je crois que, de plus en plus, j'apprécie lire que la verve romanesque, cette capacité à donner vie à des êtres et des existences de mots et de papier, est décidément aussi vivace. Tant qu'il y aura de la fiction, il y aura de l'espoir.
"Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir", récite la jeune femme, les larmes aux yeux. Puis elle s'adresse à eux : "Et vous, mes salauds, quelle sera votre mission ?"
Par ici, les billets de Marie-Claude et d'Electra que j'ai découverts après avoir commencé la lecture du roman et qui sont en parfaite résonance avec mon sentiment.
07:39 Publié dans Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : les femmes de heart spring mountain, robin macarthur, albin michel, roman américain, usa, états-unis, voix, destins, passé, famille, racines, amour, filiation, réconciliation, vermont, ouragan, mère, fille, premier roman
15/03/2019
Les voyageurs de l'impériale de Louis Aragon
 Avec Aragon et son cycle du Monde Réel, les romans se suivent et ne se ressemblent pas. Non : ils se bonifient comme le bon vin. Pour moi, tout a commencé l'an dernier avec les très politiques Cloches de Bâle qui m'ont fait patiner copieusement sur une bonne centaine de pages avant de prendre leur élan grâce à Catherine Simonidzé et une direction un peu plus claire. C'était compliqué mais tellement riche qu'évidemment, j'ai enchaîné avec Les beaux quartiers en septembre, plus limpide, où le politique flirte avec le roman d'apprentissage parisien - Nathalie rappelle à ce sujet la parenté balzacienne de ce roman et elle a bien raison - et où la langue follement libre d'Aragon m'a enchantée.
Avec Aragon et son cycle du Monde Réel, les romans se suivent et ne se ressemblent pas. Non : ils se bonifient comme le bon vin. Pour moi, tout a commencé l'an dernier avec les très politiques Cloches de Bâle qui m'ont fait patiner copieusement sur une bonne centaine de pages avant de prendre leur élan grâce à Catherine Simonidzé et une direction un peu plus claire. C'était compliqué mais tellement riche qu'évidemment, j'ai enchaîné avec Les beaux quartiers en septembre, plus limpide, où le politique flirte avec le roman d'apprentissage parisien - Nathalie rappelle à ce sujet la parenté balzacienne de ce roman et elle a bien raison - et où la langue follement libre d'Aragon m'a enchantée.
"Et puis, pourquoi se casser la tête ? Qu'attend-on de la vie sinon un peu de musique ? N'est-ce pas, Meyer ?"
Alors à quelle sauce est-on mangé dans Les voyageurs de l'impériale ? De 1889 à 1918, Aragon livre la trentaine d'années (ou presque) d'un seul homme, Pierre Mercadier, soleil d'un système qui flanche - cette fin de siècle où tout bascule, à commencer par les certitudes de notre antihéros. Pierre est issu d'une famille bourgeoise tout à fait aisée. Élevé dans la nécessité de la sécurité, et un peu par goût de participer à l'éducation de sa patrie aussi, il se fait professeur d'Histoire au lycée. Mariée à une nobliaute désargentée mais très imbue de cette condition d'un autre temps - là encore, le pouvoir de l'éducation, il s'ennuie : Paulette est superficielle, frivole et pétrie d'idées arrêtées. Il ne faut pas très longtemps à Pierre pour s'en désintéresser cordialement, puis pour haïr la prison que ce mariage représente. Cette décrépitude du couple, entamée sous le regard monstrueux de la Tour Eiffel qui sonne le glas d'un siècle grandiose, devient une complète Béréniza à l'été 1897 lors d'un séjour familial à Sainteville chez l'oncle de Paulette. Pierre y vit une brève liaison qui réveille le démon de midi tandis que son fils Pascal s'ouvre à la nature et à l'amour. L'un s'enflamme, non d'amour mais d'aigreur, et étouffe tandis que l'autre, le rejeton, découvre tout l'univers des sens. Ils font, l'un et l'autre, l'apprentissage d'une liberté très différente, de plus en plus rageuse et cynique chez notre protagoniste.
Il y a ruine si on regarde derrière soi. Toujours, quoi qu'on fasse. Il y a ruine dans le substance des choses, dans ce qu'on n'a pas osé détruire. Il y a ruine dans le décor de carton-pâte derrière lequel rien ne se cache, rien. Et auquel il aurait fallu foutre le feu. Ah, que ça flambe !
Il eut tout d'un coup conscience de lui-même dans l'avenir, menant une vie médiocre, une vie dérisoire. Mais seul. Si admirablement seul.
*
- Ça fait Baudelaire ce que vous me racontez là : Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent... Je ne suis pas voyageur, je suis un type qui ne veut pas faire semblant de penser blanc quand il a la tête au noir... C'est tout. Partir pour partir, entre nous, c'est parler pour ne rien dire... Il y a aussi un autre poète qui a dit : ... Fuir là-bas, fuir ! / Je sais que des oiseaux sont ivres / D'être parmi l'écume inconnue et les cieux... Seulement celui-ci, il est professeur d'anglais, et il continue à faire sa classe. Tenez, j'ai un ami... enfin une relation... un peintre... Il faisait des tableaux bretons, et puis il a eu des désillusions... Ça ne marchait pas très bien matériellement... Il est parti pour Tahiti. Loin de la civilisation, de l'époque et de ses laideurs ! Bon. Il m'a écrit. Il ne parle que du gendarme. Il ne fait plus de tableaux bretons, mais il fait des tableaux tahitiens... C'est comme les ministères : on les renverse, puis on reprend les mêmes et on recommence...
*
Ainsi, tout était fini, tout allait se détacher, se libérer, le monde allait partir à la dérive.
Cet été-là change radicalement Pierre Mercadier. Jusqu'ici, précautionneux, organisé, raisonné, son seul travers était de jouer en Bourse, ce qu'il appelait tromper Paulette - et encore, ne s'autorisait-il à miser qu'en accord avec les intérêts du pays. Plus rien de tout ça n'a cours chez lui après 1897. Evidemment, cela couvait depuis longtemps mais voilà que la cocotte explose pour de bon. Il n'y a plus que deux réalités tangibles : l'individu et l'argent. En accord avec ses nouvelles prises de conscience, et de façon éhontément égoïste, Pierre prend ses clics et ses clacs et abandonne tout le monde sans l'ombre d'un remord - comme l'a fait le grand-père de l'auteur dont il s'inspire fort pour ce personnage. S'en suit une parenthèse oisive et pathétique à Venise, à Vérone puis à Monte-Carlo où il rencontre Reine de Brécy qu'il quitte elle aussi, encore. Pierre ne croit plus en la nature humaine. Il est profondément désabusé.
Accoudé au mur crénelé de Vérone, il pense qu si le héros véritable de l'ancienne liberté était le condottiere, le héros d'aujourd'hui, dans le monde de l'industrie, du crédit et du papier-monnaie, c'est après tout l'homme à l'identité fuyante, qui glisse entre les mailles de la loi, ne s'embarrasse d'aucune des sottises de convention, sans place assignée ici ou là, maître de son destin, défiant les limites fixées à son existence, et dont l'histoire est faite de cent romans, de cent désastres...
*
On liquidait le vieux siècle et ses luttes périmées, on ouvrait le nouveau sur une parade publicitaire, l'Exposition Universelle qui nécessitait la confiance, on relançait la République avec ses filiales à chicotes, comme une affaire où l'assassin et la victime se pardonnaient mutuellement dans l'idylle des temps nouveaux, où ne comptait plus, enfin, que le profit, la grande loi de l'histoire.
A cet instant précis - on a dépassé la moitié du roman, on a compris deux choses importantes : Ce roman est d'une noirceur implacable et refuser la politique, comme le clame haut et fort Mercadier, c'est en faire encore un peu quand même, en contrastes et ombres chinoises. Ici, il est question d'une tentative de s'évincer de la société. De ne plus prendre part à cette marche dérisoire qui avale les individus pour en faire une masse informe régie par l'argent. Pierre Mercadier a tenté de sauter de l'impériale - sauf que c'est impossible. L'entreprise de Mercadier, peut-être par trop d'égoïsme, de froideur, de cynisme et de mépris de tout, est vouée à l'échec. Pierre Mercadier n'est pas l'idéaliste d'une société nouvelle. Il est celui qui fiche tout par terre pour ne rien recréer. Sa démarche, tôt ou tard, aboutira au néant parce qu'elle est stérile. Et de fait, quinze ans après sa fuite, tandis qu'on a forgé de lui une légende grotesque qui n'est pas sans rappeler celle de Rimbaud avec une ironie bien mordante, il réapparaît à Paris, vieilli prématurément et sans le sou. En bout de course. Il n'a pas d'autres choix que de reprendre une vie de professeur, aux crochets de son ancien collègue Meyer qu'il prend en horreur pour cela, et devient habitué d'un bordel où il ne fait que papoter avec le maquerelle. Elle, Dora Tavernier, développe un amour pur et passionnel pour ce M. Pierre qu'elle idéalise tandis qu'il n'est là que pour faire barrage à sa peur de la mort - c'est dans le même esprit qu'il va, le dimanche, observer son petit-fils Jeannot au parc. Evidemment, ça ne saurait durer. On est au seuil de la Première Guerre Mondiale et bientôt la politique va rattraper tout le monde, y compris ceux qui se pensaient en marge, pour tout engloutir sans distinction.
- Croyez-vous ? la grande majorité des hommes se fichent de l'histoire comme de leur première culotte. La frousse passée, on joue à la manille et tout est comme toujours, à la va-comme-je-te-pousse...
Lire ce roman aujourd'hui, c'est se faire doublement fouetter le museau. D'abord parce qu'on sait qu'il a été écrit en pleine Seconde Guerre Mondiale, et sachant cela, l'entièreté du roman est une forme de procès de l'individualisme de Mercadier et les dernières pages apparaissent d'une ironie cinglante. En même temps, Aragon n'apporte aucune solution. Ici, il n'y a pas de porte de sortie politique comme pour Catherine ou Victor dans Les cloches de Bâle ou pour Armand dans Les beaux quartiers. Là, rien. C'est noir. Aucune foi en rien ne se dessine. Mais ensuite, on réalise qu'on est présentement cent ans après et que ce n'est pas beaucoup plus joli. On oscille perpétuellement encore entre le communautarisme le plus sectaire et l'individualisme le plus chevronné. Voilà. Statu quo. On aimerait croire qu'un repli à la Mercadier est possible pour se soustraire à tout ça mais voilà qu'Aragon nous en démontre la stérilité. Bref : on est dans de beaux draps.
Outre cet aspect extrêmement sombre et, disons-le, lucide de l'existence, Aragon, comme toujours, se surpasse littérairement. Sans tomber jamais dans un genre littéraire ou un autre, il délivre, à coup de discours variés, et quel génie lorsqu'il s'agit de manier l'indirect libre d'ailleurs, un roman multifacettes de fifou grâce aux nombreux satellites de la planète Mercadier. Son fils Pascal vit un véritable apprentissage bucolique à Sainteville qui occasionne des pages sublimes sur la nature, les jeux et l'enfance. Plus tardivement, dans la dernière partie, alors qu'il est patron d'une pension de famille, on le retrouve en petit Don Juan sans envergure, à l'affût des femmes qui veulent de lui et on s'aperçoit qu'il a finalement quelque chose de la froideur et de l'égoïsme de son père. Quant aux femmes, les trois figures qui accompagnent Pierre sur son parcours révèlent tour à tour un monde à bout de souffle : Paulette incarne la bourgeoise qui ne se résout pas à la mort de sa caste et qui s'échine à garder des convenances obsolètes ; Reine veut être libre quoiqu'il en coûte, quitte à s'engager sur des terrains glissants ; et Dora est l'espoir ridicule, tragique, qui se transforme en fantasme impossible. Que Dora est pathétique et touchante ! Les pages qui lui sont consacrées sont d'une infinie beauté, parmi les plus vibrantes du roman.
Ce roman est une tragédie finalement. On sait très exactement comment tout va se dérouler. On le voit venir et la 4ème de couverture ne nous cache rien - ce qui explique que je ne vous ai rien caché non plus. Il n'y a rien à attendre en terme de dénouement : toute l'existence de la planète Mercadier et de son système solaire est vouée à s'abîmer dans le trou noir du vingtième siècle. Exactement comme dans les tragédies antiques, tout l'intérêt de ce roman ne réside donc pas dans le suspens haletant de connaître la fin mais dans le plaisir lucide de décortiquer tous les rouages qui mènent à l'acmé fatale. J'ai beaucoup parlé de noirceur, j'en conviens, et ce n'est peut-être pas très engageant pour beaucoup mais c'est pourtant un des gros points forts du roman au contraire : son absence de concession et son absence d'idéalisme. Chaque page est une gifle assénée au lecteur. C'est sûr, il faut avoir envie de ça lorsqu'on attaque le roman - je vous rassure, les découvertes de Pascal à Sainteville offrent tout de même une jolie parenthèse enchantée - mais si la littérature ne nous fouette pas un peu à l'occasion, qui aura le cran de le faire ? Finalement, je me plaignais en début de mois d'une lecture feel good un peu trop fade à mon goût ; je crois que j'ai déniché là son parfait contraire. J'ai bien fait de les enchaîner : j'ai ainsi vécu l'équivalent littéraire du bain nordique. Ça ravigote les neurones !
Nous nous attristons du malheur des grands hommes comme de l'effet injuste d'une fatalité à leur taille. Est-ce qu'il y a dans la vie un seul roman heureux? Est-ce que chaque vie humaine, la plus humble, ne se termine pas de façon tragique? Le rocher de Napoléon n'est rien d'autre que l'alcôve où se termine toute aventure, et tous les lits des maisons de Paris ont été les témoins d'agonies qui valent Ugolin, le Chevalier de la Barre ou Maximilien.
C'est vers cette issue horrible de la vie que nous sommes tous portés, inconscients du mouvement qui l'anime, du mécanisme de la locomotion, par un immense omnibus lui-même destiné aux catastrophes. Je me souviens d'avoir un soir traversé Paris aux premières lumières sur l'un de ces véhicules cahotants, pareil à une baleine qui glisse sur les ombres naissantes. C'était un soir que je me sentais inquiet et triste, la tête bourrée des chiffres dont dépendait ma liberté, des cours de la Bourse et des noms d'actions et de titres, comme une pauvre cervelle dépossédée qu'habitent les monstres du calcul. Tout d'un coup tout me sembla étrange, les cafés, les boulevards, les pharmacies. Je me mis à regarder mes voisins de l'impériale non plus comme des compagnons de hasard, qui s'égailleraient aux stations successives, mais comme les voyageurs mystérieusement choisis pour traverser avec moi l'existence. Je me mis à remarquer que déjà, sur un parcours bref, des liens s'étaient formés entre nous, le sourire d'une femme, le regard appuyé d'un homme, deux vieillards qui avaient lié conversation: une ébauche ds société. Et je pensais avec une espèce d'horreur que nous étions, nous à l'instant encore des étrangers, également menacés par un accident possible. De telle sorte que ce qui se passait en bas, entre les chevaux et la rue, et dont nous n'étions pas informés, risquait de créer entre nous une solidarité mortelle, et une intimité pire que l'intimité de l'amour, celle de la fosse commune. J'étais d'humeur à philosopher, parce que tout m'était amer. Je pensais que cette impériale était une bonne image de l'existence, ou plutôt l'omnibus tout entier. Car il y a deux sortes d'hommes dans le monde, ceux qui pareils aux gens de l'impériale sont emportés sans rien savoir de la machine qu'ils habitent, et les autres qui connaissent le mécanisme du monstre, qui jouent à y tripoter... Et jamais les premiers ne peuvent rien comprendre de ce que sont les seconds, parce que de l'impériale on ne peut que regarder les cafés, les réverbères et les étoiles; et je suis inguérissablement l'un d'eux, c'est pourquoi John Law qui inventa une façon d'affoler la machine restera toujours pour moi , malgré cette curiosité que je lui ai portée, un homme que je ne pourrai jamais me représenter dans les simples choses de la vie, flânant par exemple ou s'achetant des fruits chez l'épicier, ou jouant avec de petits enfants. Comme il est de toute vraisemblance qu'il fit, et ce n'est pas moins important à connaître de lui, que les opérations par lesquelles il créa la Compagnie des Indes. Voilà quarante années et plus que les miens et moi-même nous faisons vers une fin qui sera sans doute sinistre un chemin que je n'ai pas tracé, que personne n'a tracé. Peut-être pourrais-je m'expliquer l'étrange intérêt que j'ai porté à Law par cette croyance que j'ai qu'il a été l'un des rares hommes qui firent dévier le monde. Il n'était pas, lui, un voyageur de l'impériale...
Pour cette LC aragonaise, Nathalie a lu Les beaux quartiers
Et si toi aussi, tu as lu Aragon avec nous, manifeste-toi en commentaires pour que je recense ici ton billet !
11:19 Publié dans Classiques, Coups de coeur, Histoire, Lecture commune, Littérature française et francophone | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : louis aragon, les voyageurs de l'impériale, cycle du monde réel, lecture commune, pierre mercadier, individualisme, politique, argent, famille, mariage, société, fin de siècle, début de siècle, guerre, amour, cynisme, liberté, lucidité
06/02/2019
Agnès Grey d'Anne Brontë
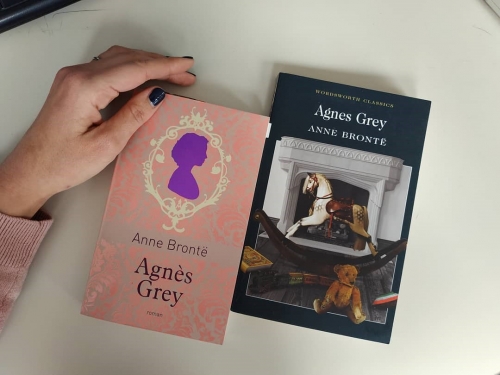 A bien des égards, Agnès Grey ressemble à Anne Brontë (et ce n'est pas fortuit). Cadette d'une famille de pasteur, élevée dans l'amour et le respect des convenances, elle est tendre mais néanmoins décidée à travailler. Les Grey n'ont jamais été pauvres - ils possèdent une voiture, n'économisent pas et se montrent généreux - mais ne sauraient être qualifiés de bourgeois pour autant. Ils évoluent dans l'entre-deux, cette "zone grise" comme la désigne avec humour Isabelle Viéville-Degeorges dans l'introduction de mon édition française, "sorte de no man's land social où l'on devient invisible des domestiques comme des maîtres". Aussi, lorsque le père investit gros et perd tout, seules trois professions peuvent être tolérées par l'entourage d'Agnès comme respectables : celle-ci opte pour une place de gouvernante chez les Bloomfield à quelques miles du presbytère familial, puis chez les Murray quelques temps plus tard, qui l'éloignent encore plus du foyer. Ces expériences sont des désastres complets. Les enfants, d'âges différents, ont tous en commun d'être indomptables, vaniteux et mesquins. D'ailleurs, leur rapport aux animaux parle d'eux-mêmes, le pompon revenant au jeune maître Bloomfield, véritable bourreau sans remord. Pour Agnès, se comporter de la sorte avec indifférence voire cruauté présage d'une personnalité maligne et détestable et, en effet, ses paroles ne sont que fiel à l'endroit de ses élèves. On retrouvera un peu ce penchant à l'amusement dénué d'empathie par la suite avec Rosalie Murray qui se plaît à jouer avec ses prétendants.
A bien des égards, Agnès Grey ressemble à Anne Brontë (et ce n'est pas fortuit). Cadette d'une famille de pasteur, élevée dans l'amour et le respect des convenances, elle est tendre mais néanmoins décidée à travailler. Les Grey n'ont jamais été pauvres - ils possèdent une voiture, n'économisent pas et se montrent généreux - mais ne sauraient être qualifiés de bourgeois pour autant. Ils évoluent dans l'entre-deux, cette "zone grise" comme la désigne avec humour Isabelle Viéville-Degeorges dans l'introduction de mon édition française, "sorte de no man's land social où l'on devient invisible des domestiques comme des maîtres". Aussi, lorsque le père investit gros et perd tout, seules trois professions peuvent être tolérées par l'entourage d'Agnès comme respectables : celle-ci opte pour une place de gouvernante chez les Bloomfield à quelques miles du presbytère familial, puis chez les Murray quelques temps plus tard, qui l'éloignent encore plus du foyer. Ces expériences sont des désastres complets. Les enfants, d'âges différents, ont tous en commun d'être indomptables, vaniteux et mesquins. D'ailleurs, leur rapport aux animaux parle d'eux-mêmes, le pompon revenant au jeune maître Bloomfield, véritable bourreau sans remord. Pour Agnès, se comporter de la sorte avec indifférence voire cruauté présage d'une personnalité maligne et détestable et, en effet, ses paroles ne sont que fiel à l'endroit de ses élèves. On retrouvera un peu ce penchant à l'amusement dénué d'empathie par la suite avec Rosalie Murray qui se plaît à jouer avec ses prétendants.
Patience, Firmness, and Perserance, were my only weapons; and these I resolved to use the utmost.
Mais le parallèle avec Anne s'arrête ici. Avec la famille Murray, Agnès se rend une à deux fois par jour à l'église (paye ta vie de fifou) et, petit à petit, avec la lenteur et la pondération qui la caractérisent, elle tombe sous le charme du jeune vicaire, M. Weston. Alors bon, il ne faut pas s'emballer pour autant. S'ils échangent quatre conversations à propos de la pluie et de quelques livres pendant la première année de leur rencontre, c'est bien le bout du monde. A la vérité, c'est surtout l'occasion pour Anne Brontë de faire discourir sa protagoniste sur les tenants et les aboutissants d'une morale extrêmement corsetée infusée de religion jusqu'au trognon.
The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody. The end of Religion is not to teach us how to die, but how to love; and the earlier you become wise and good, the more of happiness you secure.
Finalement, ce gris patronymique d'Agnès n'est pas seulement évocateur de sa classe sociale ; il est aussi très révélateur de sa personnalité : insipide, ennuyeuse et, par dessus tout, bien trop moralisatrice à mon goût. A l'exception de ce bon M. Weston et, bien évidemment, de sa parfaite famille (mention spéciale à l'image d’Épinal de Madame Grey), tous les autres personnages sont méprisés - et j'ai presque envie d'ajouter que les tractopelles de modalisateurs dont elle use pour avancer ses assertions avec une feinte précaution ne font que rajouter du piment à la sauce barbecue. Le recul et la modestie d'Agnès sonnent faux. Elle n'est que jugements péremptoires et rigidité. Ne vous méprenez pas : j'ai bien conscience de l'époque d'écriture du roman et j'ai bien conscience du contexte. Les badineries de Rosalie sont hautement répréhensibles, de même que les caprices et la pédanterie du petit Bloomfield et la pondération en toute chose est une des plus grandes qualités de l'époque, pour une femme en particulier. A cet égard, j'ai beaucoup pensé au personnage de Fanny Price dans Mansfield Park de Jane Austen. On est un peu sur cette gamme de jeune femme indispensable à tout le monde et en même temps invisible parce que trop pauvre et trop terne pour cette gentry anglaise orgueilleuse et riche. Sauf qu'un élément absolument crucial empêche de pousser plus loin ce parallèle : l'ironie. Lire une page de Jane Austen, c'est s'exposer à plusieurs niveaux de lecture d'une finesse exemplaire. Lire Agnès Grey, c'est s'ennuyer d'un premier degré pénible.
My only companions had been unamiable children, and ignorant, wrong-headed girls; from whose fatiguing folly, unbroken solitude was often a relief most earnestly desired ans dearly prized. But to be restricted to such associates was a serious evil, both in its immediate effects and the consequences that were likely to ensue.
Voilà donc mon sentiment à l'égard de ce roman : dispensable et, franchement, très en-dessous de ce que les sœurs d'Anne ont su produire exactement à la même époque. Je n'ai pourtant pas follement aimé ma lecture de Jane Eyre, auquel j'ai trouvé bien des longueurs, et celle des Hauts de Hurlevent date de trop longtemps pour constituer un avis de lecture absolument fiable - j'ai d'ailleurs très envie de le relire à présent, pour voir s'il me ferait encore autant vibrer. Autant dire, donc, que je ne suis pas non plus une inconditionnelle de la fratrie. N'empêche que je garde un souvenir passionné du roman d'Emily et la densité intense de Jane Eyre, malgré mes bémols sur la longueur, ne m'a pas échappé. Agnès Grey n'est ni passionnant ni intense ni foisonnant. Il est simple et direct, c'est indéniable et c'est, après tout une qualité qu'on peut lui reconnaître. Mais peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'il manque à mon sens de recul et de profondeur pour être de ces romans qui marquent et que j'aime, tout simplement. D'ailleurs, je conclurais sur deux citations de deux critiques de l'époque rapportées dans l'introduction de mon édition anglaise (ce roman aura tout de même eu la vertu de me refaire lire un peu en anglais - quand j'avais les yeux en face de trous, ce qui ne m'était pas arrivé depuis une dizaine d'années) et qui résument exactement mon appréciation :
Agnes Grey is a sort of younger sister to Jane Eyre ; but inferior to her in every way. (Cela dit, rendons quand même à César ce qui est à César, même si présentement César manque de force et de talent, car c'est bien Charlotte qui s'est inspirée d'Anne pour son récit d'une gouvernante un peu fadasse et non l'inverse et, sans déconner, elle a quand même bien fait).
There is a want of distinctness in the character of Agnes, which prevents the reader from taking much interest in fer fate - but the story, though lacking the power and originality of Wuthering Heights, is infinitely more agreeable. It leaves no painful impression on the mind - some may think it leaves no impression at all... (allez, bisous.)
09:36 Publié dans Classiques, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : agnès grey, anne brontë, hayworth, presbytère, enfance, pauvreté, gouvernante, enseignement, travail, famille, amour, expérience, mariage, éducation, littérature anglaise, classique




