27/09/2020
Little de David Treuer
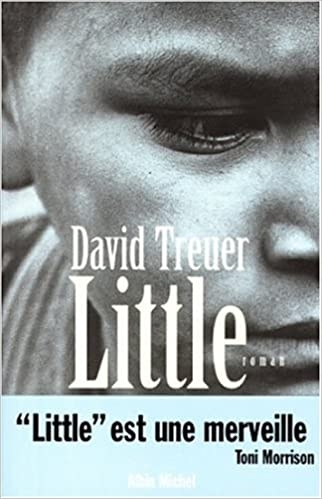 Ce roman choral, premier roman de David Treuer, développe la vie de plusieurs personnages entre le début du XXème siècle et 1980 dans une réserve indienne du Minnesota et plus précisément dans le lotissement bien nommé de Pauvreté. Le point de départ du récit est l'enterrement de Little dont on n'a pas retrouvé le corps, un garçon de huit ans qui ne parlait pas ou à peine - ce Toi jeté de façon brutale était son seul mot. Cette tombe vide résonne comme une absurdité douloureuse à l'esprit de tous. Chaque personnage tour à tour, en découvrant son passé et son présent, va tenter de redonner sens et corps à Little - non pas vie, car ce qui est mort ne peut être ressuscité mais ce sens et ce corps nécessaires pour que le deuil se fasse et pour que la vie de ceux qui restent continue. Ainsi, le roman se termine sur une éclosion - comme la métaphore d'un cycle éternel jusqu'ici enrayé de souffrances et que le pouvoir créatif de la langue, entre autres, permet de relancer parce qu'il aide à se rappeler, à comprendre, à transmettre, à aimer, à pardonner, à construire et à inventer aussi.
Ce roman choral, premier roman de David Treuer, développe la vie de plusieurs personnages entre le début du XXème siècle et 1980 dans une réserve indienne du Minnesota et plus précisément dans le lotissement bien nommé de Pauvreté. Le point de départ du récit est l'enterrement de Little dont on n'a pas retrouvé le corps, un garçon de huit ans qui ne parlait pas ou à peine - ce Toi jeté de façon brutale était son seul mot. Cette tombe vide résonne comme une absurdité douloureuse à l'esprit de tous. Chaque personnage tour à tour, en découvrant son passé et son présent, va tenter de redonner sens et corps à Little - non pas vie, car ce qui est mort ne peut être ressuscité mais ce sens et ce corps nécessaires pour que le deuil se fasse et pour que la vie de ceux qui restent continue. Ainsi, le roman se termine sur une éclosion - comme la métaphore d'un cycle éternel jusqu'ici enrayé de souffrances et que le pouvoir créatif de la langue, entre autres, permet de relancer parce qu'il aide à se rappeler, à comprendre, à transmettre, à aimer, à pardonner, à construire et à inventer aussi.
Dans les années qui ont suivi, nous avons tous, à Pauvreté, embelli nos histoires sur Little, nous leur avons donné des ailes et nous les avons laissées s'envoler. Et comme il y avait si peu à raconter, elles ont pris le départ, elles sont parties tout là-haut, en décrivant des cercles et, comme les pissenlits, elles n'ont jamais plus jamais touché terre.
Non seulement l'histoire mais plus largement le propos soutenu par une construction métaphorique intelligente et subtile sont très intéressants. Néanmoins, je me dois de reconnaître que je m'y suis fréquemment ennuyée. La langue en tant que telle ne m'a pas follement emballée et je pense malheureusement que ma lecture de ce texte, pourtant clairement précurseur dans son genre puisqu'il est paru en 1995 aux États-Unis intervient dans ma vie de lectrice après de nombreux autres textes construits peu ou prou de la même façon et sur le même sujet. Du coup, je n'ai pas eu le saisissement des découvertes et tout m'a semblé au contraire très transparent. Il n'en reste pas moins que c'est vraiment un très bon premier roman et que je continuerai évidemment à lire David Treuer. A ce sujet, si vous n'avez jamais lu Le manuscrit du docteur Apelle, je vous encourage à vous pencher dessus : il avait été, pour le coup, un vrai coup de cœur !

Le mois américain chez Titine
20:27 Publié dans Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : little, david treuer, mort, deuil, histoire, langue, guérison, réserve indienne, minnesota, pauvreté
09/01/2019
Le manuscrit du Docteur Apelle de David Treuer
 Ça commence de façon apparemment banale avec deux histoires fort opposées.
Ça commence de façon apparemment banale avec deux histoires fort opposées.
D'un côté, nous avons celle d'Apelle, docteur en philologie et traducteur de langues autochtones, franchement insipide. Célibataire endurci d'une quarantaine d'années, son quotidien est une routine perpétuelle : les mêmes habits, les mêmes rues, les mêmes prostituées, les mêmes tâches à la RECAP, un cimetière de livres où personne ne va jamais et où tous les ouvrages du monde sont oubliés et, tous les quinze jours, la même activité de traduction dans la même bibliothèque.
Le premier chapitre qui lui est consacré rend à merveille cette existence transparente par une blancheur de style qui énumère sans aucune émotion. Lecteur, si tu t'y ennuies, c'est normal et c'est volontaire. Attends un peu.
Il nous suffira de dire que le roman de la vie du Dr Apelle est moitié anglais avec ses presbytères, ses châteaux, ses thés de cinq heures, ses abstinence et ses abnégations, et moitié français avec ses bordels, ses trahisons et le parfum séducteur des cattleyas.
D'un autre côté, celle de Bimaadiz et d'Eta, deux enfants trouvés dans les mêmes circonstances désastreuses : après un hiver rigoureux, ils sont les seuls survivants de leurs villages respectifs grâce au secours d'une orignale et d'une louve. De tels auspices font progressivement d'eux des êtres à part, beaux et doués, et la fierté de leurs parents adoptifs modestes. Evidemment, ce n'est qu'une question de temps avant que de tendres sentiments ne les lient et qu'ils n'excitent les jalousies...
Autant dire que de ce côté-là du récit, David Treuer nous relate un conte épique et doux, qui n'est pas sans cliché - loin de là même - mais qui nous fait intensément voyager et se lit avidement. C'est presque à regret qu'on quitte nos deux héros magnifiques pris dans moult péripéties (si vous êtes clients de ce genre d'histoires d'indiens) pour retrouver le docteur Apelle, antihéros par excellence.
Il ne pouvait oublier ce qu'il avait vu. Son souffle s'accélérait et son cœur battait plus vite quand il pensait au corps d'Eta. il avait failli être l'esclave de l'ennemi, mais seulement pour devenir l'esclave du désir.
Sauf que. Je te le disais, ce serait mal connaître l'auteur, tout de même sacrément talentueux, d'imaginer cinq minutes que son roman puisse se résumer à ce va-et-vient stérile entre deux récits à couper au couteau. L'un, progressivement, résonne en l'autre.
Cette histoire d'Eta et de Bimaadiz, c'est Apelle qui l'a trouvée au détour d'une étagère de bibliothèque, manuscrit obscur et oublié, et qui la traduit pour nous. C'est donc lui qui nous la raconte et, à mesure qu'il compose les mots, ceux-ci infusent et circulent en lui. Il s'interroge à leur contact, se cherche en les révélant pour nous. Le traducteur, petit à petit, dialogue avec son texte et par son entremise, réfléchit sur lui-même et dialogue avec nous.
En lisant ce roman, de plus en plus riche, profond et labyrinthique à mesure qu'il avance, m'est revenu en mémoire le titre d'un ouvrage de Jacques Poulin, La traduction est une histoire d'amour (pour le coup, très dispensable) qui m'a semblé être fait pour lui. Les mots enchantent celui qui les écrit, puis celui qui les découvre dans leur langue originale pour les transmettre, et les faire siens entre temps, dans une autre langue à destination des lecteurs du monde. C'est à la fois une relation intellectuelle et charnelle - une relation totale, en somme. A force, on se demande s'il s'agit d'une traduction, d'ailleurs. Les styles se mêlent, les phrases se font plus souples et circulent d'une page à l'autre. Les barrières tombent. Où s'arrête le traducteur, où commence le récit ? Telle est la question qui nous perd et brouille toutes les pistes. On ne sait plus quelle histoire on lit. Il se pourrait d'ailleurs qu'au fond, on ne lise qu'une seule et même histoire et tu imagines bien qu'avec autant d'interrogations et de porosité entre les textes, c'est de plus en plus délicieux à mesure que les pages se tournent.
et, comme avec un battement d'ailes, les manuscrits et les pages se referment, pareils à des oiseaux qui se perchent, avant d'être emportés, endormis, vers le comptoir et le chariot qui les attend.
Pour te dire vrai, grâce à ce livre, je découvre David Treuer romancier et je ne suis pas mécontente du voyage. Je ne l'avais lu, jusqu'ici que comme essayiste, avec pas mal de textes critiques et théoriques sur les littératures autochtones et avec l'excellent Indian Roads, à l'époque de mon mémoire et, conséquemment, de mon challenge amérindien. Franchement, je suis ravie et, quelques semaines après avoir refermé le bouquin, j'ai encore les neurones qui pétillent à son souvenir. Le propos est si lumineux et les mots si subtils - tout autant les siens que ceux de Michel Lederer, son traducteur chez Albin Michel (bravo monsieur) - que ça donne envie de continuer un bout de chemin avec lui. To be continued, donc !
18:37 Publié dans Coups de coeur, Littérature amérindienne, Littérature anglophone | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : le manuscrit du docteur apelle, david treuer, albin michel, michel lederer, traduction, amour, quête de soi, identité, histoire, passé, passion, littérature, mort, naissance, livre
05/11/2018
Bleuets et abricots de Natasha Kanapé Fontaine
 Un rendez-vous poétique, ça faisait longtemps ! Depuis la trêve estivale, j'ai procrastiné à me remettre à la poésie - la saison, l'instant, l'humeur de s'y prêtaient pas. Et puis j'ai saisi l'occasion du mois québécois pour lire enfin le dernier recueil de Natasha Kanapé Fontaine, Bleuets et abricots, qui traînait depuis sa sortie dans ma PAL poétique.
Un rendez-vous poétique, ça faisait longtemps ! Depuis la trêve estivale, j'ai procrastiné à me remettre à la poésie - la saison, l'instant, l'humeur de s'y prêtaient pas. Et puis j'ai saisi l'occasion du mois québécois pour lire enfin le dernier recueil de Natasha Kanapé Fontaine, Bleuets et abricots, qui traînait depuis sa sortie dans ma PAL poétique.
J'ai envie de vous dire qu'on reprend les mêmes et on recommence - mais en moins émoustillant qu'auparavant cette fois-ci.
Égale à la planète brûlée
je vomirai un dernier cri
au calvaire humain :
l'accouchement de moi-même
l'oiseau-tonnerre
De N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, on retrouve les trois mêmes ingrédients de la voie poétique de Natasha Kanapé Fontaine : l'indianité, la féminité, la terre - à quoi s'ajoute une colère viscérale, lancinante particulièrement lassante pour le lecteur à la longue. Le premier recueil, à mon sens, interrogeait, mettait en branle une dynamique et, à défaut de répondre, proposait, lançait, creusait, créait. Il y avait une énergie centrifuge qui, du centre, tourbillonnait et rayonnait hors de soi - du connu - des blessures - de la rancœur. Il y a avait de la maladresse, de la naïveté sans doute mais surtout de la fraîcheur et un élan indéniable.
Dans Bleuets et abricots, l'énergie n'en peut plus de ressasser et au lieu de rayonner, tourne en rond. Ce qui se voulait naissance puissante se transforme en vomi et en hargne. Un cri s'élève en moi et me transfigure, nous dit la poétesse dans le prologue, et en effet, l'ensemble du recueil est un cri qui n'en finit pas de grincer et de s'enrouler sur lui-même. Cela donne une litanie pénible qui se complaît à remâcher les mêmes motifs, les mêmes images poétiques (par exemple, tout ce qui est sein et chevelure, cliché de la femme poétique depuis la nuit des temps, se déroule à l'envi), les mêmes anaphores lyriques où le je - nouveau et martelé - est porté en héraut de la liberté. Honnêtement, à part quelques éclairs furtifs, c'est poétiquement banal et mille fois vus. Le recueil fait 78 pages et j'ai eu un mal de chien à en venir à bout. Ce n'est clairement pas un excellent cru de l'auteure et j'espère la retrouver un peu moins nombriliste et revancharde la prochaine fois - aussi lumineuse et créative qu'elle a su l'être jusqu'ici.
Donnez-moi le verbe de la mer
donnez-moi l’origine du monde
donnez-moi le vomi du fleuve
donnez-moi le corps mort des oiseaux
Donnez-moi l’hymne des dieux d’Afrique
Donnez-moi l’anaconda de Mami Wata
Donnez-moi le fantôme de l’aigle noir
Donnez-moi les dents du jaguar
Je ferai des feux pour la joie
je ferai des jeux pour l’amour
Je les offrirai aux dieux vaudou
Puisque ma lecture est une déception, je n'ai pas eu l'inspiration d'une oeuvre avec laquelle la faire dialoguer. Ce n'est que partie remise jusqu'au prochain rendez-vous poétique !
Je voudrais conclure mon billet sur une question ouverte néanmoins. Pour vous dire vrai, j'ai beaucoup hésité à publier cette chronique. Tout d'abord, parce qu'en poésie, je me concentre généralement sur ce que je trouve de qualité mais surtout parce qu'à un moment donné, j'ai craint que mon propos soit mal reçu, eu égard à l'indianité et au féminisme de l'auteure. En gros, j'ai touché du doigt cette tendance actuelle qui consiste à prendre des gants voire à ne rien dire de négatif sur certains sujets/domaines/productions artistiques, dès l'instant où cela risquerait de reproduire un schéma passé (ou pas) dominant/dominé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou est-ce que je m'exprime mal (en vrai, je réécris ce bout de paragraphe pour la soixantième fois et je n'arrive pas à trouver les bons mots, c'est insupportable. J'espère que cette fois-ci sera la bonne) ? Par exemple, je n'ai aucunement hésité à être cash sur mon dernier billet lorsqu'il s'est agi de critiquer quelques artistes contemporains très contents d'eux-mêmes mais j'ai hésité aujourd'hui à l'être tout autant. Du coup, ça m'amène à la question : est-ce qu'il vous est arrivé de peser particulièrement vos mots (évidemment, si vous êtes déjà le roi ou la reine de la diplomatie, ça ne compte pas !) ou de vous censurer selon le sujet dont vous parlez ? Je veux dire, prenons un exemple concret : seriez-vous aussi franc du collier (vraiment hein) en critiquant le dernier roman d'un auteur que vous savez Asperger et dans lequel il relate une partie de son expérience, même si littérairement ça ne casse pas trois pattes à un canard*, qu'en critiquant, je ne sais pas, disons un roman de Nothomb ? Cela vous semble-t-il un souci nécessaire de bienveillance et de diplomatie ou au contraire un manque de franchise et une uniformisation galopante de la pensée ? A quel moment, la franchise devient-elle de l'indélicatesse, de l'impolitesse, voire une prétention, une violence ? A quel moment la compréhension devient-elle complaisance ? A quel moment la bienveillance transforme l'esprit critique en purée de pois cassés ? Franchement, je me pose la question. Voilà, en fait, c'est peut-être pour en venir à cette question que j'ai malgré tout décidé de publier mon billet - et parce que, d'une certaine manière, c'est ma manière d'y répondre.
*Non, je n'ai pas lu le dernier roman d'Olivier Liron, c'est seulement un exemple. Quoique le décalage important que j'ai trouvé entre les extraits que j'ai lus et les dithyrambes unanimes que je lis à son propos participent clairement à mon interrogation.
Sur ce, je vous invite à aller lire le rendez-vous poétique de novembre chez Marilyne qui nous présente des textes poétiques de François Cheng en regard des toiles de Zao Wou-Ki. Miam !
10:01 Publié dans Art, Challenge, Littérature amérindienne, Littérature française et francophone, Poésie | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : rendez-vous poétique, poésie, natasha kanapé fontaine, bleuets et abricots, innu, amérindien, mois québécois





 Québec en novembre chez
Québec en novembre chez